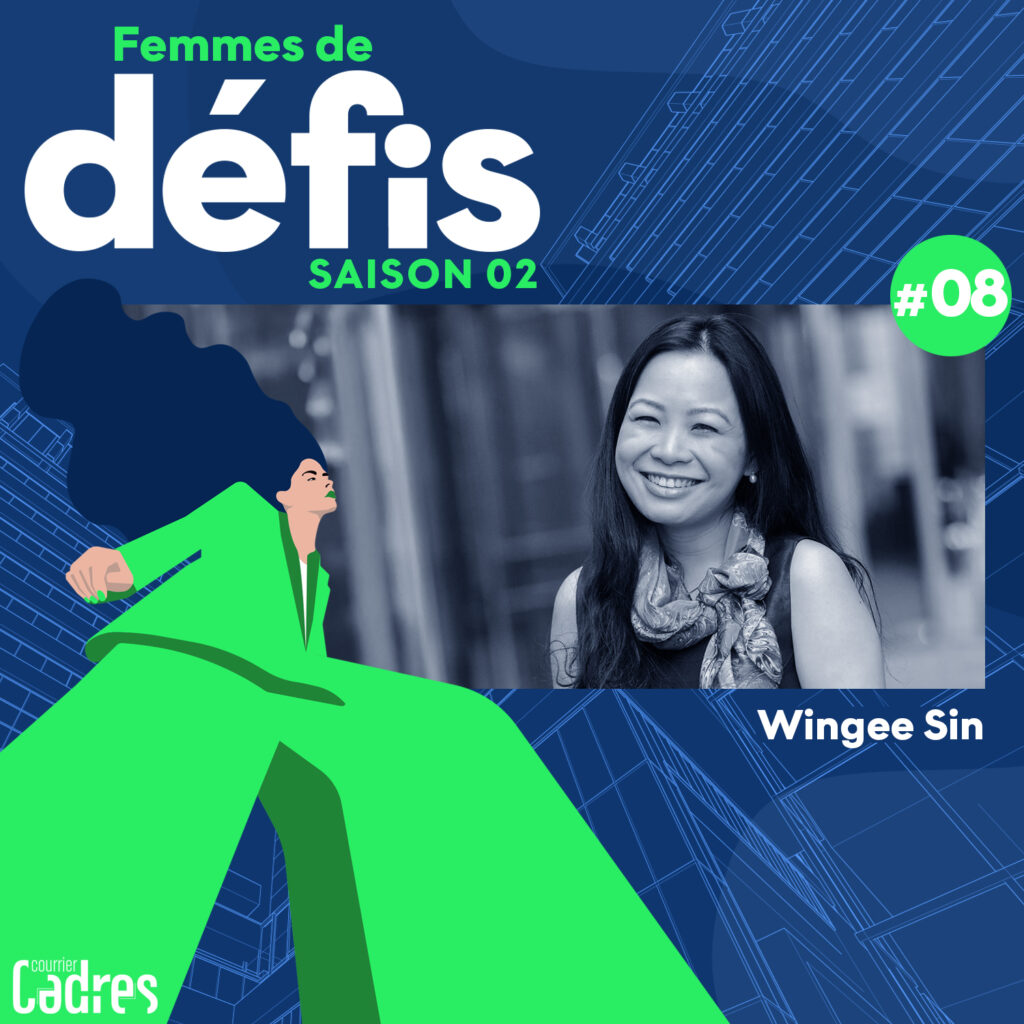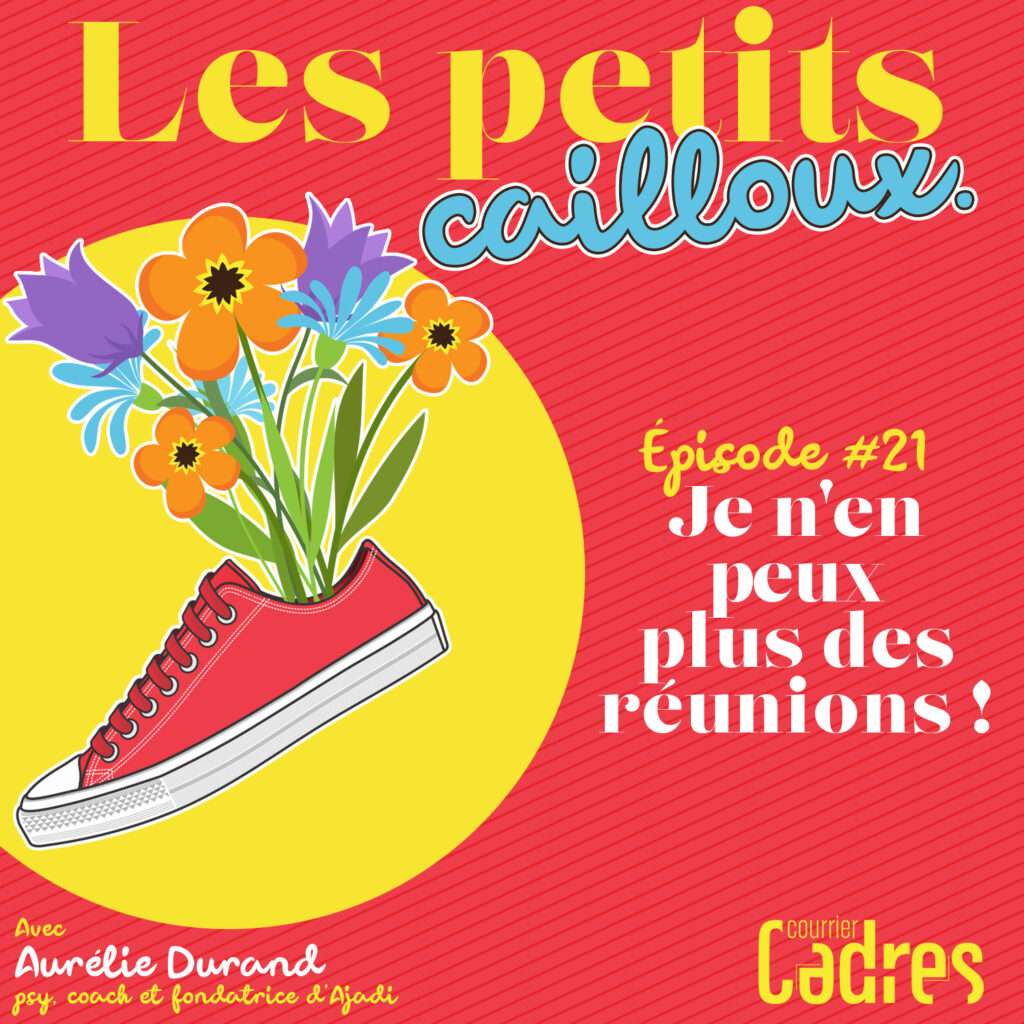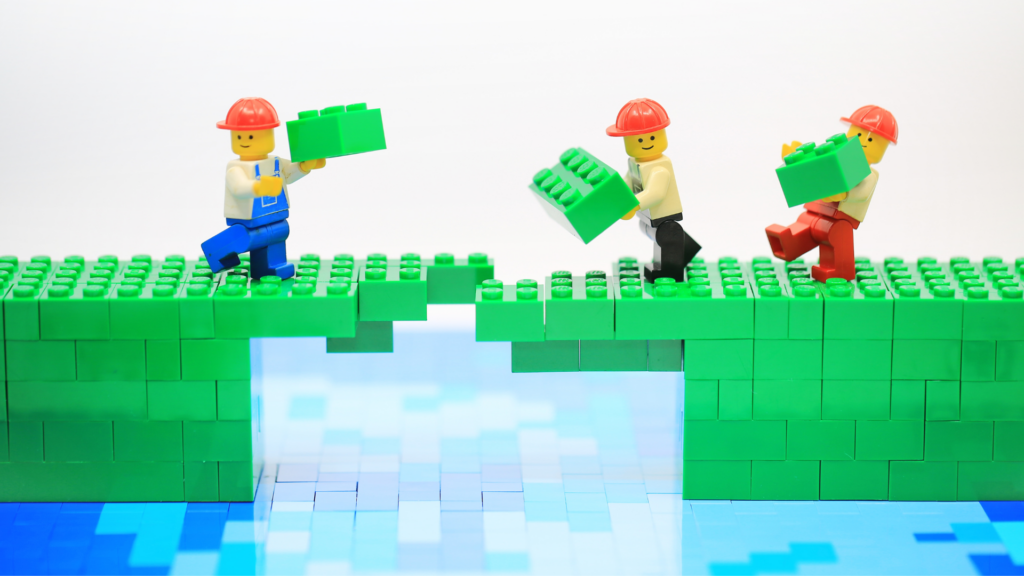Plus d’un tiers des cadres disent être témoins de pratiques illégales dans leur travail, selon un sondage Viavoice / Ugict-CGT. Pour le syndicat, il y a urgence à créer de nouveaux droits pour leur permettre de devenir lanceurs d’alerte.
Le 7 novembre, l’Ugict-CGT organisait, avec Eurocadres, les “Rencontres européennes des lanceurs d’alerte”, à Paris. À cette occasion, elle a dévoilé un sondage commandé auprès de l’institut Viavoice, qui révèle que 36 % des cadres ont déjà été témoins de pratiques illégales ou contraires à l’intérêt général, dans le cadre de leur travail.
Selon l’étude, 42 % des répondants disent “ne les avoir dénoncées à personne”. Pourquoi ? Probablement parce que 49 % des répondants indiquent ne pas avoir à leur disposition, dans leur entreprise, de “dispositif d’alerte” interne. “Quand il existe, ils ne sont que 42 % à le juger inefficace”, note l’Ugict-CGT.
En outre, 51 % des cadres considèrent “qu’il y a des risques pour celles et ceux qui dénoncent de telles pratiques” dans leurs entreprises.
“L’urgence de nouveaux droits”
En parallèle, l’Ugict-CGT a publié un guide des lanceurs d’alerte, et s’est jointe au journal Médiapart et à d’autres ONG et syndicats pour adresser au président de la République une lettre ouverte sur les lanceurs d’alerte, intitulée “l’urgence de nouveaux droits”.
“Ces chiffres inquiétants démontrent l’insuffisance de la loi Sapin 2, qui isole les lanceurs d’alerte en les contraignant à saisir d’abord leur hiérarchie et les empêche de solliciter syndicats ou ONG pour porter leur alerte”, commente le syndicat des cadres et ingénieurs tech-.
“Quatre ans après le Dieselgate et le scandale des moteurs truqués de Volkswagen, développés par des ingénieurs et techniciens qui n’avaient pas de possibilité effective de refuser et dénoncer ces pratiques sans y risquer leur carrière, les salariés, notamment en responsabilités, sont toujours enfermés dans l’impasse du ‘se soumettre ou se démettre’”, ajoute l’Ugict.
Selon l’organisation, “il y a urgence” à créer de nouveaux droits pour permettre “de faire primer l’éthique professionnelle sur les directives financières”. L’enjeu étant “d’adosser la responsabilité professionnelle sur l’intérêt général.”