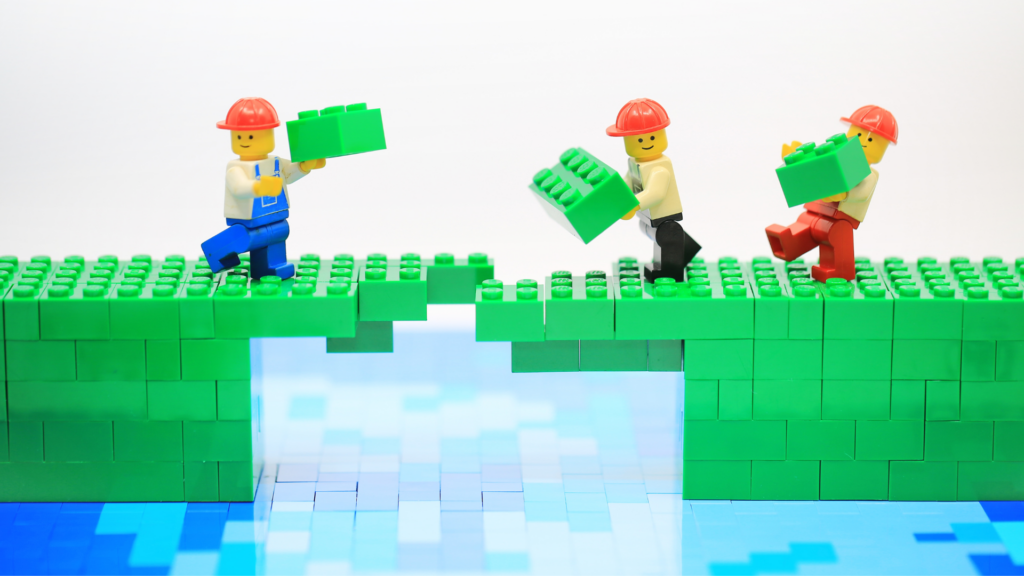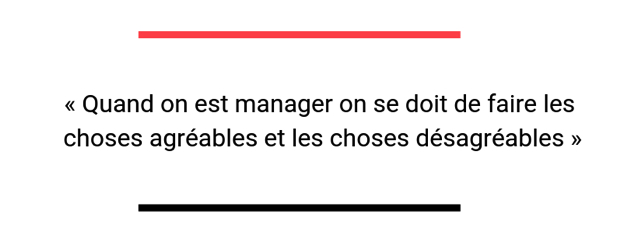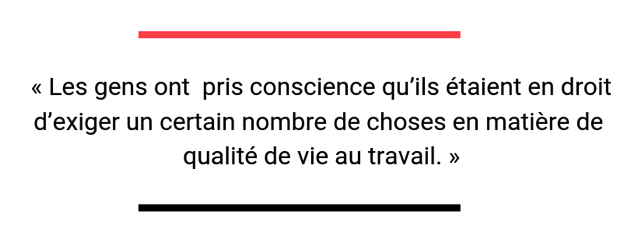À travers ses activités de médecin, d’animateur, d’auteur et d’acteur pour ne citer que les principales, Michel Cymes semble en alerte permanente. Il assure pourtant avoir pris conscience qu’il était essentiel de prendre du temps pour lui afin de tenir le rythme. Photos Leo-Paul Ridet
Avec “Ça ne sortira pas d’ici” diffusé depuis octobre sur France 2, vous vous êtes lancé dans un nouveau projet à côté de vos activités de médecin, chroniqueur radio et acteur. Comment faites-vous pour tenir le rythme ?
Je suis médecin avant tout et toutes les activités que je mène découlent de la médecine. Du coup, cela me demande moins de travail. Même s’il faut que je me tienne au courant des nouveautés et c’est d’ailleurs ce que je fais régulièrement à travers la formation continue, mes 12 années de fac de médecine me sont utiles au quotidien. Je n’ai pas besoin à chaque fois de me replonger dans les bouquins. Ensuite, je me suis entouré de personnes en qui j’ai une confiance absolue et je délègue énormément. Ma passion à moi, c’est d’inventer, de créer des projets. Une fois que je les ai imaginés, la phase de concrétisation m’intéresse moins. Je m’entoure de personnes qui vont épouser le projet de m’aider à le développer. J’ai donc ensuite un rôle plus simple.
Vous êtes connu pour être quelqu’un de très fidèle dans le travail. Est-ce un moteur pour vous ?
Cela peut être un défaut dans ce métier mais, en effet, je suis d’une très grande fidélité. Je ne peux travailler qu’avec des personnes en qui j’ai une totale confiance et je n’ai rencontré que des personnes qui ne l’ont pas trahie. Il y a une part de chance mais aussi le souci de choisir les bons collaborateurs et cela dépend également de votre façon de manager. Par exemple au Magazine de la Santé, nous sommes obligés de dire aux jeunes journalistes d’aller chercher du travail ailleurs pour développer leur expérience, sinon, ils ne partiraient jamais. La plupart des personnes avec lesquelles je travaille sont mes amis. Christophe Brun, Patrice Romedenne sont des professionnels avec lesquels je collabore depuis de nombreuses années, mais aussi des amis de 20 ans. Même chose avec Adriana Karembeu, aujourd’hui nous sommes presque plus amis que collègues. Et j’ai besoin de ça. Je ne peux pas travailler dans le conflit, la neutralité ou l’indifférence.
Cette situation vous amène à mêler vie pro et perso à contre-courant des préconisations actuelles ?
Oui, mais pour moi c’est très important. Les métiers médiatiques vous conduisent souvent à être entouré de flatteurs. J’ai en tête des animateurs plutôt suivis de courtisans que de collègues et je ne veux pas de ça. Je pense qu’inconsciemment, le fait de travailler avec des gens qui sont aussi des amis est une garantie pour moi de ne pas avoir de flatteurs. C’est un milieu dans lequel on peut vous dire sans cesse que vous êtes le meilleur du monde pour vous faire plaisir et cela peut vous faire perdre les pédales.
Même si vous êtes souvent à l’origine de vos projets, n’avez-vous pas de problèmes pour déléguer ?
Aucun et c’est une énorme chance. La raison pour laquelle j’arrive à déléguer, c’est aussi qu’une fois que le projet est en place et vendu, je m’ennuie et je veux passer à autre chose. Chez RTL, j’ai travaillé avec mes collègues sur ce que nous allions mettre dans l’émission, j’ai passé beaucoup de temps sur les 4-5 premières. Ensuite, j’ai plutôt improvisé puisque c’est là que je me sens le mieux et c’est eux qui gèrent la chronique. Si je n’étais pas entouré de Marina (Carrère d’Encausse, ndlr) et de Patrice (Romedenne, ndlr) par exemple, je ne ferais pas un dixième de ce que je fais actuellement.
Résultat, vous avez du mal à dire non ?
J’avais du mal il y a encore quelques années. J’essaye toujours de me dire que je n’ai pas le droit de refuser d’aller dans les petits médias car quand j’ai commencé j’étais bien content que l’on m’y invite. Mais à un moment, plus ça marche pour vous, plus vous êtes bankable. On vous sollicite de partout et vous êtes obligé de refuser car ce n’est plus gérable. Aussi, j’ai très peur de la surexposition, que le public en ait assez de me voir partout. Quand vous êtes un produit d’appel, on s’aperçoit que quand vous venez dans une émission ou que vous faites la couverture d’un magazine, vous faites vendre. À partir du moment où j’ai compris cela, j’ai commencé à dire non à certaines invitations. Je veux bien être un produit d’appel pour nos projets, mais pas pour les autres.
Comment faites-vous pour sélectionner les projets sur lesquels vous vous engagez ?
Il y a toujours un même socle dans mes choix, c’est la médecine. Quand un projet est trop éloigné de la médecine, je ne le fais pas. Ensuite, comme je consulte deux fois par semaine à l’hôpital, je me demande si ce que l’on me propose est compatible avec la crédibilité que je dois avoir vis-à-vis de mes patients. On me sollicite, par exemple, de plus en plus pour des rôles dans des fictions qui n’ont rien à voir avec le rôle de médecin. Je me dis que je vais passer à la TV dans un téléfilm le lundi dans un rôle de commerçant ou de cadre dans une grande entreprise et le lendemain matin, je reçois un patient à l’hôpital à qui je dois annoncer qu’il a un cancer. Il m’a vu la veille à la TV. Qui a-t-il en face de lui ? Je ne veux pas voir le moindre doute dans le regard de mes patients. Après, je pense qu’il est désormais bien ancré dans la tête du public que je suis médecin ! Autre élément, aujourd’hui, le luxe est de pouvoir choisir uniquement de faire des choses qui m’amusent.
Au début de votre carrière, vous exerciez en cabinet. Est-il impensable pour vous aujourd’hui de travailler dans un bureau toute la journée ?
Effectivement je l’ai fait, un temps, au début des années 1990 mais ce n’est pas fait pour moi. Il faut que je bouge, que je travaille sur des choses différentes tout au long de la journée. Je ne tiens pas en place. J’ai d’ailleurs beaucoup de mal à travailler chez moi. Il y a des journées où je n’aurais pas forcément besoin d’aller au bureau, mais travailler le matin, déjeuner chez moi, retravailler l’après-midi, ce n’est pas possible. Il faut que je bouge et que j’aille dans des endroits différents.
Comment vous qualifierez-vous en tant que manager ?
Très sympa, mais très exigeant. Je ne suis pas du genre caractériel ou colérique, mais plutôt dans la bienveillance. C’est peut-être mon côté médecin, mais je vois quand les gens ne vont pas bien et quand il y a un problème je n’hésite pas à aller les voir directement et à dialoguer. En revanche quand les choses ne vont pas dans le travail, je n’hésite pas à le dire directement. J’ai vu beaucoup trop de gens qui ne donnent que les bonnes nouvelles et le jour où ils veulent se séparer d’un collaborateur, ils envoient quelqu’un d’autre le dire à leur place. Je trouve cela insupportable. Quand on est manager on se doit de faire les choses agréables et les choses désagréables.
Vous avez animé plusieurs conférences sur le thème du bien-être au travail. Comment expliquez-vous l’engouement général pour cette thématique ?
Le jour où on m’a proposé d’animer un cycle de conférences sur le bien-être au travail, j’ai répondu que cela n’intéressait personne et que la salle serait vide. Et ça a réuni 1 000, puis 2 000 participants. C’est dingue. Je pense que cette préoccupation est devenue centrale car les gens ont compris qu’après le travail, il y a une retraite. Et que ces années qu’on a gagnées en espérance de vie, et qui vont vous permettre de vivre après le travail, il faut les préparer en amont. Les gens ont aussi pris conscience qu’ils étaient en droit d’exiger un certain nombre de choses en matière de qualité de vie au travail. Tous les débats autour du harcèlement, du management agressif, du burn-out ont permis au public de prendre conscience des droits qu’il a et pour les cadres et la hiérarchie, des devoirs. Je pense au droit à la déconnexion. Les nouveaux outils numériques sont certes révolutionnaires mais si vous rentrez chez vous et que vous ne pouvez pas avoir une soirée tranquille sans recevoir des e-mails et SMS envoyés par votre supérieur hiérarchique, c’est insupportable.
Dans ce contexte, quel rôle peut jouer la Médecine du travail ?
Pendant très longtemps la Médecine du travail a été inexistante ou pratiquée par des médecins qui, à la limite, ne voulaient pas faire médecine. Aujourd’hui, elle a un vrai rôle et intervient énormément. De nombreux jeunes deviennent médecins du travail par choix. Ils ont un vrai rôle de prévention. Ils entrent dans le cadre de ce qui aujourd’hui est très important en matière de santé publique, c’est la prévention. Ce n’est pas un gros mot. Le ministère de la Santé travaille beaucoup là-dessus et la qualité de vie au travail, c’est aussi de la prévention.
Quels sont les indicateurs auxquels il faut être attentif avant le burn-out ?
On est toujours très mauvais pour se juger soi-même. Il faut que tout le monde au sein d’une équipe soit attentif aux changements d’humeur d’un collègue. Il faut prêter attention à l’irritabilité, à une personne qui ne paraît pas heureuse en arrivant le matin, alors que jusqu’à maintenant, ça allait plutôt bien. À quelqu’un qui dit qu’il dort mal, qui met plus de temps à faire ce qu’on lui demande et qui paraît vite débordé. Tous ces signes, s’ils arrivent brutalement doivent alerter. Il ne faut pas passer à côté car tant que c’est du pré burn-out, on peut le gérer. Quand on bascule dans le burn-out, c’est déjà trop tard. Il faudrait que les cadres soient davantage formés à la détection de ces signes au sein de leurs équipes mais aussi chez leurs collègues. Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.
Comment peut-on agir ?
Il faut aller voir un médecin du travail qui, on le rappelle, est soumis au secret médical comme tout médecin. S’il transmettait des informations confidentielles à l’employeur, il serait convoqué au Conseil de l’ordre des médecins et pourrait faire l’objet d’une plainte. Aujourd’hui, les médecins du travail n’ont pas le droit de prescrire, mais sont tenus par le secret médical. Avec lui, il est possible d’amorcer un dialogue. Le médecin traitant peut aussi prendre en charge le patient. Il reste que le fait d’alerter permet de consulter rapidement et ainsi de limiter le risque de passage au burn-out.
Ce rôle de prévention est également présent dans une large partie de vos activités. Cette dimension de transmission est-elle importante pour vous ?
C’est ce que j’essaye de faire tous les jours. De la transmission auprès du public, mais aussi auprès de mes pairs et des étudiants en médecine. Je sais que je suis très écouté par les élèves infirmiers et j’ai une vraie responsabilité par rapport à ça. Après je transmets aux auditeurs et au public dans la limite de ce qu’un patient doit savoir. La difficulté de mon travail réside là-dedans. Dire les choses qui peuvent aider les gens et ne pas dire ce qui va trop les inquiéter. Pour moi, c’est devenu un réflexe, je sais où est la ligne jaune.
Vous vous êtes récemment lancé, avec le magazine Dr Good, dans le secteur de la presse, plutôt sinistré. Le succès réside-t-il aussi dans la prise de risque ?
Honnêtement au départ on nous a pris pour des dingues. Sur ce projet j’ai pris un risque car j’y ai associé mon image, mais l’engagement financier a été pris par le groupe Mondadori. À chaque fois que j’associe mon image, je prends un risque que je calcule et que j’essaye de maîtriser. Cela m’excitait vraiment de créer un magazine. Avec mon frère, nous avons eu l’intuition qu’il y avait quelque chose à faire sur le créneau du “feel good”. Tout est parti de là. Sur ce projet, j’ai été très exigeant avec Mondadori, j’ai tout contrôlé et là, je ne délègue pas. Ils m’envoient les articles, je les relis, je les corrige et j’ai exigé de voir toutes les publicités. Les laboratoires comme annonceurs, c’est hors de question. J’ai aussi retoqué des annonceurs qui faisaient des allégations médicales avec lesquelles je n’étais pas d’accord. Cette indépendance est absolument indispensable.