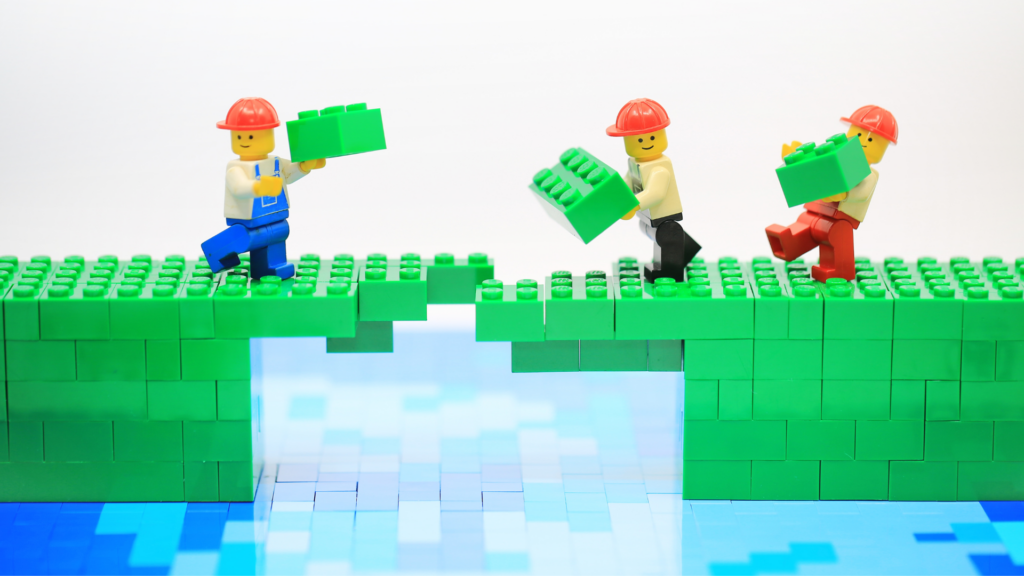Boulimique de travail, Thierry Marx jongle entre ses restaurants du Mandarin Oriental, son nouveau concept de street-food, Marxito, lancé fin 2018 et les formations qu’il propose dans ses écoles de cuisine. Jamais à court de projets, il n’a pourtant pas eu une route toute tracée. Rencontre avec un chef étoilé et engagé qui porte la transmission en étendard. Photos Leo-Paul Ridet
Vous avez eu une scolarité difficile et mis du temps à parvenir à vous faire recruter comme commis. Plusieurs écoles hôtelières et restaurateurs vous ont éconduit du fait de vos origines sociales et de votre parcours scolaire. Vous avez dit qu’il faut “mettre le pied dans la porte” pour créer des opportunités et réussir. Quand on est jeune, avec peu d’expérience à valoriser, comment fait-on pour faire sa place et parvenir à convaincre ?
C’est tout le problème de notre système. Si je prends mon parcours personnel, le décrochage scolaire se produit dès 13 ans. Pourquoi ? Parce ce que je me retrouve dans un collège d’un quartier extrêmement populaire où il n’y a plus de projet. On me disait qu’il fallait apprendre les mathématiques modernes, mais je n’arrivais pas à comprendre à quoi cela allait me servir. Je n’adhèrais pas et je me retrouvais en marge, dans une classe que l’on qualifiait de “transition”. À cette époque, j’ai dit que je voulais faire l’école hôtelière. On me rétorque que ce “n’est pas pour les gens comme moi”, c’est-à-dire que je suis assigné à un quartier. Aujourd’hui, quand on est jeune, l’essentiel est de croire en soi. Mettre le pied dans la porte, c’est tout simplement définir et croire en son projet.
Est-ce que cela ne demande pas un peu de culot ? Vous avez souvent raconté que pour être pris comme commis chez Taillevent, vous aviez bluffé sur votre expérience…
Aujourd’hui ce ne serait pas possible de tricher sur un CV car on peut le vérifier immédiatement. Mais, oui, l’audace paye. Croire en soi paye. Quand vous adoptez une attitude positive, un esprit disponible et éveillé, il est extrêmement difficile que l’on vous dise non.
Avant de vous lancer en cuisine, vous avez eu dans votre parcours plusieurs étapes charnières comme votre passage chez les Compagnons du devoir et votre engagement dans l’armée. Que vous ont apporté ces expériences ?
J’en garde des choses différentes. Les Compagnons du devoir c’est d’abord du mimétisme et de l’apprentissage. Puis c’est de la fierté, car les anciens nous disaient qu’on était l’élite du monde ouvrier. L’engagement dans l’armée m’a appris à lâcher la main du passé. Quand on vit des épreuves difficiles, qu’on les accumule, pourquoi continuer à les tracter ? C’est très compliqué d’adopter cette posture car, bien souvent, on confond patrimoine et passé. Or il ne faut jamais renier le patrimoine car il s’agit de nos origines, c’est ce qui montre d’où l’on vient.
Le sport est très important pour vous. Les arts martiaux, notamment, sont des disciplines qui vous sont chères. Comment les valeurs du sport se traduisent-elles dans votre management ?
Le sport est arrivé très tôt dans ma vie. Notamment le judo où « j’ai fait pour apprendre ». Je vais ainsi comprendre une méthode où il faut apprendre à répéter un geste, par mimétisme. Ce que m’a apporté la pratique de cette discipline c’est de me dire que je suis seul face à moi-même. Quand vous n’arrivez pas à atteindre votre objectif, qu’il y a un certain nombre de problématiques que vous n’arrivez pas à résoudre, le sport vous apprend à essayer de comprendre pourquoi vous n’y arrivez pas. Êtes-vous sur le bon rythme, sur la bonne méthode ? Mais, il n’y a pas de raison de vous maltraiter, car vous avez besoin de votre organisme pour réussir la performance. Tout cela a très probablement forgé ma méthode managériale.
Sur quoi repose votre méthode ?
Le management que j’utilise depuis un certain nombre d’années et avec lequel j’essaie de ne pas tricher repose sur un principe simple qui est d’“être dur avec les faits et bienveillant avec les gens”. C’est une méthode que j’ai comprise et acté dans le sport et que j’essaie de diffuser comme un sachet de thé dans l’entreprise. Concrètement, les faits sont les faits et ils ne sont pas négociables. Mais quand il faut trancher ou prendre une décision, il n’est pas nécessaire d’être un bourreau.
Est-ce vrai que, dans vos cuisines, le silence est de mise ? Pourquoi ? Que recherchez-vous via cette pratique ?
C’est en partie vrai. Mais je ne l’impose pas. Le fait que moi-même j’observe une certaine sérénité pendant les parties opérationnelles permet aux collaborateurs de libérer l’énergie nécessaire à l’expérience client. J’attache beaucoup d’importance à ne pas mettre de tension ou de pression excessive sur les collaborateurs pour qu’ils délivrent le meilleur d’eux-mêmes. Si je mets trop de pression, la peur de l’erreur sera tellement importante qu’ils ne livreront que 50 % de leur capacité opérationnelle et créative. Il ne faut pas oublier que travailler avec des Hommes, au sens large du terme, c’est travailler avec l’univers du vivant. Donc il faut mener un travail sur l’harmonie dans l’entreprise pour que l’ensemble des collaborateurs se sentent heureux, compris, admis et qu’ils aient envie de remplir la mission qui leur est confiée.
Avant l’ouverture du Mandarin Oriental vous avez initié vos salariés au tai-chi pour créer une cohésion d’équipe et éviter le turnover. Être bienveillant passe-t-il par ce genre d’initiatives ?
Est-ce que cela été efficace ?
Cela a été très efficace. En tant que chef d’entreprise, je cherche constamment des astuces managériales qui ne soient pas des gadgets. Le tai-chi était un moyen de sensibiliser les collaborateurs à la méditation et au sport. Car quand vous vous mettez à la méditation vous comprenez qu’il faut installer du temps entre vos émotions et vos actions. La société nous impose bien souvent une pression excessive et ne nous laisse pas le temps pour cela. Avec le tai-chi, j’ai voulu créer du lien social et faire comprendre que l’on est beaucoup mieux les uns avec les autres que les uns contre les autres. Dans ce contexte, c’est aussi plus simple de leur dire “n’ayez pas peur de vous tromper parce que l’erreur n’existe plus entre nous”.
Votre management laisse donc la place à l’erreur. Comment aidez-vous vos équipes à dépasser ces échecs ? La restauration est connue pour être un milieu difficile : avoir un management bienveillant, est-ce si simple ?
J’ai mis très longtemps à mettre cette technique en place. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant “tiens je vais être méditatif et bienveillant”. J’ai vécu des moments de tension et je me suis aperçu rapidement que cela ne produisait rien d’efficace. Je me suis dit que pour décrisper les choses il ne faut plus parler d’erreur. Car pour moi l’erreur est quelque chose qui n’a pas de sens. Par contre, en adoptant un autre vocabulaire et en parlant d’opportunité on fait évoluer notre vision. L’intérêt est de se dire que, quand une mauvaise situation arrive, les collaborateurs doivent être en mesure d’améliorer les choses par eux-mêmes et donc d’améliorer l’expérience client. Je trouve cette façon de faire plus enrichissante que de contraindre mes équipes à ne jamais faire d’erreur. C’est traumatisant et au final, ce que vous gagnerez, c’est que les collaborateurs vous quitteront.
Votre philosophie est de voir le verre toujours à moitié plein. Vos proches disent même de vous que vous êtes un “inconscient positif” car vous ne baissez jamais les bras. En quoi est-ce important de prendre continuellement des risques ?
Je n’ai pas le choix car je ne suis pas un héritier et je viens d’une extraction sociale à qui on ne prêtait pas d’argent. On est dans un monde volatile, incertain et complexe, donc oui, à un moment donné, il faut prendre des risques, croire en soi et aux autres qui sont autour de vous. C’est un peu la loi des 80/20 : vous avez préparé les choses à 80 % puis il y a 20 % d’imprévus, c’est la mer de l’incertitude. Vous avez deux solutions, soit vous restez sur la rive soit vous acceptez de traverser.
Vous arrive-t-il de renoncer à un projet ?
Cela ne m’est pas encore arrivé. Je ne sais pas pourquoi. Je m’y suis parfois pris à plusieurs fois, abstenu, mis en état stationnaire mais finalement, j’ai toujours gardé la même détermination. C’est ce que m’a appris la pratique des sports comme la boxe ou l’escrime au sabre. Car ce sont des disciplines qui demandent de prendre le temps d’observer.
Vous avez été précurseur car vous faites partie des chefs qui ont démocratisé la cuisine moléculaire. Vous avez même été parfois critiqué pour cela. En quoi est-ce important d’innover ?
L’innovation c’est le cœur et le poumon de l’entreprise. Une entreprise qui n’innove pas mourra. Avant, elle mettait 30 ans à disparaître mais aujourd’hui cela se fait beaucoup plus rapidement. En revanche, quand vous innovez et que vous voulez être créatif, il faut avoir un gros mental. Schopenhauer disait qu’une innovation est d’abord moquée, puis elle est durement critiquée et ensuite elle est adoptée comme une évidence. Aujourd’hui, cela n’a pas changé. Quand, en 2004, on créé le Centre d’innovation culinaire (CFIC) avec Raphaël Haumont, on nous disait que la cuisine moléculaire c’était du pipeau, une tendance bidon, etc. Alors que pas du tout. Aujourd’hui, grâce à ce centre d’innovation, des enseignants chercheurs et une vingtaine d’élèves travaillent sur la gastronomie de demain et sur quelle forme elle prendra en 2050.
Pour vous, la transmission est très importante. En témoignent vos interventions dans le milieu carcéral et les formations gratuites de cuisine que vous avez déployées dans plusieurs villes françaises. En quoi transmettre votre savoir-faire, votre vision de la cuisine et du management est essentiel ?
C’est environnemental. Une société qui ne fait pas attention et qui laisse sur le bas-côté des personnes sans projet, c’est extrêmement dangereux. Quand vous n’avez pas de projet, vous êtes prêts à suivre le premier gourou qui passe. D’un côté, il y a ceux qui ont cette capacité d’“apprendre pour faire”, qui ont une scolarité impeccable et pour qui la voie est toute tracée. De l’autre côté, il y a ceux pour qui c’est plus difficile et qui sont dans le “faire pour apprendre”. Ces personnes, il faut les considérer et les intégrer de la même façon que les autres et le plus vite possible. Les formations Cuisine mode d’emploi(s) c’est 92 % de retour à l’emploi et en moins de huit ans, cela a permis 70 créations d’entreprise par des personnes qui se croyaient assignées à un quartier et à l’échec. Voilà ce qui m’anime.
Tendre la main à des personnes qui étaient dans votre cas est-ce, en quelque sorte, une revanche ?
On m’a beaucoup taxé d’être revanchard. J’ai changé volontairement pour qu’on ne me dise plus cela. Je n’apprends rien à personne en disant que la société n’est pas juste et que nous sommes tous différents et inégaux face à la vie. Par contre, je suis convaincu que l’on va gagner du temps et de l’efficacité en arrêtant de chercher des coupables et en trouvant des solutions. Je pense sincèrement que le monde de l’entreprise a son rôle à jouer dans l’intégration et dans l’inclusion des personnes en investissant notamment dans des centres de formation.
Vous parliez de ne pas s’attarder sur le passé. Vous-même quand vous recrutez des collaborateurs, vous dites souvent que la lecture d’un CV vous ennuie et que vous portez peu d’attention aux compétences. Les “soft skills” sont-elles pour vous primordiales ?
J’ai deux questions quand je recrute. La première est “pourquoi voulez-vous travailler avec moi”? J’ai parfois des réponses très Wikipédia mais ce n’est pas très grave car cela créé de l’échange. La deuxième, et c’est la plus importante à mes yeux, est “où vous voyez-vous dans deux ans”? Je la pose tout simplement parce que j’aime les gens qui ont de l’ambition. J’aime quand on me dit que, dans deux ans, on sera à ma place.