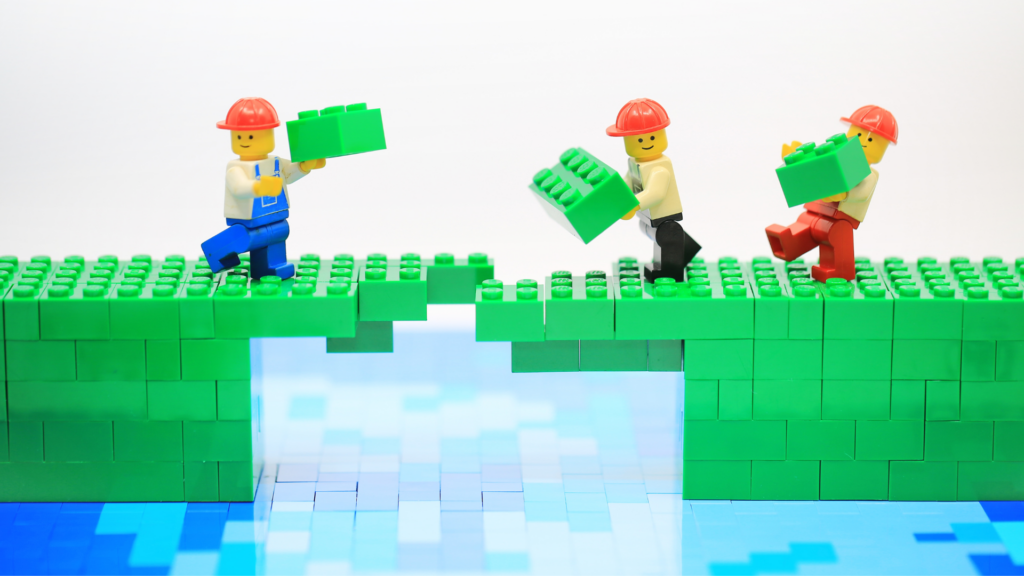Emblématique de cette nouvelle génération d’entrepreneurs et de dirigeants, Anne-Laure Constanza est la présidente et fondatrice des sites Envie de Fraises et Scarlett (Digital Fashion Group). Une chef d’entreprise qui n’a pas peur de parler d’ambition et de prise de risque.
Vous êtes marraine de 100 jours pour entreprendre et de l’opération “Tu veux monter ta boîte, gagne-la !”. Pourquoi avoir accepté de soutenir ce projet ?
Depuis que j’entreprends, j’ai toujours eu la volonté de m’engager sur la cause de l’entrepreneuriat. Soutenir la création pour les jeunes était pour moi quelque chose de très important. Il y a encore quelque temps, les trois quarts d’entre eux disaient qu’ils voulaient être fonctionnaires*. Porter une démarche comme celle-là qui prône à la fois l’audace, l’envie d’aller de l’avant, le risque et l’aventure, était pour moi une évidence.
Cela signifie-t-il qu’on ne véhicule pas suffisamment l’audace chez les jeunes ?
Tout à fait. En règle générale d’ailleurs, on ne donne pas une image très positive de l’entreprise. La France est un peu en retard même si des progrès sont faits. Je trouve que dans les écoles, on ne prône pas encore assez (parfois pas du tout), la création d’entreprise comme une possibilité d’épanouissement professionnel. Cela reste quelque chose de lointain. En tant que bénévole pour l’association 100 000 entrepreneurs (qui se rend notamment dans les lycées pour insuffler l’idée de la création), j’ai pu m’apercevoir que ce que les jeunes imaginent est très loin de la réalité.
Quels sont ces préjugés sur l’entreprise ?
C’est surtout vis-à-vis des patrons. L’image est encore celle d’une personne éloignée des salariés, de quelqu’un qui profite d’eux. Alors que l’entreprise est aujourd’hui le seul moteur de l’emploi en France, en particulier les entreprises innovantes. Il ne faut pas l’oublier. Et puis l’échec est vu très négativement dans l’Hexagone, alors que c’est quelque chose de quasiment obligatoire pour un entrepreneur qui veut réussir aux États-Unis. Véhiculer une image positive de personnes qui vont de l’avant, qui prennent des risques, qui avancent, montrer cela à la jeune génération, je trouve que c’est vraiment important.
Avant de vous lancer dans la création d’entreprise, vous avez travaillé en Chine ? Pour quelles raisons ?
J’ai fait les Langues O’ (Institut national des langues et civilisations orientales, ndlr). J’étais passionnée par la Chine donc j’ai étudié le chinois, ainsi que la politique et l’économie du pays. J’ai également fait un cursus en commerce international entre la France et la Chine. J’étais entre les deux pays et j’ai décidé d’y rester. La Chine représentait une passion depuis toute petite. Mes parents m’avaient promis que si j’avais mon Bac scientifique avec mention, toute ma famille se cotiserait pour m’offrir un billet pour Pékin. C’est ce qui s’est passé. À mon retour, j’ai décidé de laisser tomber la Fac de médecine pour apprendre le chinois et connaître ce peuple. Quelque part, c’était aussi une forme d’entrepreneuriat. J’avais le sentiment d’entreprendre ma vie en faisant des choix qui étonnaient tout le monde. Je voulais vivre mes rêves. C’est très profond chez moi, je n’ai pas peur de l’échec. Cela me permet d’essayer de les réaliser.
En Chine, vous avez travaillé pour des maisons de couture françaises comme Jean-Louis Scherrer. De quelle manière êtes-vous entrée dans ce milieu ?
Encore une fois, j’y suis arrivée grâce à mon audace. Je voulais participer au rayonnement de la France à l’étranger. À l’issue de mes études, j’ai donc envoyé un courrier aux quatorze présidents des 14 maisons de haute couture en France et ma lettre est tombée entre les mains de François Barthes. Il dirigeait le groupe EK Finances dont la marque Jean-Louis Scherrer. Il était à ce moment-là en négociation avec des Chinois. Comme lui-même était autodidacte, il m’a reçue. Nous avons passé trois heures ensemble et j’ai démarré comme cela. Il m’a confié à 23 ans la responsabilité du marché chinois pour une marque de luxe. Ce qui était totalement incroyable. Après Jean-Louis Scherrer, j’ai travaillé pour Angelo Tarlazzi. J’étais basée en Mongolie intérieure. C’est là que j’ai découvert tous les rouages de la production textile en Chine et j’ai adoré ça. Je suis vraiment tombée dedans. Ensuite, j’ai créé en 2003 ma première société. C’était une société de conseil spécialisée sur la Chine. Le but était d’aider les entreprises françaises à s’implanter sur le territoire. Et à l’inverse, mon rêve sous-jacent était de faire connaître le “made by Chinese” en France. Plutôt que le “made in China” qui n’avait pas une bonne réputation je voulais promouvoir les talents chinois, les designers, les stylistes, l’art en règle générale. Mais en 2003,c’était encore très tôt. Très vite je me suis dit qu’il fallait que je change de métier. Et c’est enceinte, que j’ai découvert la pauvreté de l’offre sur le marché des vêtements de grossesse. J’ai donc décidé de me lancer.
Une maman qui crée un site de vêtements pour femmes enceintes, n’est-ce pas un peu caricatural ?
Complètement, même si sur Internet cela l’était un peu moins. Au tout départ effectivement, quand je suis allée voir les banques pour présenter mon projet, leur dire qu’en tant que jeune maman je voulais créer une marque pour femmes enceintes, mes interlocuteurs me prenaient pour une folle qui avait un délire post-natal. Mais cela a très vite changé à partir du moment où j’ai montré des chiffres. Ils révélaient qu’il y avait un vrai marché, qu’on était en croissance, que cela explosait. À tel point que pour ma première grosse levée de fonds, alors que j’étais enceinte de jumeaux, aucun des investisseurs ne m’a posé la question : “Comment vas-tu t’organiser pour l’après ?”. Ils avaient confiance en moi.
Les débuts ont-ils toutefois été durs à gérer ?
Je ne dormais pas. Je consacrais tout à mon enfant et à ma boîte. Je n’avais plus de vie sociale, mais je considère qu’il s’agissait des années indispensables pour bâtir un socle vraiment solide. Sans travail acharné, je n’aurais pas pu construire tout cela. Les trois premières années sont cruciales pour tout entrepreneur. Et c’était le prix de la liberté, j’en étais totalement consciente. Je le vivais avec beaucoup de fatigue, émotionnellement notamment, mais avec beaucoup de passion.
Vous qui vouliez promouvoir le “made by Chinese”, vous avez décidé il y a quelques années de rapatrier la grande majorité de la production en France. Quelle part cela représente-t-il aujourd’hui et pourquoi ce choix ?
Quand j’ai démarré Envie de Fraises, fin 2006, j’avais monté un atelier de confection à Pékin. À partir de 2008, nous avons relocalisé en France. Encore une fois les gens m’ont prise pour une dingue. Il a fallu que je fasse ce choix contre tous. C’était purement économique, ce qui paraissait encore plus fou. Les femmes enceintes sont une cible fugace, j’ai très peu de temps (4 mois environ) pour faire en sorte qu’elles achètent et les fidéliser. Si durant cette période je ne suis pas capable de les livrer à temps, si j’ai des ruptures de stock ou si je ne peux pas leur apporter des nouveautés pour les faire revenir, ce n’est pas bon. L’idée était donc d’avoir une production locale, de manière à être extrêmement agile et réactif. Aujourd’hui, nous avons vraiment développé un modèle de Fast fashion, adapté au Web, avec seulement 17 jours entre le moment où le produit est imaginé et le moment où il est en stock. Cela représente près de 95 % de notre production mais nous n’arriverons pas à 100 % car certaines spécificités sont très dures à trouver en France.
Cela a-t-il été difficile de rapatrier la production ?
Très difficile. Il a fallu convaincre les industriels que le projet allait marcher. Il y avait des clichés autour du Web qui avait une image de discount, on me rétorquait aussi qu’on ne pouvait pas réellement créer une marque sur Internet. Il y a eu beaucoup de freins. Je me suis battue et nous y sommes arrivés. Les industriels avaient tout intérêt à travailler avec nous, dans la mesure où nous leur confiions des productions tous les jours, même si au départ les quantités n’étaient pas énormes. La difficulté d’un acteur du textile, ce sont les aléas de la production, avec de grands pics puis plus rien. Les périodes où les ouvrières n’ont pas de travail coûtent beaucoup d’argent, moi je leur offrais la possibilité d’avoir un flux continu. Il a fallu qu’ils le comprennent, et aujourd’hui ils en sont très satisfaits. Nous faisons également appel à des filateurs de tissu qui travaillent avec nous. Sur les 95% de produits fabriqués en France, 50 % sont également issus de tissus “made in France”. Mais attention, je n’ai pas le“made in France” revendicatif. La production locale est pour moi une vraie stratégie économique. Si demain nous avons des taxes immenses, je ne sais pas si je pourrai encore produire en France. Digital Fashion Group, qui compte aussi la marque Scarlett (vêtements et lingerie grandes tailles) reste un groupe indépendant.
Est-ce difficile de résister ?
Les mastodontes, je les ai toujours eu en face de moi, mais ils ne sont pas spécialisés. Ces entreprises sont elles-mêmes attaquées sur leur cœur de cible. Donc les vêtements de grossesse par exemple ne sont pas au centre de leur stratégie. C’est notre savoir-faire unique qui nous protège. Quand on est focalisé sur une niche, on vit pour elle, et on est plus performant qu’un généraliste. En outre, si on vit au travers de la concurrence, on ne fait plus rien,il faut être agile, prendre des risques, parfois on échoue, mais le risque est plus grand de ne rien faire.
Quelle est votre vision du management ?
Point numéro 1 : on doit tous les jours s’enrichir du feed-back des clients, de leur expérience et penser client. Autre élément important pour moi, les erreurs doivent être retenues pour ne pas les reproduire. Ensuite, je souhaite que les salariés eux-mêmes soient passionnés, pour qu’ils innovent. Beaucoup de produits et d’innovations dans nos process sont faits par les collaborateurs utilisateurs. Ils se sentent ainsi eux-mêmes emplis d’une vocation à innover qui est très valorisée au sein de l’entreprise.
Existe-t-il à vos yeux un management au féminin ?
Je ne suis pas très à l’aise avec ces notions, et ma tendance naturelle serait plutôt de dire que cela n’existe pas. Je ne crois pas tellement qu’il y ait une différence. Il n’y a pas de management au féminin, comme il n’existe pas d’entrepreneuriat au féminin. Mais j’ai été très peu managée dans ma courte vie de salariée donc je manque de recul. En revanche, en tant que maman, j’ai mis en place des solutions d’aide à la conciliation vie privée et vie professionnelle. J’ai mis une charte de la parentalité en place très appréciée par les salariés, mais je connais aussi des hommes qui le font. Beaucoup d’entrepreneurs aujourd’hui jouent le jeu.
Vous avez fondé l’association Mompreneurs France. C’est un phénomène que les médias ont beaucoup relayé ces dernières années, mais est-il toujours d’actualité ?
Je me suis éloignée de cette association dans un moment où je ne me sentais plus du tout proche de l’image qui avait été véhiculée de ce phénomène. Au départ, j’ai voulu lancer ce réseau amical et de lobbying auprès des pouvoirs publics, car je souhaitais promouvoir l’entrepreneuriat au travers des jeunes mères. L’idée étant de leur faire bénéficier d’un fonds de garantie à l’initiative des femmes qui existait déjà et de faire sauter le plafond fixé (27 000 euros maximum, ndlr). J’ai milité pour cela. Et encore aujourd’hui, je ne manque jamais une occasion de le faire quand je vois un ministre, comme récemment Arnaud Montebourg. J’en suis partie parce que la boîte commençait à exploser, nous étions en très forte croissance et j’étais enceinte de jumeaux. Il me fallait donc gérer à la fois ma boîte, les recrutements, la croissance, l’arrivée de mes jumeaux, une levée de fonds plus une association, dans laquelle finalement je ne me retrouvais pas, c’est pourquoi j’ai décidé d’arrêter. Je ne suis pas WonderWoman ! Surtout, je n’aimais pas l’image véhiculée et qui sous-entendait qu’on pouvait réussir sans travailler beaucoup. Ce qui est totalement à l’opposé de la réalité. Pour qu’une entreprise réussisse, il n’y a pas de secret. Ce n’est pas en travaillant de manière un peu aléatoire entre deux biberons qu’on y arrive. On peut en vivre, mais on ne crée pas une société, simplement son propre emploi. Ce n’est en rien un jugement de valeur, mais on n’est pas du tout dans la même démarche. Il ne faut pas espérer créer de cette façon une entreprise leader, qui grandisse. Quand j’ai échoué la première fois, je me suis dit que j’allais remonter quelque chose mais j’avais des convictions fortes. Je ne voulais pas créer une marque sympa et en rester là. Il me fallait de l’ambition, faire de ma boîte un leader. En revanche, Sonia Rykiel a créé quand elle était enceinte, elle a eu ses idées au moment de sa grossesse. Aliza Jabès vous dira que quand elle a créé Nuxe, c’est parce qu’elle avait envie d’une huile. Cela correspond souvent à la trentaine et l’arrivée d’un enfant chamboule tout. C’est un phénomène normal et c’est toujours vrai.
* Sondage Ipsos de mars 2012, 73 % des 15-30 ans aimeraient devenir fonctionnaires s’ils en avaient l’occasion.