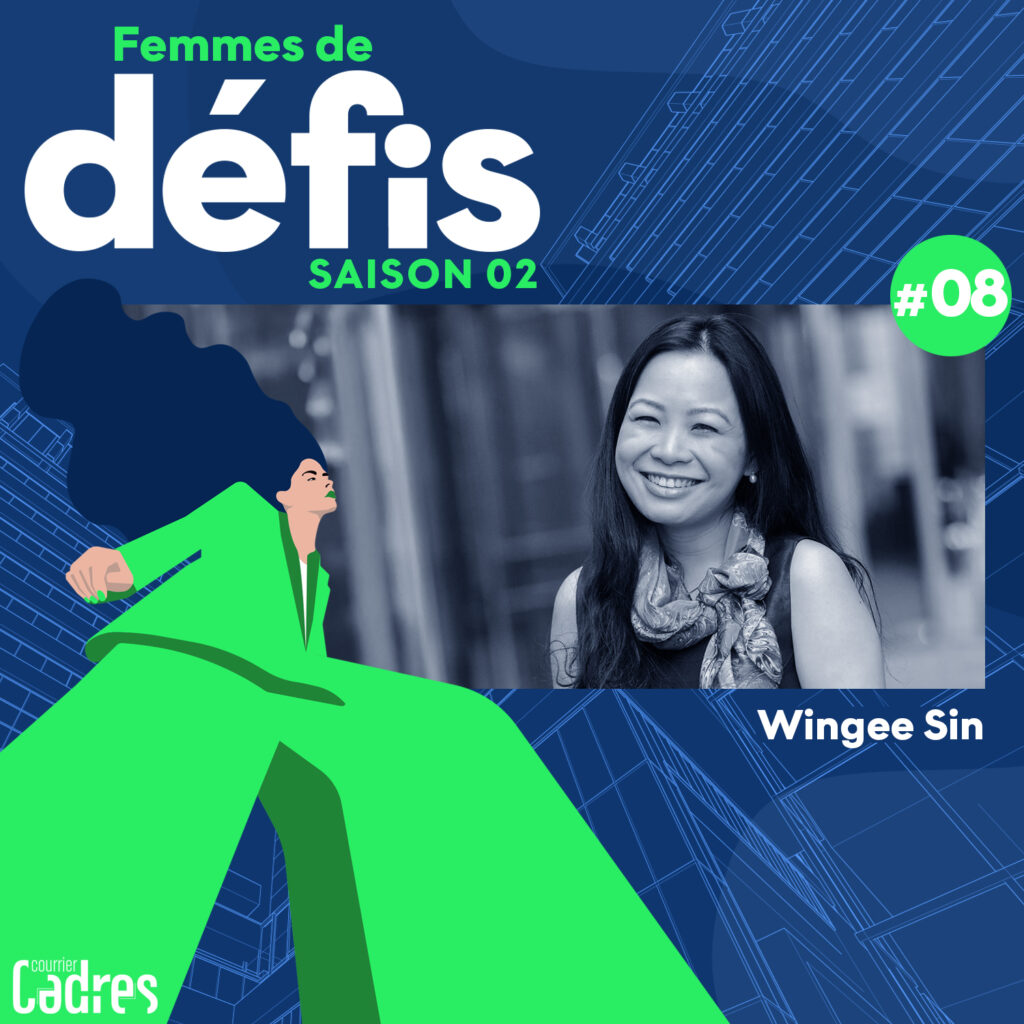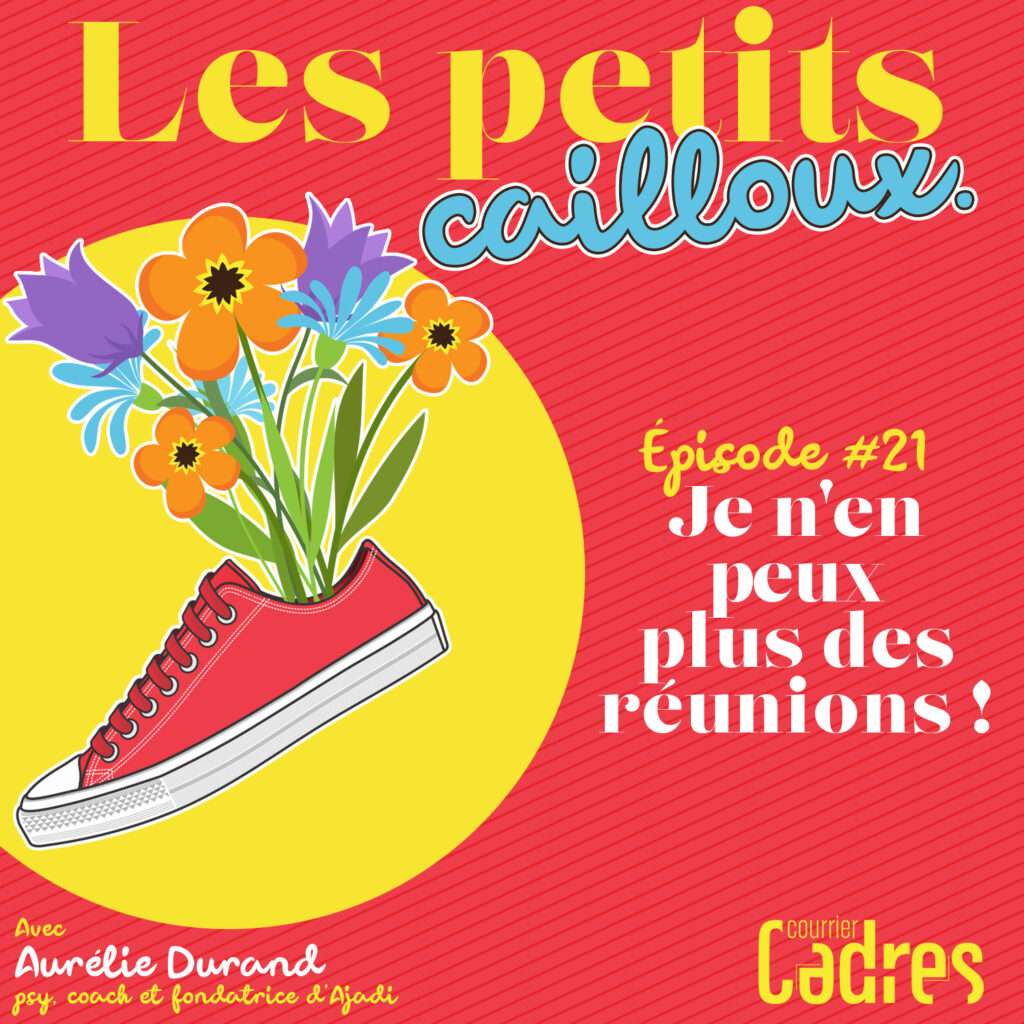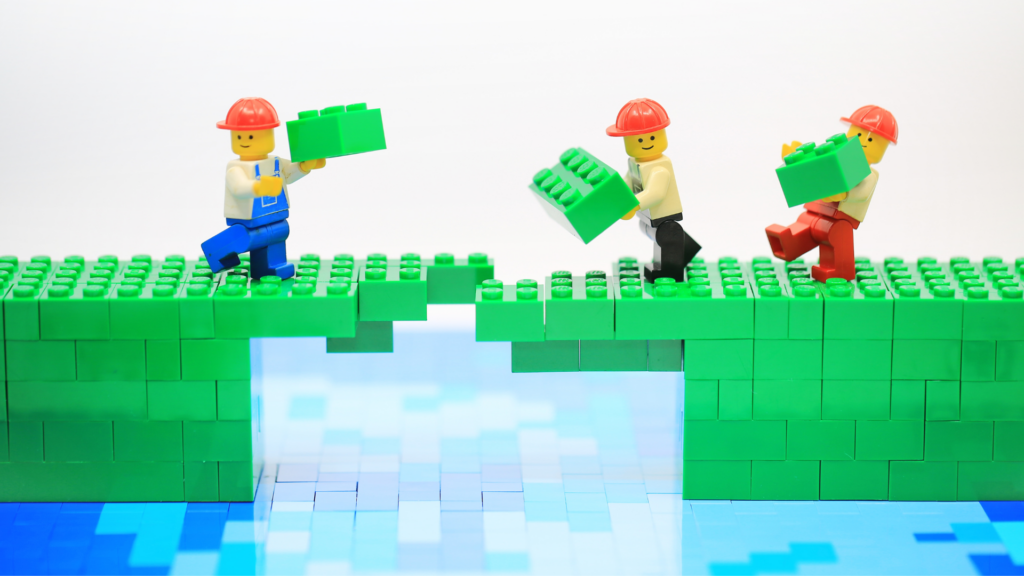Avec l’arrivée de Netflix, certains concepts issus de la fameuse université de Stanford, en Californie, ont refait surface. La captologie, ou captology, en anglais, pour “computers as persuasive technologies”, fait partie de ceux-là.
Utilisé en 1996 pour la première fois par le chercheur B.J. Fogg, le concept originel de captologie (ou captology, en anglais, pour “computers as persuasive technologies”) semble se confondre désormais avec celui plus récent de netflixisation. Erreur.
“On utilise la captologie à travers l’utilisation de technologies numériques pour faire faire aux individus des actes précis. En cela, on peut utiliser la captologie pour encourager une personne à prendre ses médicaments, à faire du sport, à faire ses devoirs, à balayer son agenda… La netflixisation est une application de captologie car elle s’intéresse à la suggestion de contenus audiovisuels afin de vous faire utiliser le plus possible Netflix. Utiliser des mots comme netflixisation ou uberisation nous biaise sur la signification réelle du terme et ses applications”, explique Aurélie Jean, Docteur en sciences et spécialiste des algorithmes.
La fabrique de l’addiction
La chercheuse poursuit : “On utilise déjà la captologie en encourageant les consommateurs à rester plus longtemps sur un site Internet, à visiter certaines pages, à se voir proposer des produits et des services…” De son côté, Sandrine Matichard, content & insights director au Hub Institute souligne, elle aussi, la nécessité de ne pas confondre les deux concepts : “La netflixisation, c’est une technique d’addiction basée sur la personnalisation, l’abondance du choix et sur les émotions du spectateur, identifiées et gérées grâce à l’IA. La captologie est à mon sens un terme plus large qui embrasse toutes les formes de créations d’addiction, y compris l’efficacité fonctionnelle (les boutons d’action, le scroll infini, etc.)”