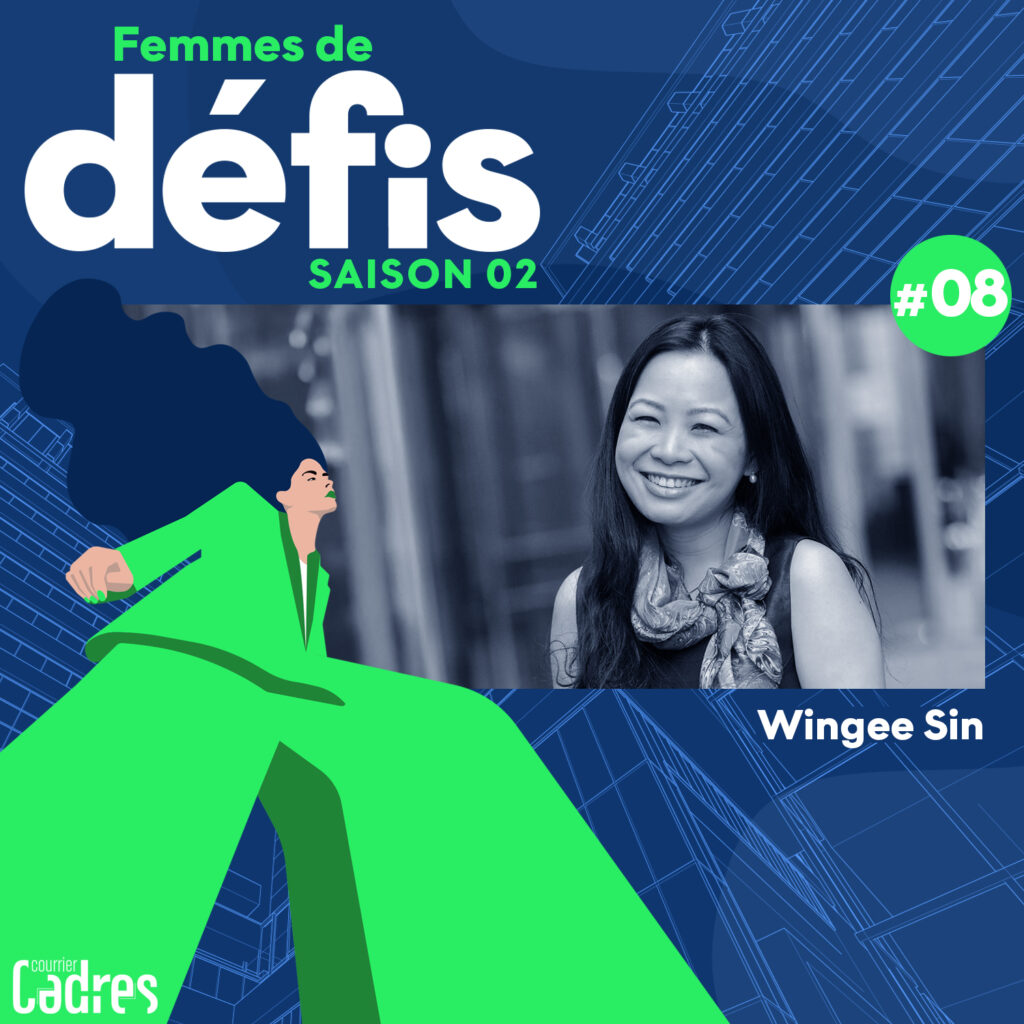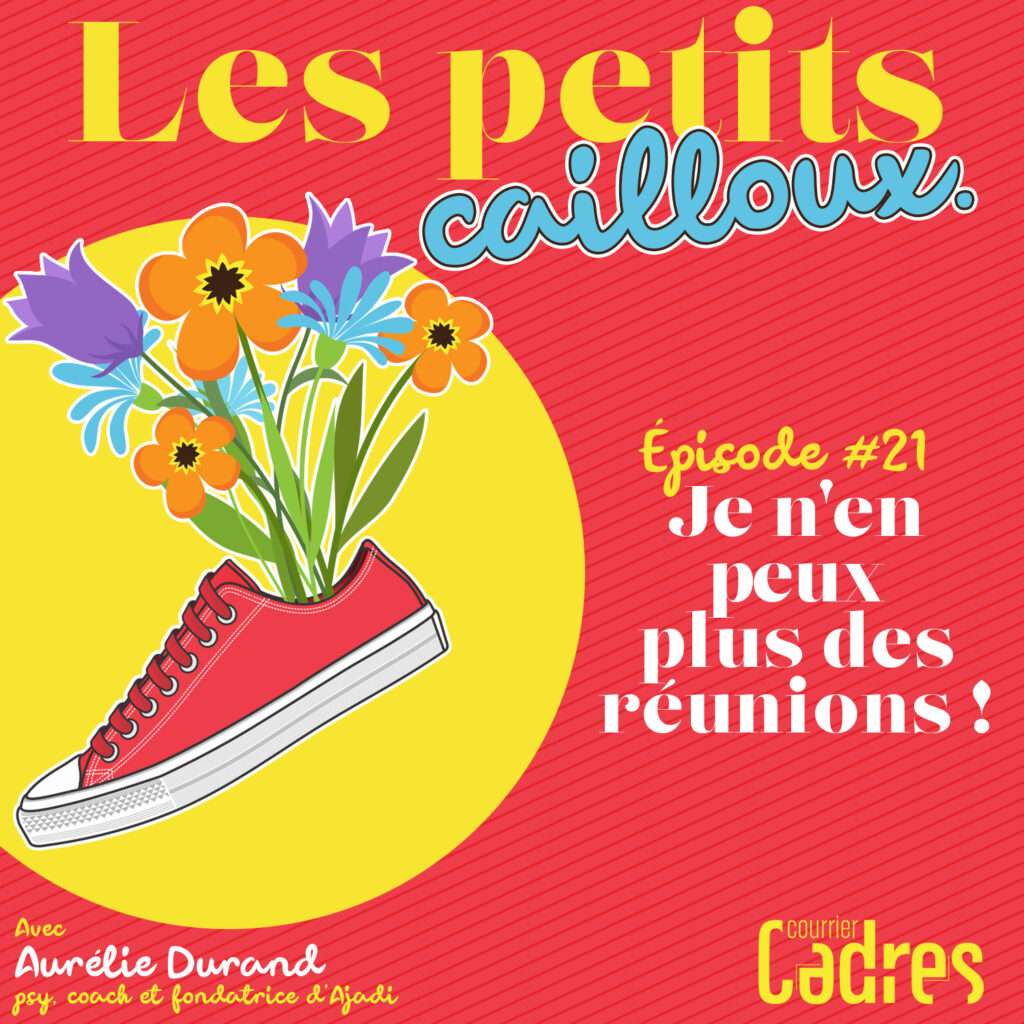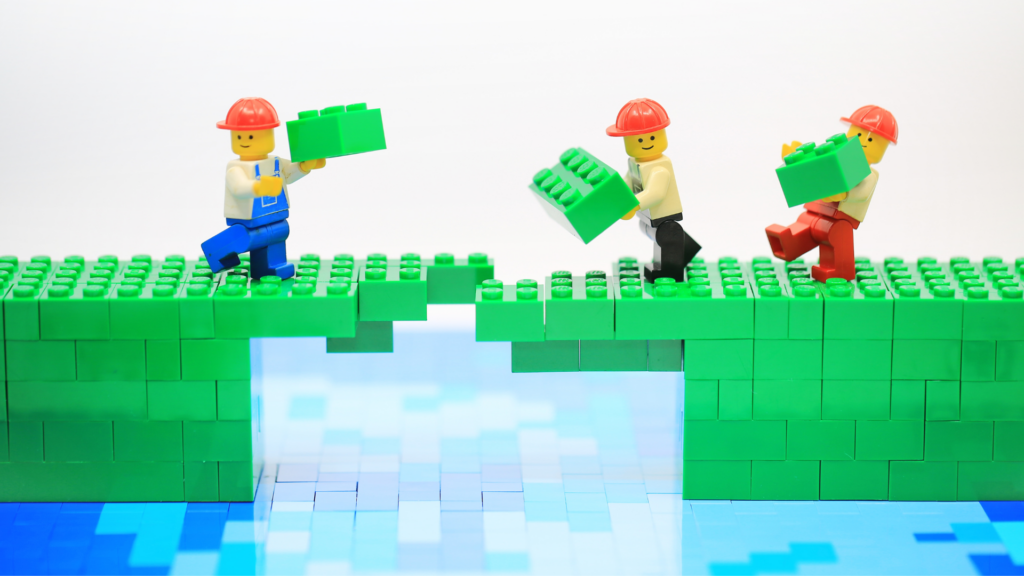Cotisations, âge pivot, caisse complémentaire : alors qu’Emmanuel Macron a réitéré le 14 juillet sa volonté de relancer la réforme des retraites, faisons le point sur l’impact que devrait avoir le “système universel” sur les cadres.
A la mi-mars, lors de sa seconde allocution sur l’épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron avait annoncé la suspension de toutes les réformes en cours, dont celle des retraites. Mais le président ne semblait pas avoir abandonné l’idée. Lors de son interview du 14 juillet 2020, il a finalement confirmé que son projet restait à l’ordre du jour.
Une réforme renvoyée à l’après-Covid-19
Alors que les syndicats l’exhortent à ne pas remettre cette réforme sur la table tout de suite, il a confirmé que “la priorité de cet été et de la rentrée prochaine, c’est l’emploi”. Et donc que le dossier des retraites, qui sera abordé par le nouveau Premier ministre Jean Castex avec les partenaires sociaux vendredi 17 juillet, ne devrait être revu qu’une fois l’épidémie définitivement terminée. Sachant qu’un vaccin ne devrait être prêt et disponible en quantité suffisante qu’en 2021, et que le quinquennat s’achèvera en mai 2022.
“Je crois que cette réforme est juste. Il faut peut-être lui donner un peu plus de temps, mieux la concerter. On doit la remettre sur l’ouvrage”, a indiqué Emmanuel Macron lors de son interview.
Concrètement, la réforme des retraites consiste en la création d’un “système universel” d’ici 2025, avec le remplacement des multiples barèmes de calcul des retraites et des régimes spéciaux par un régime unique, où chaque euro cotisé serait converti en points tout au long de la carrière.
La fin de l’Agirc-Arrco
Ce nouveau système signerait d’abord la fin de l’Agirc-Arrco. Ce qui ne manque pas d’inquiéter les syndicats de cadres, le gouvernement entretenant le flou autour de l’avenir de la réserve de cette caisse complémentaire, évaluée à 71 milliards d’euros.
“Sans réserve, le régime sera déséquilibré et fragilisé : les cadres supérieurs, qui paient aujourd’hui des cotisations jusqu’à 8 plafonds de la Sécurité sociale (soit 320 000 euros bruts par an), devraient à partir de 2025 ne payer que 3 plafonds. En règle générale, ce sont 300 000 personnes qui cotisent 4 milliards d’euros par an, et qui ne le feront plus pour leurs caisses supplémentaires Agirc-Arrco. Résultat, il faudra puiser dans les réserves pour palier les déficits de cotisation, au lieu de constituer une sécurité en cas de crise économique”, déplore Pierre Roger, délégué national à la protection sociale de la CFE CGC.
“L’Agirc-Arrco permettait de garantir aux cadres le maintien de leur niveau de vie. Alors que le nombre de retraités augmentera de 37 % en 2050, le niveau de financement du système devrait rester à ressources constantes, ce qui se traduira par un effondrement du niveau des pensions par rapport aux salaires de fin de carrière… pour le plus grand bonheur des banques et des assurances”, note de son côté Sophie Binet, co-secrétaire général de l’Ugict-Cgt.
Une baisse des cotisations
Si la réforme devrait se traduire par une augmentation des cotisations retraite (et donc du pouvoir d’achat), elle risque aussi d’entraîner pour les cadres une baisse de ces mêmes cotisations. En effet, le taux de cotisation devrait être identique pour les salariés (28,12 %), mais s’appliquer jusqu’à 120 000 euros de revenus (soit trois fois le plafond de la Sécurité sociale). Au-delà, une “cotisation de solidarité” de 2,81 % s’appliquera. Elle ne sera pas créatrice de droits et participera au financement de la solidarité.
“Les cadres supérieurs paieront moins de cotisations, ce qui signifiera aussi moins de droits à la retraite, donc des pensions finalement plus faibles”, s’inquiète Sophie Binet.
Un âge pivot à 64 ans
L’âge pivot à 64 ans, mesure phare de la réforme, signifie enfin qu’à 64 ans, un travailleur pourra partir en retraite, avec son taux plein. Mais le nouveau système par points étant calculé sur toute la carrière, et non plus sur les 25 meilleures années, les cadres pourraient être impactés.
“Celles et ceux qui ont eu des carrières ascendantes seront particulièrement perdants et pénalisés. Plus vous aurez un salaire de fin de carrière éloigné de celui du début, plus vous serez défavorisé”, indique Sophie Binet. “Le projet risque, petit à petit, d’inciter à la capitalisation et à l’épargne individuelle”, estime de son côté Pierre Roger.
En janvier, le gouvernement n’excluait pas de retirer l’âge pivot du projet de loi. Il chargeait une “conférence de financement” de trouver les mesures nécessaires à son remplacement, entre mars et mai. Ce projet a été abandonné avec le coronavirus. Mais Emmanuel Macron continue de se dire “ouvert sur le sujet”. Ne fermant pas la porte, notamment, à une augmentation du nombre de trimestres travaillés.
Vers un déclassement des cadres ?
Finalement, les deux syndicats s’inquiètent d’un “déclassement” à venir pour les cadres. “C’est un système qui se veut redistributif, mais qui pénalisera une partie de la population, en particulier les personnels d’encadrement et les carrières ascendantes. Nous serons les premiers perdants dans cette affaire, alors que nous n’avons jamais demandé à moins cotiser”, indique Pierre Roger. “Ce qui se profile finalement, c’est une baisse programmée des pensions, avec un départ à la retraite des cadres vers 70 ans, pour une maigre retraite”, résume Marie-José Kotlicki, dirigeante de l’Ugict CGT.
“Pour nous, la remise sur la table de ce dossier est clairement la volonté du président Macron, qui veut avant tout se présenter en 2022 comme un grand réformateur. Il prend le risque de relancer des troubles sociaux, faisant peut-être le pari que la pandémie et la crise économique retiendra la contestation. Pour nous comme les autres organisations syndicales, la priorité est la relance”, conclut Pierre Roger.