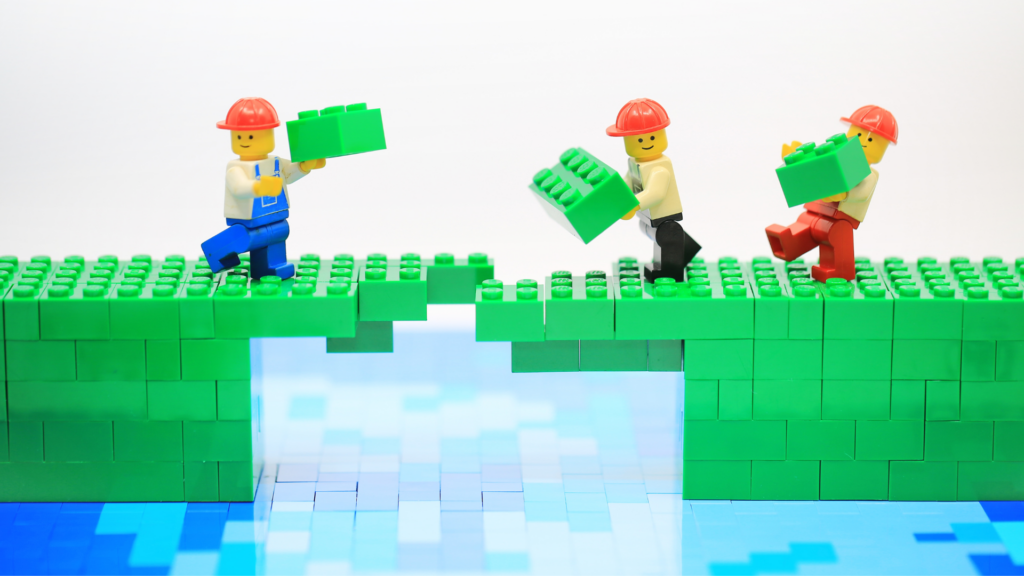50 ans déjà que Chantal Thomass ose. De ses uniformes d’écolière retouchés avec sa mère couturière à ses premières robes vendues l’été à Saint-Tropez, de la remise au goût du jour de la lingerie des années 30 ou 50 à ses collaborations avec Tati ou plus récemment le Crazy Horse, celle qui vient de publier son autobiographie (Sens dessus dessous, paru chez Michel Lafon) a fait de l’audace sa signature. Portée par une communication et des codes forts, la créatrice à la frange incarne la marque jusque dans son logo. Celle d’une femme libre, même dans les coups durs.
Vous avez toujours osé dans vos créations et n’avez pas hésité dès 1967 à vous faire émanciper pour créer votre première marque de prêt-à-porter Ter et Bantine. Quelle place accordez-vous à l’audace dans une carrière ?
Je pense qu’il faut surtout avoir de l’inconscience ! Car avec le recul, on se dit que ce qu’on considérait comme de l’audace était en fait de l’inconscience…
Qu’est-ce qui selon vous doit guider le processus de création, faut-il suivre les attentes de la clientèle ou s’écouter ?
Le seul mode de création qui me séduit, c’est m’écouter, m’inspirer de choses diverses comme un film, des expositions. J’aime également beaucoup aller dans les usines, toucher la matière. L’objectif est de donner vie à quelque chose de différent, créer ce n’est pas aller dans le sens du vent. On vit à une époque du marketing, on travaille à la demande, par rapport à des tendances. Ce n’est pas ma manière de fonctionner.
Est-ce vraiment possible aujourd’hui de faire autrement ? Le marketing n’a-t-il pas tué la créativité ?
C’est difficile. Oui, je pense que le marketing a un peu tué la création. Mais cela va revenir. Je vois plein de petites marques qui sortent, qui démarrent comme j’ai démarré il y a 40-50 ans. Plus on ira vers une mode de masse, plus il y aura des petites entreprises qui vont trouver une idée et se différencier. Tant mieux.
Faut-il parfois savoir aller contre l’air du temps ?
Oui, il faut aller selon ses envies ! Il faut pouvoir rêver. Je ne regarde jamais les carnets de tendances, alors que tout le monde maintenant vit avec ça. Je ne vois pas l’intérêt de faire ce que tout le monde fait.
En tant que créatrice, arrivez-vous à faire passer cette audace dans un grand groupe comme Chantelle, propriétaire de la marque ?
Ce n’est pas très facile. Parce qu’il y a aussi des contraintes de prix, de construction de collection, qui sont bien plus dures que ce que j’ai pu connaître par le passé – je crois que c’est partout pareil. Mais nous avons des codes de marque, il y a des choses que l’on attend de nous, qui ne sont pas automatiquement dans la tendance. Et j’arrive toujours à avoir une ou deux lignes qui sont plus pointues, plus originales – des petites lignes plus confidentielles mais qui font de l’image. On s’en sort encore !
La marque Chantal Thomass est très fortement liée à votre propre image et à son logo (signé du publicitaire Benoît Devarrieux). Comment est-il né et pourquoi ce choix d’une ombre chinoise vous représentant ?
J’ai rencontré Benoît dans un dîner. Cela devait être en 1980. Il m’a demandé pourquoi nous ne faisions pas de publicité. Je lui ai répondu que nous n’en avions pas les moyens et que je faisais des collections avec 100 robes – laquelle choisir ? C’est alors qu’il m’a rétorqué qu’on allait communiquer sur moi. J’étais pourtant assez timide. Il a eu l’idée de faire mon portrait dans un fauteuil, avec le bras posé sur le dossier, en ombre chinoise. Quinze jours plus tard il avait découpé la photo et c’est devenu le logo. Pendant plusieurs années, nous avons communiqué à chaque défilé avec une page dans Le Matin de Paris ou Libération. Son idée était toujours de me montrer en ombre chinoise ou en flou pour qu’on ne me reconnaisse pas, afin que je ne date jamais. Lorsqu’en 1985 le fonds japonais World est entré au capital, Benoît ne les a pas du tout séduits. C’était un excentrique total alors que pour eux, la pub devait être de la pub. Cela n’a pas fonctionné mais je suis restée très proche de lui.
L’idée était qu’on ne vous voit pas mais qu’on vous devine, comme en lingerie…
Exactement, il a véritablement inventé quelque chose. Mais il était excessif. Il me disait : “Tu ne sors pas à la fête du Palace après le défilé, puisque la pub c’est : ‘Je suis en vacances’”. Moi j’étais hystérique, mais il ne voulait pas qu’on me voie.
Dans la couture, les maisons sont portées par les figures de leur créateur comme Coco Chanel, Yves Saint-Laurent ou Jean-Paul Gaultier. C’est différent en lingerie sauf pour vous. Qu’est-ce que cela apporte ?
Je pense que cela a beaucoup fait évoluer la lingerie. Quand j’ai commencé à en faire, j’ai fonctionné comme du prêt-à-porter. Je créais une collection d’été et une collection d’hiver, alors qu’à l’époque aucun des fabricants de lingerie ne le faisait. Nous avons mis la lingerie à la mode.
Était-ce une stratégie réfléchie ? Ne craignez-vous pas que cela se transforme en piège ?
Cela s’est fait petit à petit. Pour l’avenir de la marque, cela sera peut-être un piège. On verra.
Y avez-vous pensé ?
Non, même si de temps en temps je pense à mes enfants, mes petits-enfants. Je me demande comment ils réagiront dans 20 ans quand la marque ne sera plus du tout incarnée. Ce sera toujours mon nom, donc le leur. Et il y aura peut-être des choses qui vont être immondes, qui ne m’auraient pas plu et qui ne leur plairont pas. Malheureusement, je ne peux plus reculer !
La vie de la griffe n’a pas été un long fleuve tranquille. En 1985, vous déposez le bilan. Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné ? Quels enseignements avez-vous tirés de cette situation ?
Ce qui n’a pas fonctionné à ce moment-là, c’est que ni mon mari, qui était aux Beaux-Arts, ni moi, n’étions formés pour gérer un business. Cela a grandi très vite. Nous nous sommes retrouvés rapidement avec 50 personnes et nous n’avions pas les moyens de suivre. J’ai fait des collants avec Wolford en 1981-1982. Cela a été un ouragan, une révolution mondiale. Wolford, qui était tout petit à l’époque, fabriquait nos collants en dentelle mais il fallait en commander par exemple 3 000. Les clients derrière payaient à 60 ou 90 jours. À un moment la trésorerie n’a pas suivi. Il aurait fallu trouver le bon associé, mais nous n’étions ni l’un ni l’autre préparé à ça. Et je n’ai jamais été une femme d’affaires. Pendant 20 ans, mon but était de faire le plus beau défilé du monde. Je me fichais complètement de savoir si ça allait se vendre. Je suis avant tout une créatrice.
En 1985, le groupe japonais World devient actionnaire. Est-ce que cela a été difficile à vivre ?
Non, si ça pouvait me soulager des problèmes d’administration, j’étais très contente. J’ai vécu 10 ans extraordinaires mais ça a mal fini. C’était un groupe japonais de prêt-à-porter. La France était excessivement à la mode à cette époque, donc tout m’était permis. Ils ne me demandaient pas de gagner de l’argent. Ils voulaient avoir une image formidable en France, pour que cela serve au Japon. Cela s’est très bien passé durant des années. Cela a été pour moi la plus belle période de ma carrière.
Pourquoi cela n’a-t-il pas duré ?
Il y a eu une histoire de pourcentage. Mais surtout, au début des années 90, le Japon a connu une crise importante. Tout à coup, ils avaient moins l’argent facile. La mode italienne, avec Prada par exemple, est arrivée et a un peu supplanté la mode française. Ils m’ont mis un président italien pendant les deux dernières années pensant qu’on allait faire à l’italienne et que ça allait mieux marcher, me demandant si je pouvais faire quelque chose dans le genre Armani. Vous pensez bien que ce n’est pas dans mon caractère !
En 1995, vous êtes licenciée. Vous perdez votre marque et donc l’usage de votre nom. En 1996, la société est mise en liquidation. Qu’est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Je n’avais plus rien. Heureusement, j’ai été excessivement soutenue par la presse du monde entier et en particulier par la presse française pour qui j’étais tout de même la gentille française face aux méchants Japonais. Je suis passée au “20 heures”. Deux jours après, le président de Wolford m’appelait pour me proposer d’intervenir comme consultante. J’ai aussi travaillé pour Victoria’s Secret, j’ai fait toutes les pièces spectaculaires pour leur premier défilé. On ne peut pas dire que j’étais en grande forme, mais j’ai eu la chance de rencontrer mon deuxième mari et j’avais les enfants à qui je ne pouvais pas montrer que ça n’allait pas. Des gens me faisaient confiance, donc ça m’a remonté le moral.
Vous ne pouviez pourtant plus utiliser votre nom…
J’ai eu, pendant un an pratiquement, des huissiers derrière moi en permanence, pour voir si je n’utilisais pas mon nom. Cela a fait du bruit quand j’ai été virée. Jean-Charles de Castelbajac m’a conviée pour la Fashion Week et les huissiers étaient dans la salle. Ils étaient allés en cabine pour lui dire de ne pas me faire défiler. Il les avait évidemment envoyés sur les roses. Je suis passée sur le podium, tout le monde m’a applaudie et les huissiers sont partis. Sauf que dans la mode les interviews se font à la fin. J’ai eu TF1, etc. Cela a été une guerre permanente. Quand je travaillais pour Wolford, je ne pouvais pas non plus sortir sur le podium. Mais ils ne pouvaient pas m’empêcher de m’appeler Chantal Thomass. D’autres l’ont vécu et ce n’est pas évident.
Vous êtes-vous dit à l’époque que vendre son nom pouvait signifier perdre son âme ?
Oui, mais c’est toujours le cas. Quand je vais arrêter, et cela ne va pas tarder, ce ne sera pas forcément très agréable de voir cette marque exister sans moi. Le but est de me dire : j’ai fait une marque, j’ai créé quelque chose, qu’elle vive toute seule ce n’est pas plus mal.
Comme vous le disiez, nombreux sont ceux dans le monde de la mode à avoir été dépossédés de leur nom. Mais vous êtes l’une des seules après 3 ans de contentieux à l’avoir récupéré. À quoi cela tient-il ?
Cela tient à mon tempérament, mais c’est aussi que les gens m’aiment bien. J’ai un côté populaire, sympathique. Parce que j’ai eu des difficultés et que je m’en suis sortie. Comme eux, comme tout le monde. Je pense que c’est quelque chose qui plaît.
Ce n’est pas la sympathie qui permet de remporter une bataille…
Après c’est une question de volonté. Je dois être… têtue !
Diriez-vous qu’il ne faut jamais abandonner ?
Effectivement. C’est de la volonté, de l’exigence. On passe de mauvais moments mais on continue. Il faut aller au bout de ses convictions. J’ai eu la chance d’avoir une carrière où je n’ai honte de rien de ce que j’ai fait.
À cette époque, la marque rejoint le giron de Dim (d’abord propriété de Sara Lee Corporation puis de Sun Capital Partners via Dim Brand Apparel), avant d’être revendue au Groupe Chantelle en 2011. Comment vit-on ces changements ? Avez-vous l’impression d’avoir sans cesse une épée de Damoclès au-dessus de la tête ?
Dim c’était plutôt sympa mais dans ces gros groupes, on se revend. Lorsqu’ils ont été revendus à Sun Capital, le président a visité Les Galeries Lafayette. En passant devant Chantal Thomass, il a fallu lui expliquer : “Ça c’est à vous”. Je suis allée le voir en lui disant : “Vendez, ça ne vous intéresse pas !”. Au bout de 3 ans, ils ont vendu à Chantelle. En 10 ans de groupe Dim, j’ai vu passer au moins 5 présidents. Tous les 2 ans, il y en a un nouveau à qui il faut raconter son histoire. Même si sur le tas il y en a eu un de bien, cela change tout le temps, c’est fatiguant. Avec Chantelle, j’étais contente car j’avais un président familial.
Vous sentez-vous encore libre ?
J’ai quand même un président. Nous parlons et décidons ensemble de toutes les collaborations que je fais. Il y a des choses pour lesquelles je dis “non” de moi-même car j’ai un respect énorme pour la marque.
Pouvez-vous encore provoquer ? Et est-ce un objectif ?
Je ne suis pas sûre. Je cherche toujours à créer quelque chose qui n’a pas été fait. J’ai des codes de marque qui petit à petit se sont installés, les gens m’attendent aussi beaucoup pour ces codes. Mais inconsciemment, j’aime provoquer. Faire le Crazy Horse (en 2016, le cabaret parisien avait demandé à la créatrice de prendre la direction artistique du spectacle “Dessous Dessus”, ndlr) c’était un peu provoquant. En même temps, je m’en suis très bien sortie car elles étaient beaucoup plus habillées que d’habitude. Je me suis battue !
Chantal Thomass : “En tant que créatrice, j’ai été jugée plus sévèrement que les hommes”
Qu’est-ce qui vous a plu dans ce projet ?
C’est de travailler avec une petite équipe. C’était vraiment : la directrice, le régisseur, le chorégraphe, la directrice de ballet, la costumière. C’est quelque chose que je n’ai plus du tout dans tous ces grands groupes depuis 30 ans. Chantal Thomass reste une petite structure au sein du Groupe Chantelle mais c’est quand même une grosse machine. Pendant 3 mois il y avait une espèce d’excitation. D’ailleurs, j’ai perdu 4 kilos comme avant un défilé.
Cette adrénaline des défilés, cette ambiance pourtant faite de stress et de fatigue, vous manque-t-elle ?
Oui, ça m’a manqué très longtemps. Après j’ai fini par l’oublier. Mais le fait de faire le Crazy m’a redonné ce sentiment.
Diriez-vous que vous êtes une ambitieuse ?
Je pense que oui. Je suis partie de rien et j’ai osé. J’avais en moi cette envie d’exister, d’être reconnue !