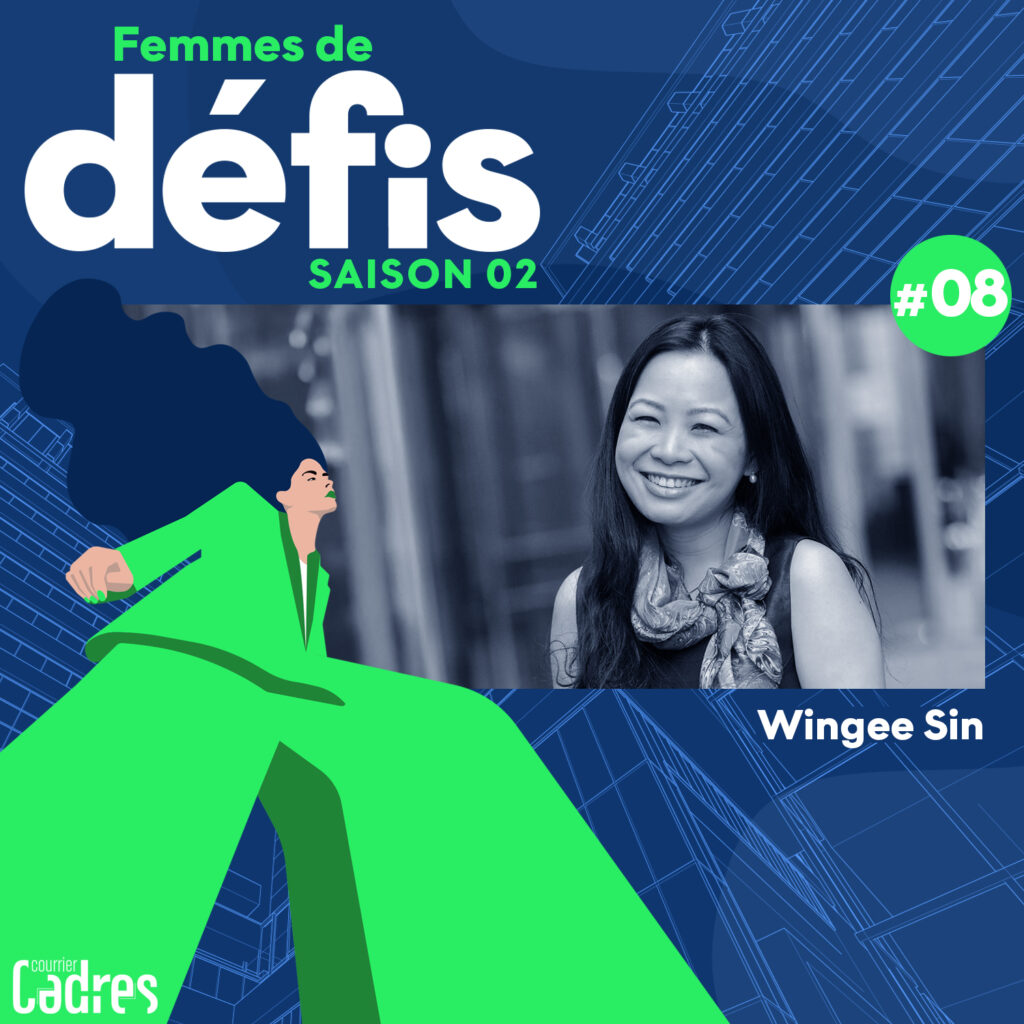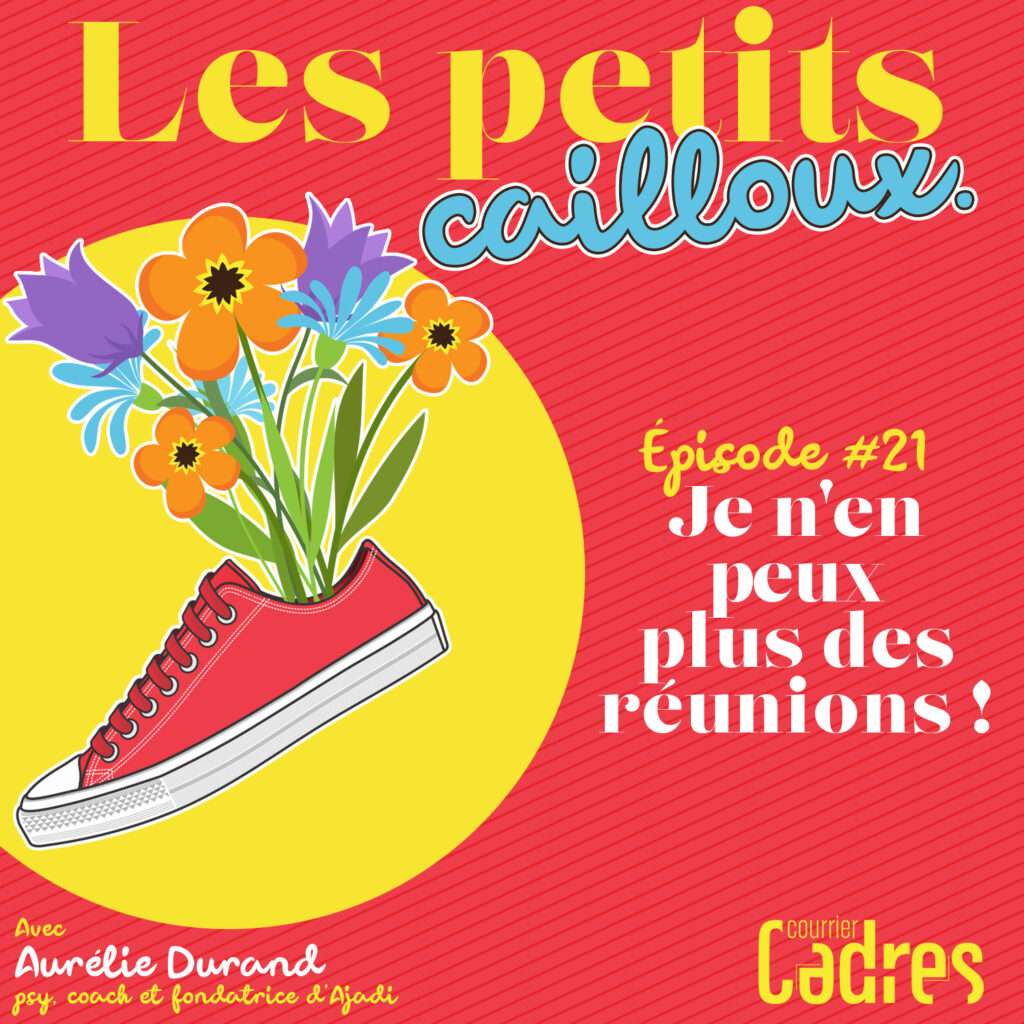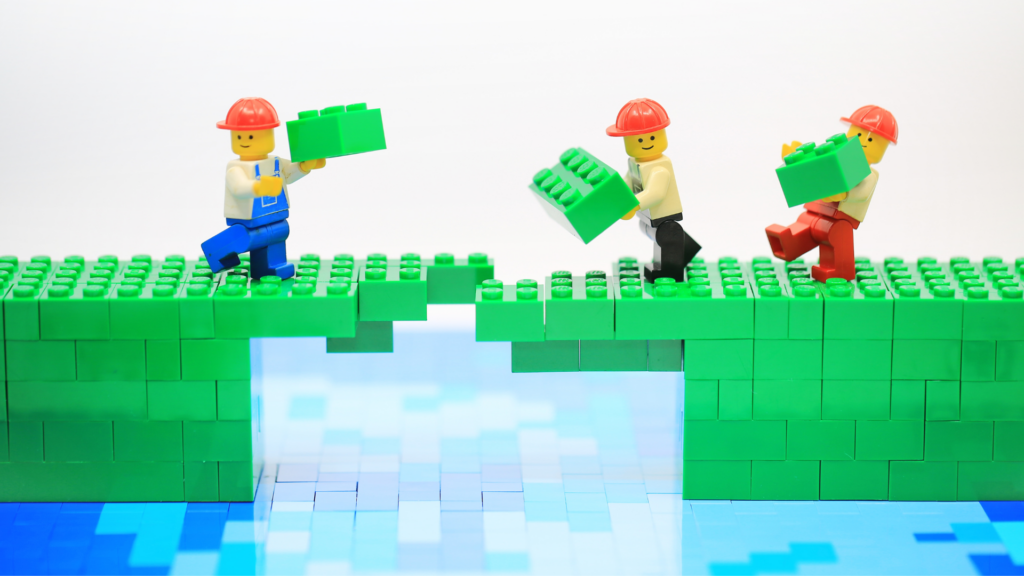Face à l’épidémie de coronavirus, des salariés peuvent être conduits à invoquer leur droit de retrait. Mais le recours à ce droit reste limité, et l’employeur peut très bien le contester.
Article du 9 mars 2020 mis à jour le 13 mars, après les annonces d’Emmanuel Macron.
Alors que l’épidémie de coronavirus se propage en France et qu’Emmanuel Macron vient d’inciter les entreprises à privilégier le télétravail et l’activité partielle, les dirigeants s’interrogent, en particulier à propos de l’exercice du droit de retrait. En effet, l’évolution du Covid-19 peut conduire des salariés à redouter des risques de contaminations dans le cadre de leur travail, si leur employeur refuse le télétravail notamment.
Concrètement, le droit de retrait est le droit pour tout salarié de se retirer de son lieu de travail, en cas de danger “grave et imminent” pour sa vie ou sa santé. “Dans le cadre de son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés, l’employeur doit protéger ces derniers face à toute situation de contamination potentielle. Si l’entreprise n’a pas pris les mesures nécessaires (conformément aux recommandations du gouvernement), par exemple si elle refuse le télétravail, les collaborateurs peuvent ainsi quitter leur poste de travail ou refuser de s’y rendre”, explique Timothé Lefebvre, avocat au Barreau de Paris.
Un droit qui se valide au cas par cas
En revanche, si l’entreprise a bien pris toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires, le recours à l’exercice du droit de retrait est plus difficile. “Si un salarié travaillant dans une entreprise où un collègue a été contaminé peut légitimement l’exercer au nom de la prévention, il faut savoir que l’employeur a tout à fait le droit de le contester. C’est alors le juge prud’homal qui tranchera”, note Timothé Lefebvre. Selon l’avocat, l’exercice du droit de retrait est individuel, et son bien fondé se décide au cas par cas.
L’employeur ne peut demander à son salarié de reprendre son activité, dans le cas où persisterait “un danger grave et imminent”. A contrario, si l’exercice de ce droit est “manifestement abusif”, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. Le salarié peut aussi se voir adresser un avertissement. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut enfin constituer une cause “réelle et sérieuse” de licenciement pour abandon de poste.
LIRE AUSSI : Coronavirus : les mesures que l’entreprise doit mettre en place
À noter que selon le Code du travail, le droit de retrait est “exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent”. Ainsi, le retrait ne peut s’effectuer “si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers”, indique le ministère du Travail.
“On peut se retirer d’une situation dont on a un motif raisonnable de penser qu’on est en danger. Tout repose sur ce motif raisonnable. Il est tout à fait possible d’imaginer que cet exercice serait justifié s’il est démontré que l’employeur n’a pas respecté les recommandations du gouvernement, même s’il ne s’agit que de recommandations”, explique Timothé Lefebvre.
“La seule obligation légale pour l’entreprise, c’est celle de la sécurité, en fonction des indications du gouvernement, auxquelles peut se référer le juge pour vérifier que l’employeur a pris ou non les bonnes mesures. Vu les demandes d’Emmanuel Macron de limiter les déplacements et de généraliser l’activité partielle, l’on comprendrait mal qu’un employeur refuse le télétravail et force son salarié à venir”, indique Timothé Lefebvre. Le droit de retrait peut-il être considéré comme injustifié sans cas de coronavirus dans l’entreprise ? “Il y a quelques semaines, oui, mais plus dans ces circonstances”, conclut-t-il.