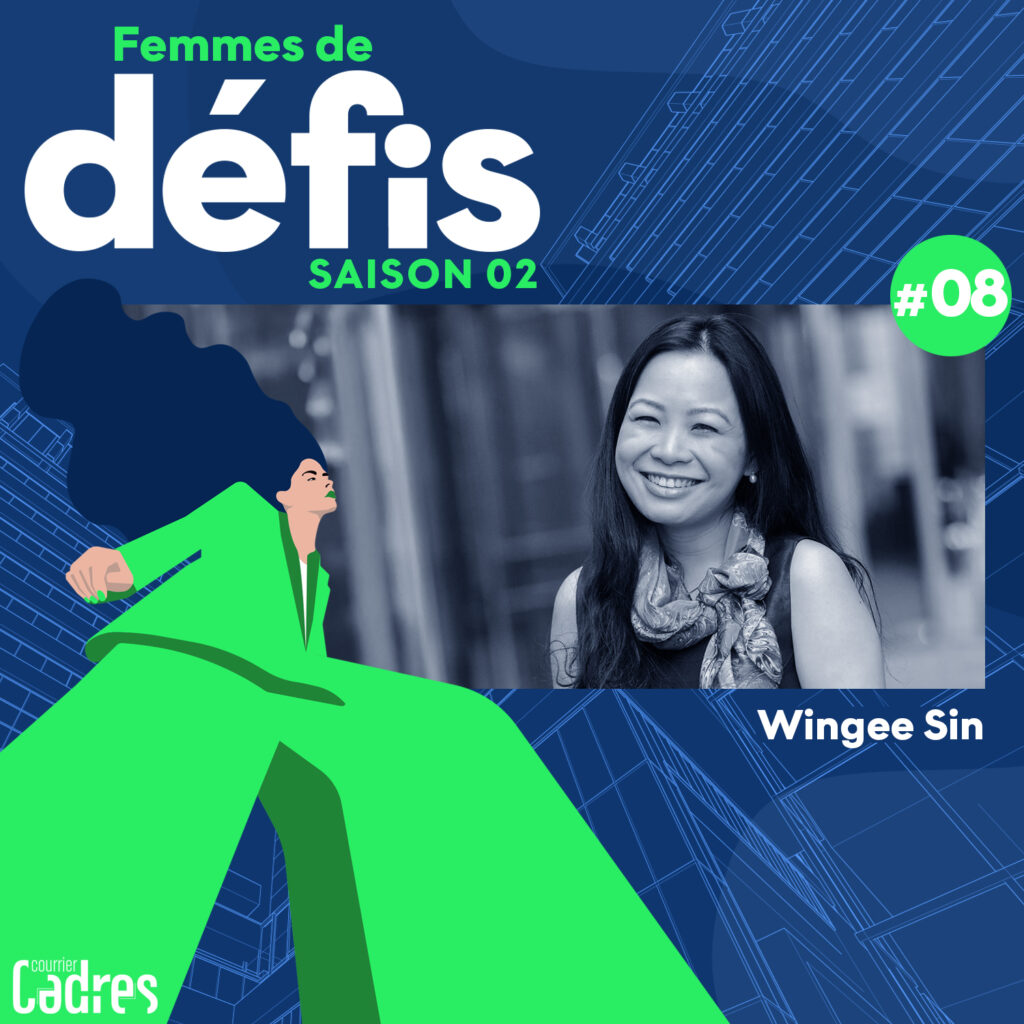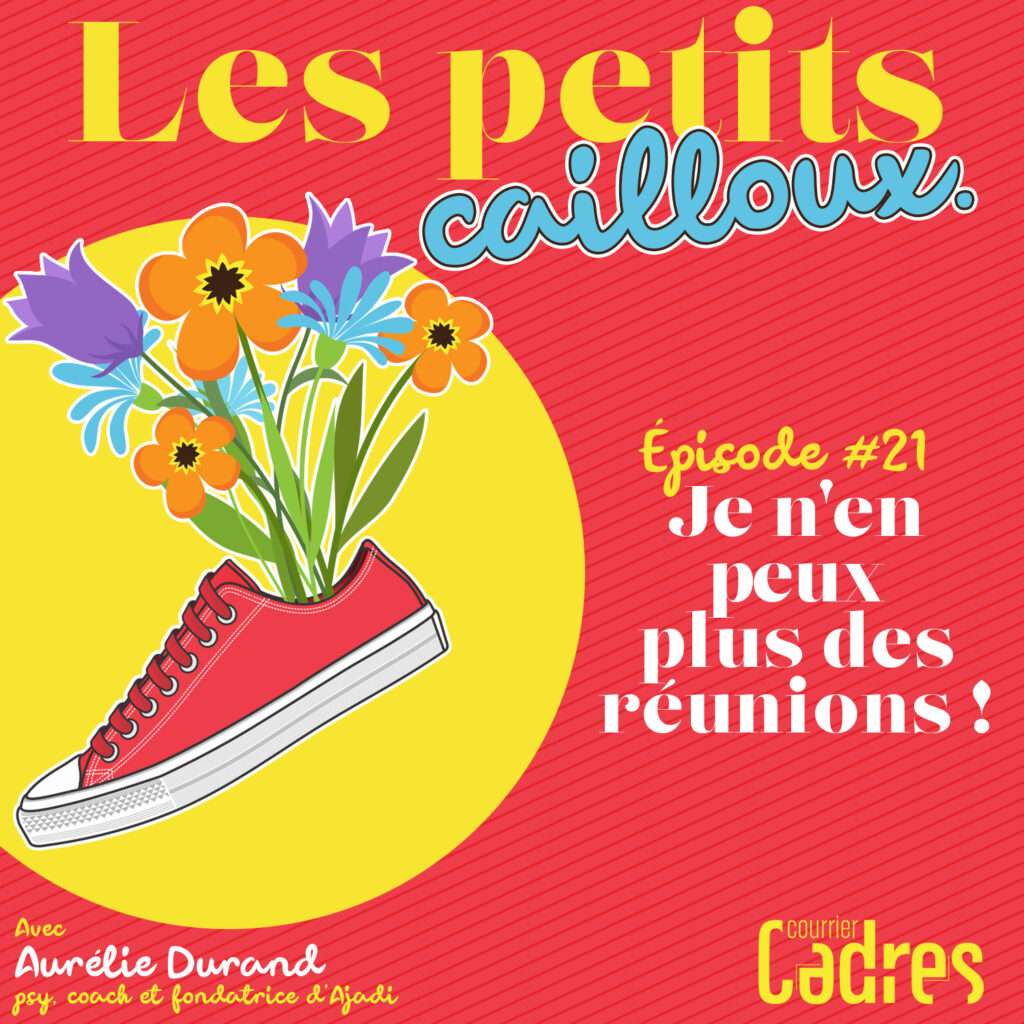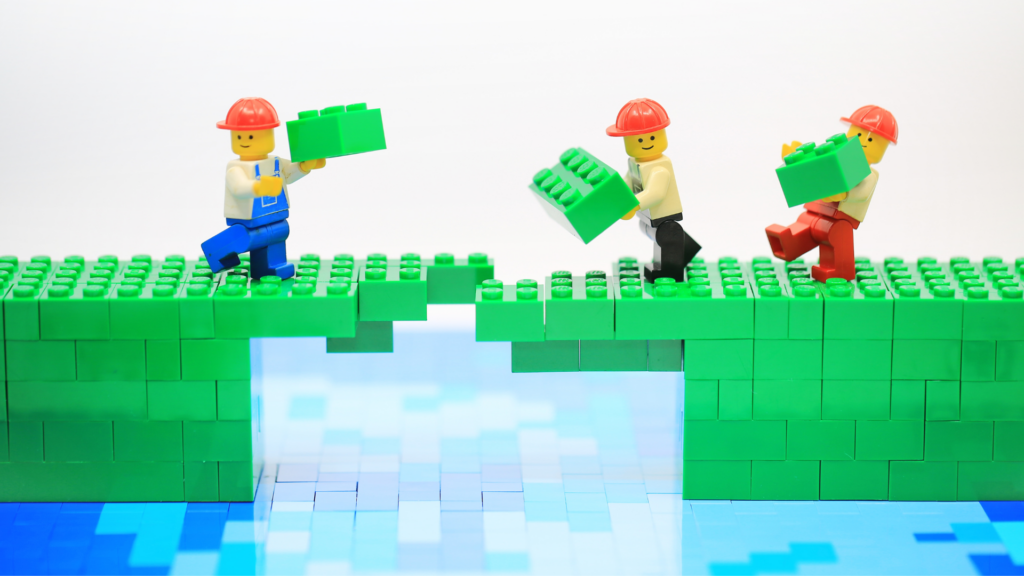Président de la Fondation Positive Planet, ex-conseiller de François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron, l’économiste et écrivain Jacques Attali prône depuis 10 ans le développement d’une “économie positive”. Un concept qui prend tout son sens face à la crise du coronavirus. Au point de l’avoir conduit, pendant le confinement, à rédiger un essai dans lequel il préconise de “passer de l’économie de la survie à l’économie de la vie”.
Pouvez-vous définir l’économie positive ?
L’économie positive, c’est tout simplement une économie mise au service des générations futures. Il s’agit, plus généralement, d’une attitude, d’un mode de comportement, qui consiste à prendre ses décisions en tenant compte de l’avenir de nos enfants. C’est en fait l’action qui consiste à penser ce que l’on fait aujourd’hui en fonction des conséquences sur le long terme, pour soi-même et surtout pour les autres.
En quoi la crise du Covid-19 a-t-elle renforcé cette idée, jusqu’à vous mener vers celle d’une “économie de la vie” ?
La crise du coronavirus nous a montré l’importance de préparer à l’avance nos décisions dans l’intérêt des générations futures. Si nous avions prêté attention à tous ceux qui nous ont dit que cette crise aurait lieu un jour, nous n’en serions pas là. De la même façon, il va nous falloir tenir compte de ceux qui nous alertent sur de graves problèmes climatiques, pour en déduire une action à mener.
La clé de la préparation des pandémies ultérieures et des crises écologiques, économiques et sociales, c’est l’économie de la vie. Si l’économie positive est la prise de conscience de l’importance de travailler en fonction de l’intérêt des générations suivantes, l’économie de la vie est justement la liste des secteurs qui en découlent, et sur lesquels il est nécessaire de concentrer les efforts de relance.
Ce sont tous les secteurs qui, d’une façon ou d’une autre, se donnent pour mission de défendre la vie, et dont nous avons redécouvert l’importance pendant la pandémie : la santé, la gestion des déchets, la distribution d’eau, le sport, l’alimentation, l’agriculture, la distribution, le commerce, l’éducation, l’énergie propre, le numérique, le logement, la culture, l’information, l’assurance…
LIRE AUSSI : “Économie positive” : 87 % des salariés l’appellent de leurs vœux
Quel sera, selon vous, l’impact de cette crise sur les entreprises ? Quelle posture devraient-elles adopter demain ?
Elles devraient d’abord vérifier si elles sont vraiment positives, et si ce n’est pas le cas, tendre à le devenir. C’est pour les y aider que l’Institut de l’Economie Positive, au sein de la Fondation Positive Planet, calcule depuis déjà 7 ans leur “indice de positivité”. Il s’agit de 35 indicateurs (1), qui permettent de mesurer, tous les ans, la performance des organisations sous l’angle d’une croissance positive, durable et inclusive. Avec cet outil, nous aidons les entreprises à travailler, au travers d’actions concrètes, des sujets aussi différents que la protection des milieux naturels, l’économie sociale et solidaire, l’égalité entre les sexes, l’emploi et l’insertion des jeunes.
Demain, les entreprises devraient donc s’assurer de travailler dans l’intérêt des générations futures, dans 4 dimensions : économiquement, socialement, écologiquement et démocratiquement. Mais attention, ces 4 critères doivent être compatibles et se répondre : ainsi, les organisations positives ne peuvent agir pour l’intérêt général sans être rentables. Il ne peut y avoir d’actions avec un impact positif sur la démocratie, l’environnement ou le tissu social, sans bénéfices. Des bénéfices réutilisés pour assurer la pérennité du business, et non pour faire du profit. Ce concept va plus loin que celui des entreprises à mission. Ces dernières s’intéressent certes à leur impact social et environnemental, et il s’agit d’un gros progrès. Mais leurs missions ne couvrent pas toutes les dimensions de l’économie positive, notamment dans la mesure où les profits ne sont nullement limités.
Les entreprises peuvent agir dès maintenant, en redevenant les lieux du long terme, face aux stratégies de courte vue de l’économie de marché. En œuvrant dans l’intérêt de la société, mais aussi des clients et des collaborateurs. Pour devenir réellement positives, elles peuvent jouer sur des leviers tels que les conditions de travail ou le partage de la valeur créée.
LIRE AUSSI : “Suite à la crise du Covid-19, les entreprises devront assumer leur rôle social et politique” (Diana Filippova)
87 % des salariés du privé souhaitent voir leur entreprise s’engager dans l’économie positive. Mais moins d’un sur deux pense que son organisation a prévu de le faire. Comment analysez-vous cela ?
Pour 91 % des salariés, c’est au dirigeant “d’impulser une stratégie positive”. Mais selon eux, le principal frein à la voie de l’économie positive reste justement “l’absence de volonté” de leurs supérieurs, notamment parce que “cela coûte trop cher”, ou parce que ce n’est pas une orientation à laquelle l’entreprise adhère. Cette étude révèle bien les problèmes de comportements de beaucoup de dirigeants à l’égard de la prise en compte de l’avenir. Leurs préoccupations ne concernent bien souvent que le court terme.
Les chefs d’entreprises doivent apprendre à se conduire dans leur organisation comme nous nous conduisons, dans la sphère privée, au sein de notre famille, avant de prendre une décision : en prenant en compte l’intérêt de nos enfants, avant notre intérêt personnel. Cette prise de conscience, vitale, de l’importance du long terme, ne pourra passer que par un vrai changement, profond, de mentalités.
Les salariés eux-mêmes peuvent-ils agir pour “pousser” leurs propres entreprises ?
Pour faire face aux enjeux de demain, il devient impératif de transformer l’économie pour produire non pas moins, mais mieux. En cette période de déconfinement post-coronavirus, de plus en plus de chefs d’entreprise s’engagent dans cette voie, mais nous devons aller plus loin. Notamment en engageant l’ensemble des collaborateurs, en premier lieu les cadres.
Cela suppose de leur donner voix au chapitre, au sein des organisations syndicales, mais aussi en leur permettant plus globalement d’interroger l’impact de leurs actions et de celles de leur entreprise sur l’avenir des générations futures. Les salariés devraient pouvoir vérifier que les actions RSE et ESS de leurs sociétés sont sérieuses, et pas uniquement du “window dressing”. Ils peuvent aussi, sans attendre, essayer de peser du mieux qu’ils le peuvent pour faire entrer le concept d’économie positive dans le mode de gestion de l’entreprise.
LIRE AUSSI : Embarquez vos parties prenantes grâce à l’Entreprise à Mission
Comment pourrait-on, selon vous, encourager l’économie positive et l’économie de la vie ?
Au fond, les secteurs de l’économie de la vie sont les mêmes que ceux de la société positive. Dans ce sens, il faut renforcer leur place, les développer. L’État doit soutenir les entreprises positives ; en créant pour elles de nouveaux statuts, en leur donnant la priorité dans les crédits… Les employeurs, de leur côté, doivent augmenter la rémunération et le statut social de ceux qui y travaillent.
Enfin, les entreprises des autres secteurs, qui attendent (probablement en vain) le retour de leurs marchés antérieurs ; comme l’automobile, l’aéronautique, le textile, la mode, la chimie, le luxe et le tourisme ; devront elles-mêmes se réorienter vers l’économie de la vie. Ces entreprises ne sont pas condamnées. Mais pour survivre, elles n’auront d’autre choix que de se reconvertir, et de trouver des façons de rendre différemment les mêmes services. Le secteur du tourisme en donne déjà l’exemple, avec les concepts de tourisme durable et à impact positif.
Les gouvernements ont-ils un rôle à jouer ? Devraient-ils légiférer ?
Au-delà du soutien des secteurs de l’économie de la vie et des entreprises positives, ils se doivent d’être eux-mêmes positifs dans leurs propres décisions. Leur budget, leurs lois doivent être positives. C’est pourquoi je propose dans mon dernier essai que toute décision allant contre l’intérêt des générations puisse être considérée comme anticonstitutionnelle, en modifiant donc la Constitution. Je propose aussi l’instauration d’un impôt sur la fortune, dont serait déductible sans limite tout investissement dans l’économie de la vie : il serait ainsi possible de ne pas le payer, à condition de contribuer à ses secteurs.
(1) Ces 35 indicateurs sont répartis dans 5 dimensions : empreinte environnementale, conditions de travail, partage positif de la valeur produite par l’entreprise, formation et recherche, vision stratégique de long terme.