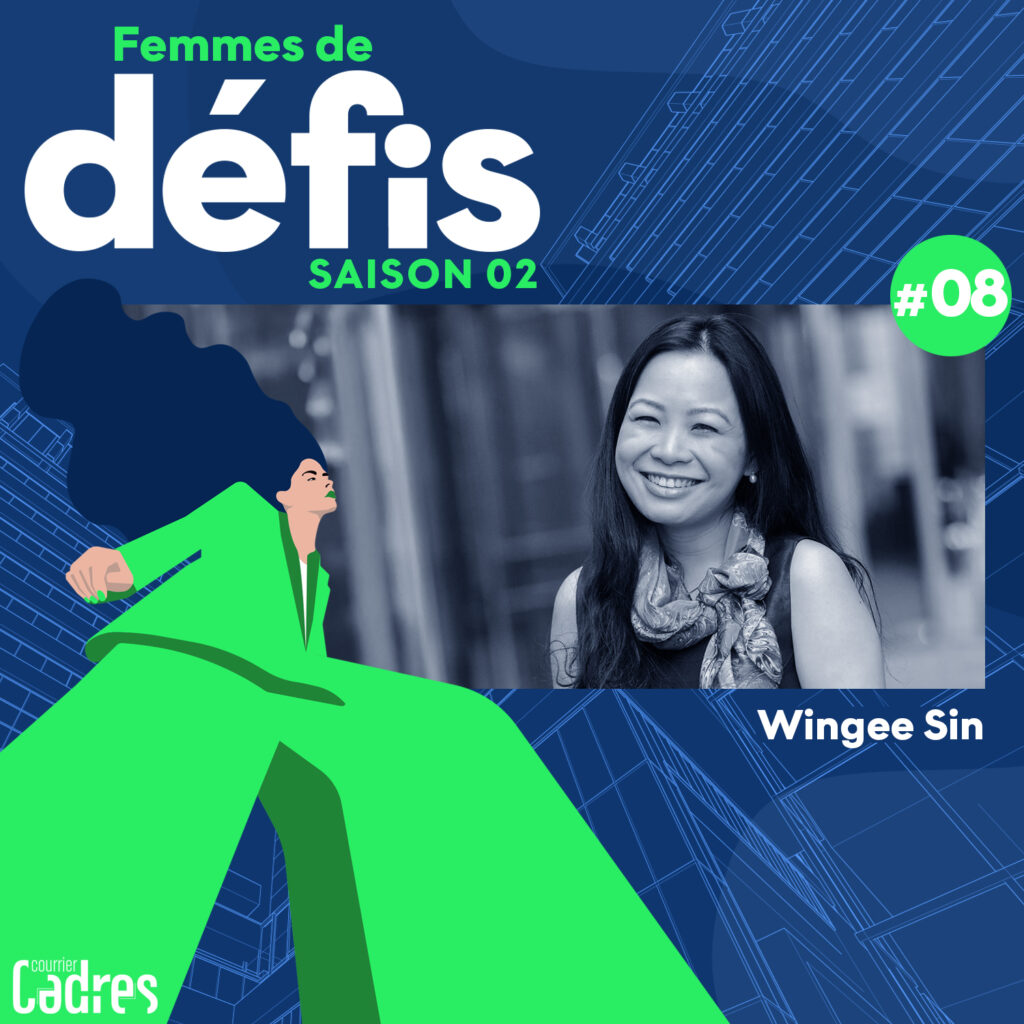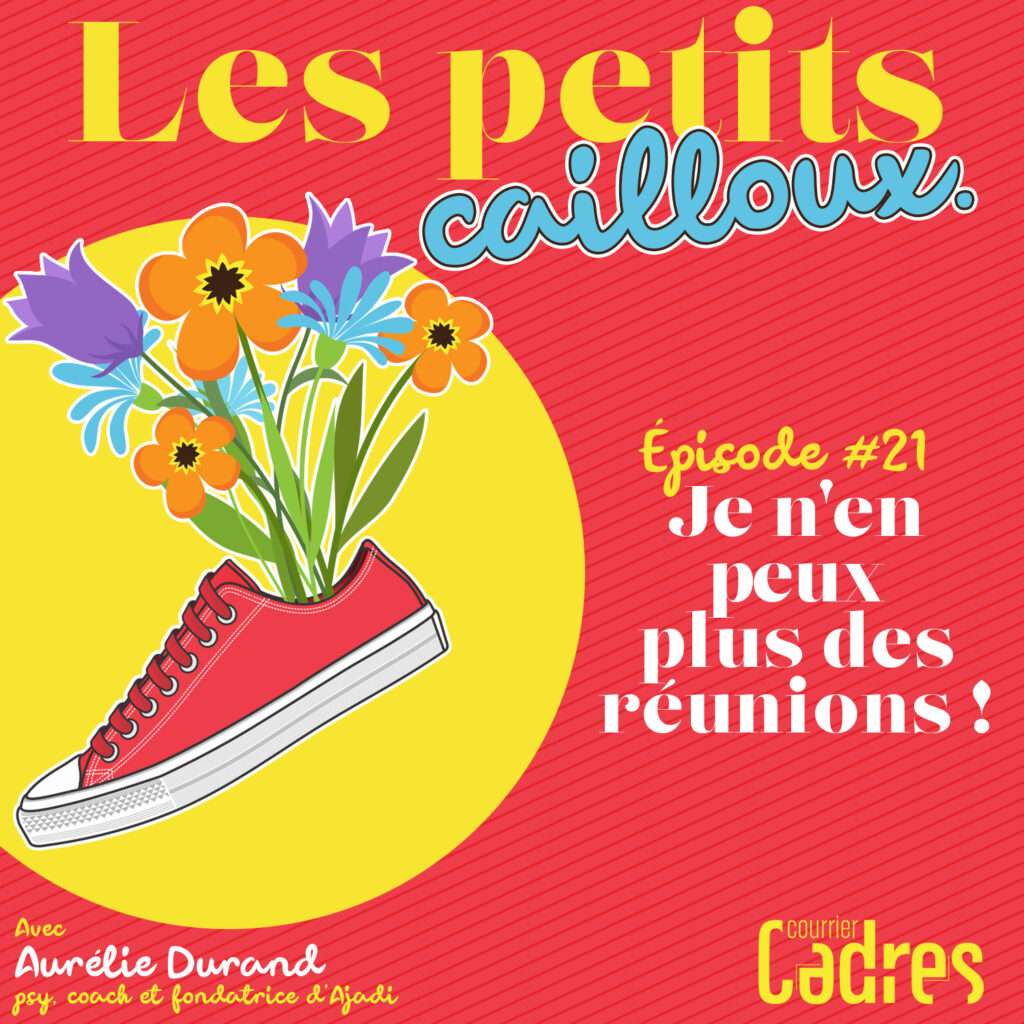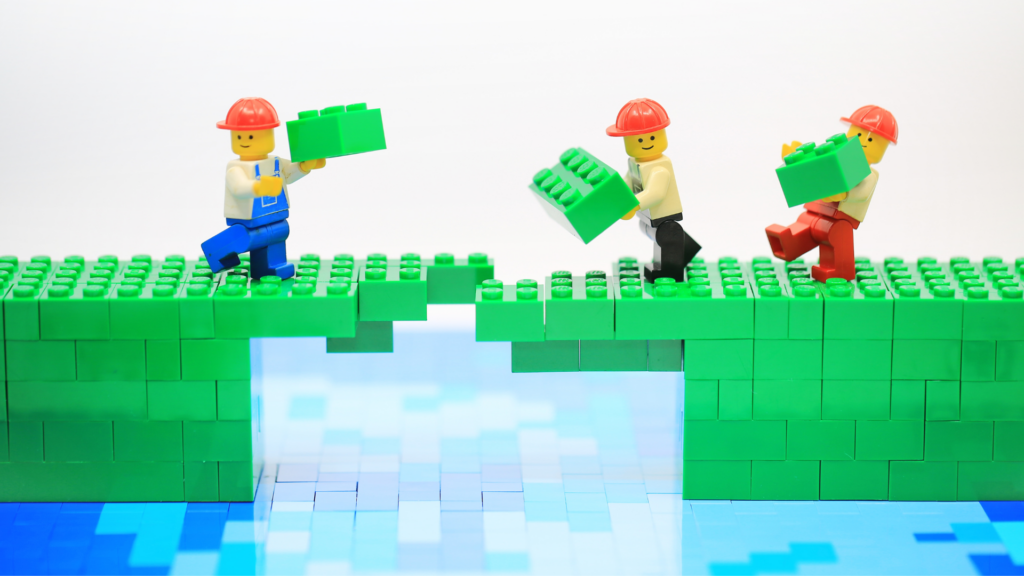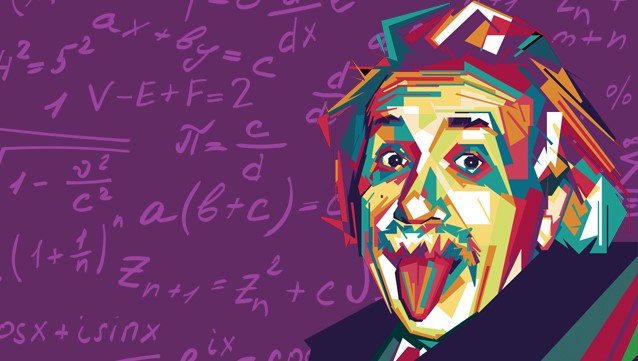Anticonformiste, Albert Einstein a placé au cœur de sa démarche scientifique deux qualités insolites : l’imagination et la créativité. Qui lui permettaient de penser autrement.
Albert Einstein est à l’origine de deux théories à la base de la physique moderne : celle de la relativité, et celle de la mécanique quantique. Il est devenu, dans l’imaginaire collectif, l’incarnation du génie scientifique. Mais derrière son succès, se cache surtout des méthodes de travail et de réseautage bien rodées. En 1905, à 26 ans, il est encore peu connu. “S’il a un talent certain en sciences, personne ne voit en lui un visionnaire des sciences. Il a été diplômé de l’École polytechnique de Zurich (EPZ) en 1900, mais sans avoir fait d’étincelles”, relate Jean-Jacques Greif, journaliste et auteur d’“Einstein, l’homme qui chevauchait la lumière”. Modeste expert technique à l’Office des brevets de Berne, il finit par percer en publiant quatre articles qui bouleverseront les fondements de la physique moderne.
Comment est-il parvenu à briller ainsi en quelques mois ? D’abord grâce à sa capacité à “penser à côté”. “Sa force, c’était de penser les problèmes scientifiques de façon décalée”, estime Jean-Marc Ginoux, historien des sciences. (1) Le physicien développe ce qu’il appelle les “expériences de pensée”. Cette technique consiste à mêler intuition, réflexions conceptuelles et visualisation d’images mentales. “Par exemple, pour sa théorie de la relativité restreinte, il s’imagine en train de chevaucher un rayon de lumière”, explique Michel Paty, philosophe des sciences. (2) “La voilà, sa force : cette capacité à réduire un phénomène d’une complexité rare à sa plus simple expression analytique, telle qu’un enfant pourrait le comprendre. Et c’est bien parce qu’il a un regard d’enfant qu’il est capable de le faire”, commente Jean-Marc Ginoux.
Einstein a aussi passé plusieurs années à lire les écrits d’auteurs de référence. “À l’université, il sautait des cours afin de consacrer plus de temps à la lecture de ceux qu’il appelait les ‘maîtres de la physique théorique’. En 1902, il fait de même en détournant son emploi de vérificateur de brevets”, explique l’historien des sciences.
Ce poste, qu’il a décroché par défaut après avoir échoué à devenir assistant universitaire, lui permet de compulser les recherches de savants tels que Ernst Mach, Henri Poincaré et Hendrik Lorentz. Sans qu’il s’agisse de ses vraies missions : “Son job était d’analyser des inventions. C’était ennuyeux mais facile pour lui, si bien qu’il réussissait à dégager du temps pour faire autre chose : recenser des articles scientifiques pour la revue Annalen der Physik”.
A lire aussi : Salvador Dali, une folie bien réelle
Créer un réseau
Conscient de ses limites dans certaines disciplines, notamment les mathématiques, Einstein a compris très tôt l’importance de créer et de cultiver un réseau qui lui permettrait de l’aider dans ses travaux. De même, il prend conscience que pour mettre en avant ses trouvailles, il lui faut des ambassadeurs. À l’EPZ, il rencontre Mileva Maric, sa première épouse. “Physicienne, elle travaillera avec lui sur la théorie de la relativité”, explique Michel Paty.
Dans la même école, il fait la connaissance du mathématicien Marcel Grossmann. C’est lui qui lui trouvera un poste à l’Office des Brevets. Et c’est lui qui l’aidera à réaliser les calculs nécessaires à sa théorie de la relativité générale. “C’est aussi ce qui explique son succès : il travaillait souvent avec un ami ou des assistants, à qui il déléguait les calculs complexes dont il avait besoin pour ses travaux”, observe Jean-Jacques Greif.
Enfin, il se rapprochera d’autres scientifiques, afin de nourrir ses théories et d’élargir son carnet d’adresses. (3) Il assiste à des congrès, où il rencontre des sommités telles que Max Planck et Hendrick Lorentz. “Il va correspondre avec eux par écrit, afin de leur faire la publicité de ses idées. Il va aussi collaborer avec ses pairs. Avec son ancien assistant Léo Szilárd, il va notamment inventer un réfrigérateur à absorption”, raconte Jean-Jacques Greif.
Se construire une image
Albert Einstein était-il réellement désorganisé et distrait, à l’image de son bureau encombré et de ses vêtements souvent débraillés ? “Un grand désordre régnait réellement dans son bureau. S’il était vraiment distrait, il forçait parfois un peu le trait. Et en réalité, il était très organisé dans tout son désordre”, note Jean-Marc Ginoux. “Sa distraction et son look de savant fou font partie de son personnage. Car il ne faut pas perdre de vue une chose importante : au fil du temps, il s’est construit une image pour vendre ses travaux”, ajoute l’historien des sciences.
Enfin, l’abnégation d’Einstein dans le travail n’était pas un mythe. “Ses théories, c’était sa vie. Pendant ses vacances, il partait en bateau avec un carnet de notes pour continuer à faire de la recherche. Le jour de sa mort, il a demandé à ce qu’on lui amène son carnet afin de terminer des calculs”, raconte Jean-Jacques Greif. Cette façon de se plonger à corps perdu dans ses travaux s’est faite au détriment de sa vie personnelle : “C’est sans doute en partie pourquoi il a divorcé à deux reprises. Évidemment, ce n’est pas quelque chose dont on peut s’inspirer.”
(1) Jean-Marc Ginoux, “Pour en finir avec le mythe d’Albert Einstein”, 2019, Hermann.
(2) Michel Paty, “Albert Einstein ou la création scientifique du monde“, 1997, Belles-Lettres.
(3) Walter Isaacson, “Einstein : La vie d’un génie”, 2013, Guy Trédaniel Editions.