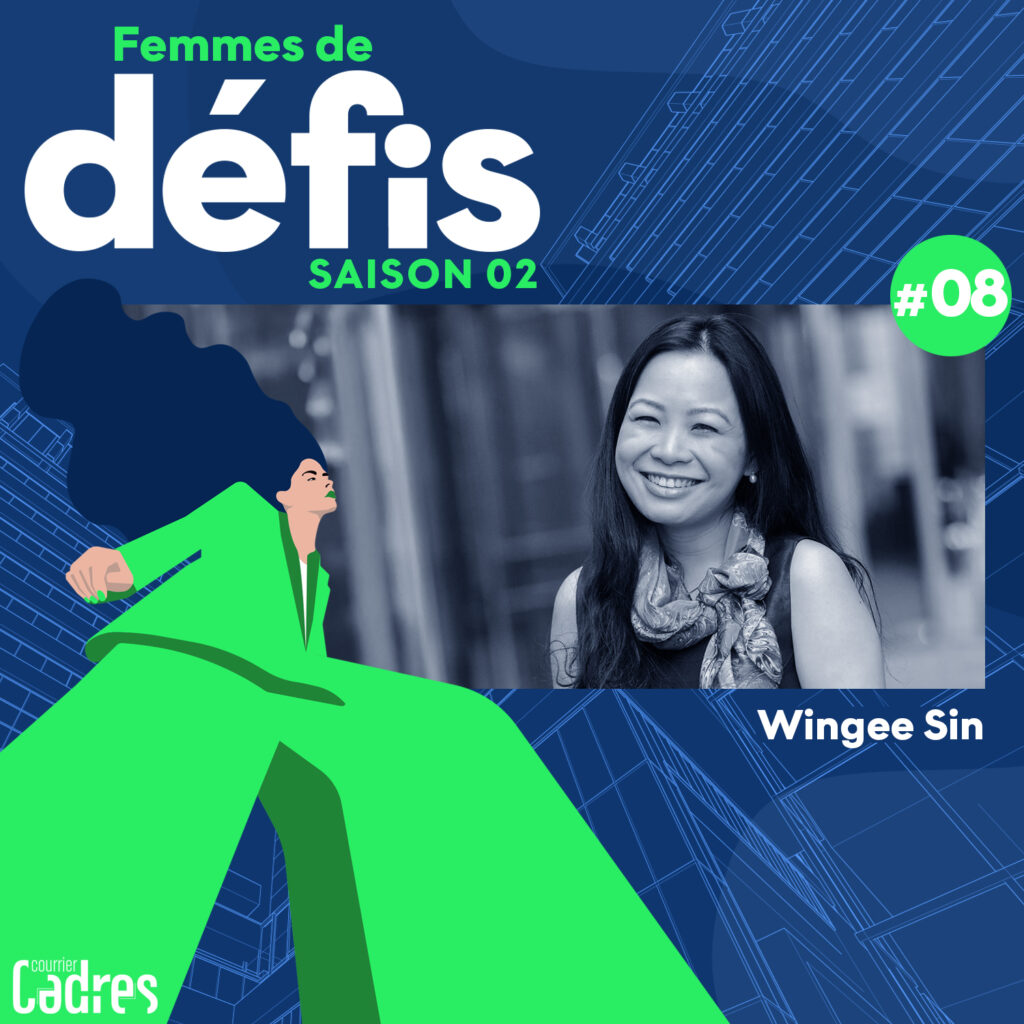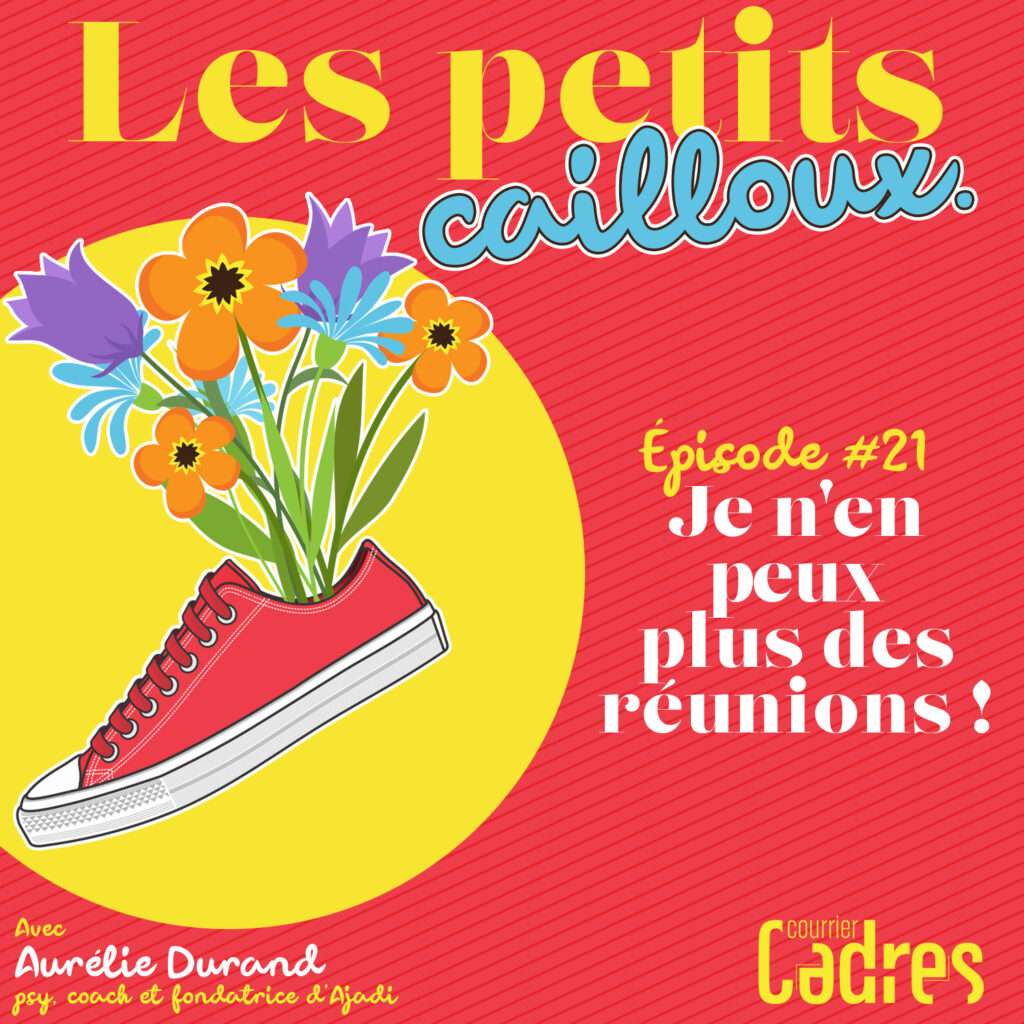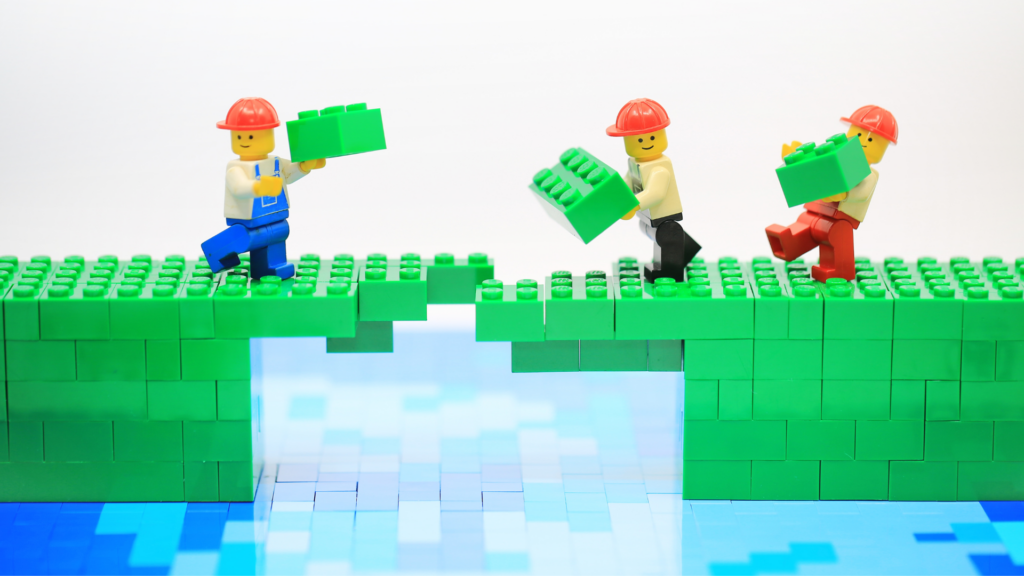Deux ans après la loi PACTE, les entreprises à mission se développent. Peut-on parler d’une tendance de fond ? La crise sanitaire a-t-elle eu un impact ? Quel rôle les collaborateurs et les managers peuvent-ils jouer dans ce cadre ? L’analyse d’Emery Jacquillat, président de la Communauté des entreprises à Mission et PDG de Camif.
Où en sont les entreprises à mission ?
Nous avons passé la barre des 500 sociétés à mission, début 2022. Il s’agit d’une très belle dynamique : c’est quatre fois plus que l’année dernière, à la même période. Sachant qu’aux USA, les “benefit corporations”, qui existent depuis plus de 10 ans, ne dépassent pas le nombre de 500, et qu’en Italie, les “società benefit”, qui existent depuis 5 ans, sont au nombre de 1 500. En France, nous devrions dépasser les 2022 sociétés à mission d’ici 2023.
La Communauté des entreprises à mission a été créée en 2018, avant la loi PACTE (qui date de 2019), par un petit groupe de chefs d’entreprises qui avaient expérimenté ce modèle, et des chercheurs qui l’avaient théorisé sous le nom de “société à objet social étendu”. L’ayant expérimenté avec la Camif, nous avons fait le constat que ce modèle était riche, car il transforme véritablement l’entreprise. De par le fait d’inscrire dans les statuts une raison d’être, de la traduire en objectifs de missions, d’alimenter une feuille de route, et de mettre en place une gouvernance dédiée. Il s’agit du système le plus adapté pour un dirigeant souhaitant rendre son entreprise contributive, et passer d’une RSE centrée sur des engagements de responsabilités, à un modèle d’impact positif.
Les décrets d’application de la loi PACTE sont sortis en 2020 ; on sait que le passage à l’entreprise à mission prend du temps pour une organisation. Le chemin est long ; la définition de la raison d’être et celle des objectifs de mission peuvent prendre 12 à 18 mois à l’entreprise, car l’on interroge pour cela les collaborateurs, les fournisseurs, les acteurs du territoire. Les premières entreprises à mission sont apparues assez vite, mais il s’agissait de pionniers déjà bien engagés. Mais ce que l’on voit désormais, c’est la vague de ceux qui ont démarré leurs travaux il y a 12 à 18 mois, et la dynamique est réellement là.
LIRE AUSSI : Deux ans après la loi Pacte : qui sont les entreprises à mission
Peut-on parler d’une tendance d’avenir, en cette période particulière marquée par la crise sanitaire ?
On aurait pu croire qu’avec la pandémie, les entreprises ont d’autres priorités, plus pragmatiques et court terme. Mais l’on se rend compte justement que la crise a été un accélérateur, au-delà de la loi PACTE : elle a accéléré la prise de conscience des dirigeants de l’importance de rendre leurs entreprises plus utiles, et de pouvoir prouver l’utilité de leurs organisations aux yeux des citoyens, des consommateurs, des clients et de leurs propres collaborateurs.
Le niveau d’exigence a aussi crû pendant la crise ; aujourd’hui, pour attirer les jeunes talents, retenir les meilleurs dans l’entreprise et recueillir la fidélité des clients, l’entreprise doit pouvoir dire en quoi elle contribue au bien commun, et démontrer ses engagements sociaux, sociétaux et environnementaux. L’envie de passer à l’acte a été favorisée par cette période particulière, tandis que le télétravail forcé a renforcé la nécessité de préciser le sens, la raison d’être ensemble. Au moment du retour au bureau, nombre d’entreprises ont saisi l’opportunité de réfléchir à cette raison d’être, pour rassembler les équipes et les faire réfléchir à ce sur quoi leur organisation pouvait contribuer.
La dynamique actuelle touche tout type d’entreprise, de toute taille et de tout secteur. Qu’il s’agisse des grandes organisations, des PME, des sociétés familiales, des structures de l’ESS, des coopératives, des mutuelles ou des entreprises cotées. Qu’elles évoluent dans les services, la finance ou l’industrie. Et toute entreprise a un rôle à jouer et à gagner à clarifier sa raison d’être. J’ai la conviction qu’il s’agit d’un puissant levier de transformation de la société, et que c’est l’occasion pour les entreprises de se saisir des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux actuels. Elles doivent assumer leur rôle important dans ce cadre, prendre leurs responsabilités dans leur rôle sociétal, en définissant leur raison d’être et en s’engageant activement.
LIRE AUSSI : Embarquez vos parties prenantes grâce à l’Entreprise à Mission
Quel rôle à jouer pour les collaborateurs et managers au sein des entreprises à mission, et celles souhaitant le devenir ?
Au sein des entreprises à mission, les collaborateurs ont un rôle déterminant à jouer. Parce qu’ils participent souvent à l’élaboration de la raison d’être et des objectifs de mission, afin de ne pas être déconnectés des pratiques de l’entreprise. Et aussi parce qu’ils mettent en œuvre et traduisent opérationnellement les objectifs de mission. À la différence de la RSE qui peut être un département de l’entreprise, la mission est au cœur des pratiques de celle-ci, de son modèle économique et de son offre. C’est aux managers de rappeler régulièrement la mission de la société, de se saisir de la feuille de route et de la traduire en actions opérationnelles. La mission, bien définie, simplifie leur tâche, car elle constitue pour eux une boussole à suivre ; mais il leur appartient de faire le lien entre les actions du quotidien (les opérations) et la mission.
Quand la société n’est pas encore une entreprise à mission, et que le dirigeant souhaite qu’elle le devienne, là encore, collaborateurs et managers ont un rôle important. Il faut souligner que cette démarche de transformation vers ce modèle d’impact positif ne peut venir que du dirigeant ; mais qu’il ne peut pas l’initier seul. Il s’agit d’un projet collectif, et dans la plupart des cas, un certain nombre de managers sont mobilisés ; des managers engagés, qui ont envie de redonner du sens à l’entreprise, et qui vont porter la démarche (notamment au sein de petits groupes étendus, où ils côtoient des experts, des fournisseurs, les DRH et les dirigeants).
On voit aussi souvent des cadres et des managers qui font pression, d’eux-mêmes, de l’intérieur, pour que l’entreprise se transforme en société à mission. On les appelle les “corporate activistes”, ou “corporate hackers”. Chez Suez, par exemple, un petit groupe de managers et de collaborateurs engagés s’est constitué, et réclame le passage vers ce modèle d’entreprise à mission ; c’est-à-dire la clarification de ce que tous les membres de l’organisation font ensemble et de ce sur quoi ils peuvent avoir un impact. Ils font bouger leurs entreprises de l’intérieur, parce qu’ils recherchent du sens dans leur travail ; jusqu’à ce que leurs dirigeants finissent par prendre en main la démarche de transformation vers ce nouveau modèle.
LIRE AUSSI : “Covid-19 ou pas, il est grand temps de démocratiser l’entreprise !” (Dominique Méda)