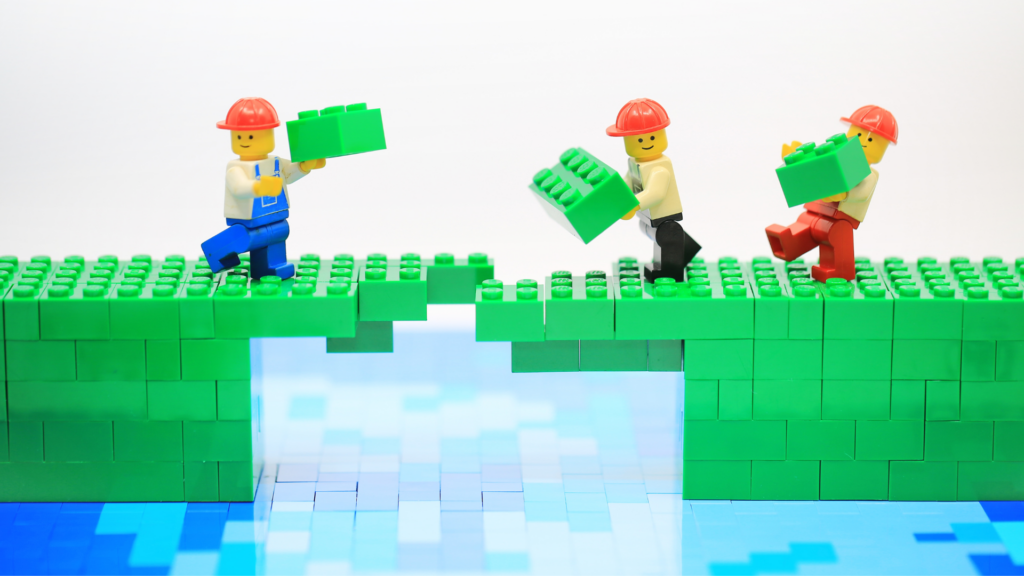Augustin Paluel-Marmont a fondé avec Michel De Rovira, au début des années 2000, la marque Michel et Augustin. Ces deux toqués, comme ils se présentent eux-mêmes, sont des trublions du goût autant que du marketing et du management.
Quel a été votre parcours et comment l’entreprise est-elle née ?
J’ai fait la fac puis l’ESCP (Sup de Co Paris). J’ai ensuite travaillé à la direction de la stratégie au Club Med, que j’ai quitté pour monter une première entreprise. J’en étais co-fondateur mais je n’ai jamais vraiment compris l’activité de la boîte. Elle faisait des logiciels d’optimisation de process industriels, basés sur des algorithmes à la logique floue. J’y ai passé neuf mois, mais c’était pour moi une vraie épreuve humaine. Lorsque je suis parti, j’ai voulu me ressourcer et apprendre un vrai métier de mes dix doigts. J’ai passé un peu par hasard mon CAP de boulanger en candidat libre, en faisant un apprentissage de manière informelle dans la boulangerie de mon quartier.
Pourquoi alors que vous étiez diplômé d’une grande école comme Sup de Co Paris, avez-vous cherché à vous tourner vers un métier manuel ?
J’étais un peu frustré en sortant d’école de commerce de ne pas avoir de métier. Aujourd’hui mon vrai métier, c’est boulanger. Et puis j’aime l’ambiance des fournils, je suis gourmand… Après l’obtention de mon CAP, j’ai passé deux ans à la direction marketing Europe d’Air France. C’est une très jolie entreprise que j’aime beaucoup, mais j’en suis parti parce qu’elle n’était pas faite pour moi. C’est à ce moment-là que j’ai pris une année sabbatique pour écrire un guide. J’ai fait le tour des 1 200 boulangeries de Paris avec un copain prénommé Michel (De Rovira, co-fondateur de Michel et Augustin, ndlr). Nous l’avons sorti en 2003 et nous en avons vendu 12 000 exemplaires. Nous avons eu ensuite envie de nous lancer dans un nouveau projet. J’ai toujours sur moi un petit livret qui s’appelle Chasseur de papillons, sur lequel je note mes ressentis de consommateur qui ne sont pas satisfaits par le marché. Et parmi les choses qui y figuraient, il y avait la volonté de créer une nouvelle aventure gourmande, avec des produits composés d’ingrédients que tout le monde a chez soi dans son placard ou dans son réfrigérateur. Par chance, la première boîte que j’avais fondée a été vendue à ce moment-là à un fonds américain, Partech. Cela m’a permis d’avoir un peu de sécurité financière pour monter Michel et Augustin.
Comment les mastodontes du secteur ont-ils réagi lorsqu’ils vous ont vu arriver ? Vous ont-ils pris pour des farfelus ?
Oui, mais c’est normal. Nous sommes quand même partis de ma cuisine de 5 mètres carrés, rue Hermel dans le XVIIIe arrondissement de Paris. La vision que l’on avait été assez claire dans nos esprits mais elle n’était pas visible et n’était pas lisible pour le grand public et pour les gros acteurs du marché. Personne ne comprenait ce que l’on faisait. Huit ans après, nous sommes encore tout petits. Même si nous avons une vraie notoriété chez ces personnes, c’est encore une démarche très atypique d’être à ce point-là multi-catégories, très qualité, nous sommes essentiellement urbains, nous ne faisons pas de pub… nous sommes encore un Ovni !
Vous avez commencé dans votre cuisine. Comment se sont passé les débuts de l’entreprise ?
C’est très simple. C’est comme si vous rentriez chez vous et que vous vous disiez : “Je vais faire des petits biscuits dans ma cuisine, comme ce que l’on fait à Noël avec les enfants, et je vais commencer à les vendre en faisant du porte-à-porte”. C’était vraiment ça. J’ai acheté des petites panières en osier chez Ikea. Je glissais mes sablés dans des petits sachets plastiques, je faisais des nœuds et je mettais une petite étiquette découpée à la main et imprimée sur mon imprimante à la maison. Nous avons vécu une histoire extrêmement linéaire. Nous n’y connaissions rien et, avec du bon sens et de l’énergie, nous avons franchi les étapes les unes après les autres pour arriver là où nous en sommes aujourd’hui.
En allant frapper à la porte des commerçants du coin…
Oui, nous étions connus un peu comme les deux scouts, les deux étudiants attardés du quartier… et puis sommes rentrés à la Grande Épicerie, chez Colette, Monop’, ensuite nous sommes allés voir Carrefour. Et pour y parvenir vous appelez tout simplement Carrefour, vous demandez la personne qui s’occupe des biscuits et vous lui téléphonez. C’est extrêmement pragmatique comme démarche.
Cela ressemble pourtant à une histoire entrepreneuriale d’une autre époque. Il est donc encore possible aujourd’hui de commencer comme cela ?
Oui, c’est possible ! Mais je crois que l’un des éléments qui explique notre petit succès (restons quand même très modestes, nous ne sommes pas Facebook !), c’est l’authenticité de la démarche. C’est vraiment une histoire de gourmands, de passionnés, de valeurs que nous avons au fond de nos tripes. Et aujourd’hui, ce que j’apprécie le plus, c’est sans doute la culture d’entreprise que nous avons. Ce sont maintenant 55 personnes qui vivent pleinement cette aventure, qui ont ces valeurs, qui sont passionnées, engagées, hyper sérieuses, très proactives… et tout cela dans une ambiance très sympathique, très joyeuse. Je crois que ce qui compte, c’est vraiment d’être habité par son projet et d’avoir des convictions fortes. Sinon on abandonne très vite.
S’amuser et travailler, est-ce vraiment compatible ? Ou est-ce une vision idéalisée de l’entreprise ?
Je ne crois pas qu’il s’agisse de s’amuser, je dirais plutôt qu’il faut être passionné. À ce moment-là, on peut faire les choses dans la bonne humeur, dans un climat sympathique. Pour nos recrutements, nous avons 5 critères clés. Et le premier, c’est d’être sympa. Effectivement, c’est totalement subjectif, mais nous passons tellement de temps ensemble que c’est très important d’avoir une affinité personnelle avec les gens. Et ce n’est pas par hasard que la valeur fondatrice de l’aventure Michel et Augustin, c’est l’amitié. Michel et moi, nous sommes copains depuis les bancs du collège, en classe de 4e. J’ai plusieurs amis qui travaillent à La Bananeraie (les locaux de l’entreprise situés à Boulogne-Billancourt, ndlr) et c’est un grand plaisir.
N’est-ce pas un piège ? Ne craignez-vous pas que cela se retourne contre vous un jour ou l’autre ?
Oui, mais je préfère prendre le risque, essayer. Je ne crois pas au principe de précaution qui dit qu’il ne faut surtout pas bosser avec des amis. La vie est courte et j’ai envie de vivre les choses intensément, avec bonheur. Je préfère passer deux heures avec ma DRH qui est une amie proche qu’avec quelqu’un que je ne peux pas encadrer. Oui, de temps en temps, cela ne va pas, parfois on se plante, nous avons eu des échecs de recrutement… c’est la vie. Je crois que nous sommes tous acteurs de nos vies et ce qui est important, c’est que chacun trouve le terreau dans lequel il peut exprimer au mieux ses talents.
Prendre le côté sympathique comme critère de sélection ne vous fait-il pas passer à côté de talents avec qui vous pourriez ne pas vous entendre, mais qui pourraient apporter beaucoup à l’entreprise ?
Sympa ne veut pas forcément dire “le meilleur copain”. Cela n’exclut pas la différence. Nous ne trouvons pas sympathique et nous ne recrutons pas que des gens qui nous ressemblent. En revanche, quelqu’un d’extrêmement talentueux, avec qui je n’ai pas de “fit” humain ? C’est peut-être une faiblesse, mais je ne le ferai pas.
Comment les candidats sont-ils intégrés à leur arrivée ?
Le processus de sélection est assez long et une fois qu’ils sont là, ils n’ont rien à faire durant deux semaines. Ils ne sont pas du tout embarqués sur leur poste opérationnel, ils ne sont vraiment que dans l’observation et dans l’échange sur chacun des chantiers qui constituent l’aventure Michel et Augustin. Après il y a plein de petits rites avec la remise du tablier, l’organisation d’un apéro pour tout le monde, ils doivent faire une recette. Il y a tout un rituel d’intégration, avec des moments assez forts.
Quel est l’objectif ? Créer des liens, casser la glace…
Nous sommes là pour favoriser le plaisir d’être ensemble. Nous avons tous une vie privée, ce n’est pas une secte, mais il est clair que c’est une culture d’entreprise à laquelle il faut adhérer. Je ne crois pas du tout à l’idée qu’il y a la vie au bureau et la vie à la maison… je suis dans l’unicité des hommes et des femmes. Si l’on veut être épanoui, il faut que tout cela soit uni.
Quelqu’un qui resterait en retrait rencontrerait-il des difficultés?
Tout à fait. Nous avons eu des échecs. Il y a des gens que nous n’aurions pas dû recruter parce que cela ne leur correspondait pas et il y a des gens que nous n’avons pas su accompagner parce que nous n’avions pas nous-mêmes la maturité pour le faire. Depuis un an et demi, nous avons beaucoup progressé. Mais c’est une ambiance qui est assez clivante, dans le sens où cette espèce d’unicité ne plaît pas à tout le monde.
La presse s’est fait récemment l’écho de reproches d’anciens salariés qui disaient que l’aspect trublion n’était parfois que de façade et que les critiques étaient difficilement acceptées. Que répondez-vous à cela ?
Vous faites allusion à un article de Libération. Ce que je n’apprécie pas, c’est que les gens ne soient pas transparents et honnêtes. Et ce que je réponds à cela, c’est venez quand vous voulez à la Bananeraie, discutez avec qui vous voulez, je n’ai jamais fermé les portes aux journalistes. Je suis parfaitement cohérent par rapport à mes valeurs. Nous avons fait des erreurs, on s’améliore comme tout le monde. Tout ce que je souhaite, c’est que les gens soient heureux.
Effectivement chez nous, les gens sont acteurs de leur vie, ils se prennent en main. Ici, il y a beaucoup d’autonomie, il y a des domaines sur lesquels je n’interviens plus du tout. Et il y en a d’autres dans lesquels je suis très présent parce que ce sont des sujets sur lesquels je pense avoir une expertise encore forte et une vraie valeur ajoutée. Reste que toutes les critiques constructives sont les bienvenues. Mais les salariés eux-mêmes doivent aussi accepter la critique, cela va dans les deux sens.
N’est-ce pas justement lié à l’image que vous avez su construire au plan marketing, qui rejaillit sur l’approche managériale. Ne suscite-t-elle pas davantage d’attentes que dans une autre entreprise ?
Je suis tout à fait d’accord. Et c’est pourquoi il faut que ce que l’on dise corresponde à une réalité. Après, il y a toujours à gérer le décalage entre l’image pittoresque et la réalité de l’entreprise derrière. C’est pourquoi je précise bien que si l’ambiance est très sympathique, il y a un gros niveau d’exigence, ce n’est pas Alice au pays des Merveilles. Il y a une entreprise à faire vivre, il y a des responsabilités, des finances à tenir.
Cet article dont vous parliez, je n’ai pas apprécié la façon dont il a été fait mais, d’un autre côté, je pense qu’il est bénéfique pour nous. Les gens ont droit de penser ce qu’ils veulent et cela nous permet de dire que Michel et Augustin, ce n’est pas non plus le monde merveilleux de Mickey.
Comment insufflez-vous l’esprit d’innovation au quotidien ?
Il faut déjà avoir une certaine sensibilité consommateur et être extrêmement attentif au monde qui nous entoure dans notre vie quotidienne, pour en permanence, de manière indolore, analyser ce qui se passe autour de nous… et comme le chasseur de papillon pouvoir attraper des idées quand elles passent devant vous. Il faut vraiment être dans l’échange, ne jamais garder les trucs pour soi, en parler, se stimuler. Personnellement, c’est souvent en faisant du sport que j’ai des idées et ce qui est important, c’est de sortir de son quotidien, de s’aérer, parce que la créativité ne naît pas dans la routine. Ce qui me fait très peur, c’est le poids des habitudes. Il faut toujours être en mouvement. Et c’est souvent en ne sachant pas très bien où l’on va que l’on trouve un truc exceptionnel
Comment définissez-vous votre vision du management ?
Ma vision est que le manager doit créer l’écosystème pour que chaque personnalité s’épanouisse et soit son propre patron. Par exemple, on ne vient jamais me voir avec une question, du type que fait-on ? On vient avec une question, des pistes de solutions et une recommandation. Ce dont je rêve, c’est d’avoir 55 entrepreneurs. Mon job est de faire en sorte que chacun soit le plus épanoui et le plus heureux possible. Et il ne s’agit pas de faire le boulot à la place du voisin, je laisse beaucoup d’autonomie, beaucoup de responsabilités, beaucoup de prise d’initiatives. On a le droit de se planter une fois, en revanche nous avons un niveau d’exigence qui est très important, parce que nous allons vraiment dans le détail, nous ne laissons rien passer. Ce qui compte, c’est de toujours avoir une entreprise qui apprend. Chaque jour on doit faire mieux que la veille, c’est très important d’être toujours dans une dynamique d’apprentissage.
Quels sont vos projets futurs ?
Déjà c’est de devenir incontournables dans les 10 plus grandes villes de France, nous sommes vraiment une marque urbaine. Nous avons aussi un gros sujet sur l’export. Nous avons de grandes ambitions en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et aux États-Unis. Il y a un potentiel exceptionnel pour nous. Nous avons aussi d’autres projets qui vont nourrir l’aventure comme celui d’une pension de famille, un autre sur le Web…