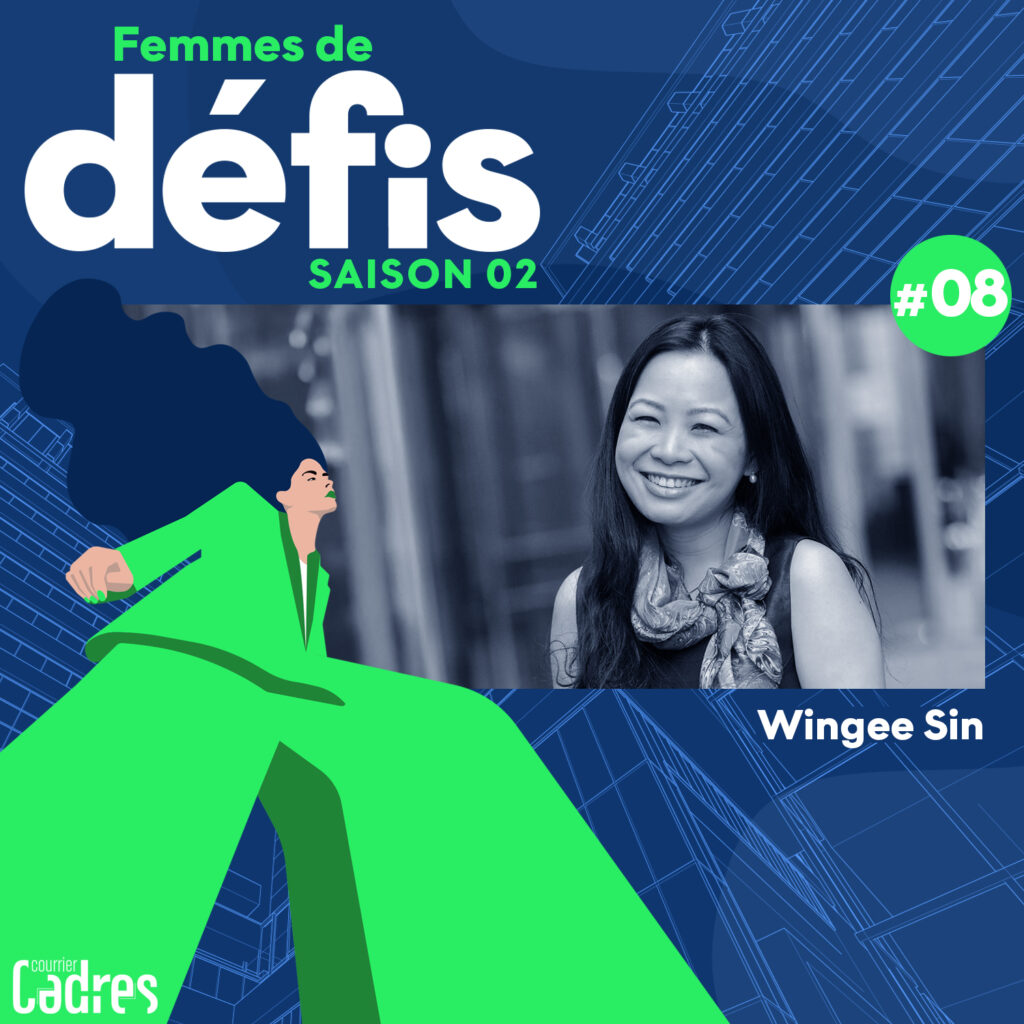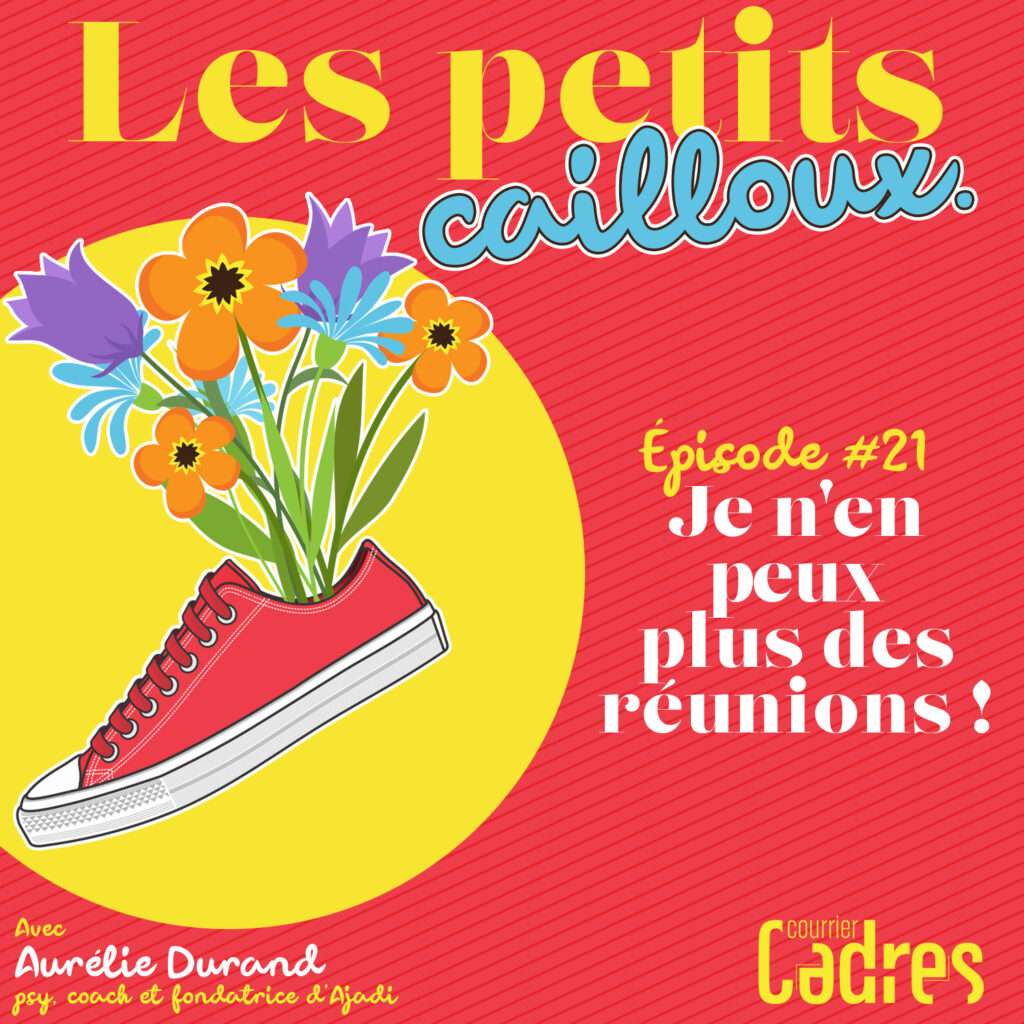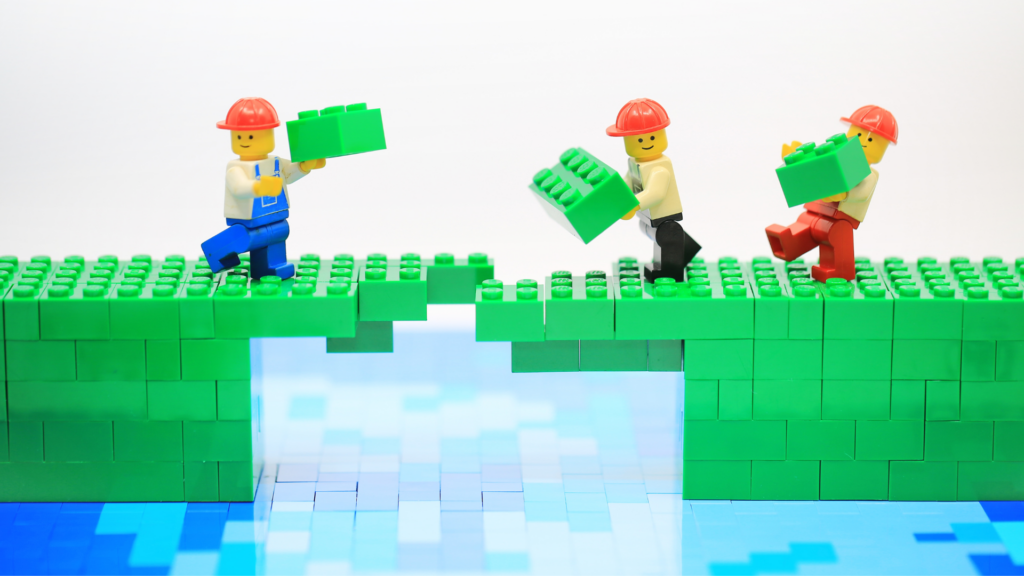Tribune – Ubérisation, l’un des termes les plus médiatisés de ces derniers mois et dont nous n’avons pas fini d’entendre parler dans la sphère économique. À quoi exactement ce néologisme, formé à partir du nom de la célèbre société de transports californienne Uber, fait-il référence ? Quelles sont ses sphères d’applications ? En quoi l’ubérisation est-elle devenue la première préoccupation des dirigeants tous secteurs confondus ? Par Benjamin Barès, directeur de la division entrepreneurs et professionnels chez Hiscox.
Maurice Lévy, patron de Publicis, est le premier à avoir popularisé le terme dans son interview de 2014 accordée au Financial Times. Il n’existe actuellement pas de définition officielle, mais l’ubérisation renvoie à l’apparition de nouveaux concurrents – start-up ou entreprises liées à la sphère digitale – qui viennent bouleverser une activité économique traditionnelle. Cette nouvelle forme de concurrence est très nettement favorisée par le numérique. Uber, d’où provient le terme, et son service à prix cassés dans le secteur du transport en est le parfait exemple. Son business model a battu tous les records, tout en mettant en péril toute une profession, certes critiquée : les chauffeurs de taxi. Dans d’autres secteurs, nous pouvons souligner les performances d’Airbnb dans l’hôtellerie ou de Deezer dans la musique.
Beaucoup d’acteurs historiques et de patrons s’alarment face à l’ubérisation, de peur que de nouveaux entrants viennent bouleverser également leur secteur. Ce tsunami numérique redessine considérablement les marchés traditionnels car l’objectif de ces nouveaux concurrents est de réduire au maximum les intermédiaires via leur plate-forme en ligne et autres services numériques. D’ailleurs, le terme ubérisation est également utilisé pour parler de l’économie de partage ou d’innovation. Michel Bauwens, théoricien de l’économie, explique : “qu’il s’agit plutôt d’une mise sur le marché des ressources qui n’étaient pas utilisées”.
Depuis plus d’un an, nous voyons une large partie de l’économie “se faire ubériser”. L’Observatoire de l’ubérisation dresse d’ailleurs une cartographie des secteurs ubérisés.
Le marché de l’assurance est-il ubérisable ?
L’assurance est avant tout un marché très règlementé. La mise en application de la Directive sur la Distribution d’Assurances (DDA) risque de rendre ce secteur difficilement ubérisable.
Après trois années de gestation, la DDA a été rendue officielle par le parlement Européen le 2 février dernier. Celle-ci réorganise en profondeur les pratiques de la distribution d’assurances et de réassurances en France et en Europe. L’objectif étant d’harmoniser le marché de l’assurance et de permettre à tous les consommateurs européens de souscrire à des contrats sur un pied d’égalité. Son application en droit français se fera le 23 février 2018.
La DDA vise à assurer un niveau de protection égal pour l’ensemble des acteurs du marché : clients, entreprises d’assurances, intermédiaires et autres acteurs commercialisant des produits d’assurances tels que les banques et les agences de voyage.
Les principaux dispositifs qui vont poser problème dans la démarche d’ubérisation du marché par les acteurs du numérique sont les règles relatives à la protection du consommateur. La DDA impose, en effet, un devoir de transparence et de conseil. L’ensemble des distributeurs ont ainsi pour obligation de fournir des informations de meilleures qualités et objectives sur le contrat d’assurance. Il s’agit de faciliter la compréhension de l’information précontractuelle pour les consommateurs.
La DDA oblige également une transparence au niveau de la rémunération des intermédiaires, des réseaux salariés et des comparateurs, etc.
En résumé, cette nouvelle directive annonce de profonds changements pour tous les réseaux distributeurs qui vont voir le contrôle sur leur mode de rémunération s’intensifier.
Aubaine ou danger ?
La DDA, en clair, permet à la France de préserver son modèle traditionnel de distribution des produits d’assurance par le biais de ces nouvelles modalités. Néanmoins, il est également judicieux de surveiller de très près les acteurs du numérique. En exemple, l’investissement de 13 millions de dollars du capital-risque Sequioa Capital (groupement Google, Apple, Airbnb etc.) en début d’année dans Lemonade. Cette start-up est la première plate-forme peer-to-peer d’assurance dont le fonctionnement repose sur le fait que les assurés se regroupent pour payer des primes de manière mutualisée.
Alors, “ubérisation”, source d’opportunités ou véritable danger pour notre économie ?
D’un point de vue consommateurs, l’ubérisation est une aubaine. On retient principalement les avantages prix, l’amélioration des services ou encore la transparence et l’optimisation de la relance client grâce aux systèmes de notation.
Néanmoins, l’ubérisation comporte également quelques désavantages. Les salariés pointent du doigt, entre autres, la disparation du CDI. Idem pour l’encadrement du droit de travail : quelles garanties pour les indépendants sous cette nouvelle économie numérique ? Comment remplacer ces emplois uberisés ?
Comme n’importe quelle révolution, numérique ou industrielle, l’ubérisation laisse des questions sans réponses et suscite des avis partagés. Véritable source d’opportunités ou non pour l’économie, nous ne pourrons en voir les effets qu’à plus long terme. Pour contrer cette nouvelle forme de concurrence, les entreprises qui s’inscrivent dans un modèle économique traditionnel doivent redoubler d’efforts pour ne pas se laisser dévorer par la vague du tout numérique.
Autre que l’ubérisation, d’autres tendances fortes se dessinent dans le paysage économique actuel. Le retour à un mode de consommation axé sur la qualité et le service (gestion de la relation client, etc) sont aussi des options à explorer pour les entreprises en quête d’innovation et non d’ubérisation.
En somme, l’ubérisation de tous les marchés ne doit pas être une obligation. Il s’agit avant tout d’une évolution de marché à travers laquelle les organisations doivent avoir le choix de s’aligner ou non à cette nouvelle forme de concurrence. Nous préconisons principalement à tous les acteurs impliqués de mener une veille active afin de maintenir leur avantage compétitif et anticiper toutes évolutions (ubérisation ou non).