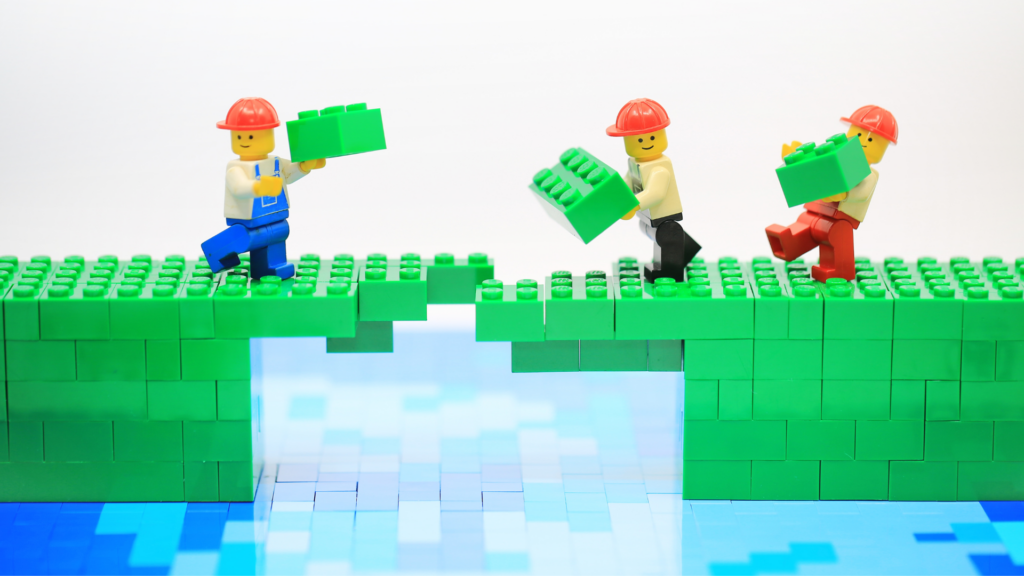À 42 ans, François Locoh-Donou, senior vice-president global products group chez Ciena*, est un parfait exemple de ces Sucess Stories comme sait les façonner l’Amérique. Mais son parcours illustre aussi cette fuite des cerveaux à laquelle sont confrontées les terres de ses origines : l’Afrique (et plus précisément le Togo) et la France… Entretien. Propos recueillis par Aline Gérard.
De l’œuf ou de la poule, on pourrait presque dire en ce qui concerne votre carrière que la seconde est au commencement. Est-ce exact ?
C’est une version très résumée (rires), mais oui ! J’ai grandi au Togo, en Afrique, jusqu’à l’âge de 15 ans. Quand j’avais 8 ans, mon grand-père nous avait offert chacun la nôtre à mon frère, ma sœur et moi. J’ai racheté les leurs et j’ai commencé un élevage de poules. Ma mère est française et lorsqu’elle a décidé de quitter mon père et de rentrer en France en 1985 avec ses enfants, elle nous a demandé à tous si nous étions d’accord pour quitter le Togo. Je lui ai alors dit oui, à deux conditions. La première était que je puisse continuer mon élevage de poules en France. Et la deuxième que je puisse jouer au Paris Saint-Germain. Elle a accepté pour les deux. En réalité, en guise d’élevage de poules, elle m’a donné deux mandarins dans une cage à mettre dans notre appartement à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Et pour le Paris Saint-Germain, elle m’a mis au club de foot local, en me disant : “Quand tu seras meilleur, tu iras au PSG”. Après quelques années, lorsque j’ai commencé à gagner un peu d’argent, j’ai voulu faire quelque chose en Afrique et créer des emplois, et je suis revenu aux poules. Avec un ami d’enfance, nous avons donné vie à ce qu’on avait appelé La Ferme de l’Espoir, une ferme de poulets.
Pour en revenir au cœur de votre parcours, qu’est-ce qui vous a attiré dans l’univers des télécommunications ?
J’ai fait des classes préparatoires avant d’intégrer une école d’ingénieurs, à l’époque l’École nationale supérieure de physique de Marseille, par la suite devenue l’École centrale de Marseille. J’ai ensuite fait une spécialisation, un master en télécoms optiques à l’ENST (aujourd’hui Télécom ParisTech, ndlr).
J’étais relativement bon en mathématiques et en physique. Et lorsqu’il a fallu choisir l’école d’ingénieur en fonction du classement aux concours, je dois bien avouer qu’en tant que fan de football, j’ai plus regardé le lieu que la spécialisation ! J’ai choisi Marseille parce que je savais que je pouvais jouer au foot toute l’année. J’y ai fait de la physique générale, j’ai un peu touché à tout : semi-conducteurs, fibre optique, électronique, informatique, etc. Et les fibres optiques m’ont bien plu. J’aimais la propagation de la lumière dans la fibre, je trouvais cela fascinant. À l’époque, c’était un peu les prémices.
J’ai ensuite intégré une société française qui s’appelait Photonetics. Je faisais de la recherche et développement dans le domaine des capteurs à fibre optique. Cette société m’a envoyé à Boston pour faire mon volontariat du service national en entreprise (VSNE). Après deux années, on m’a demandé de rentrer mais je ne le souhaitais pas. Je voulais continuer mon aventure aux États-Unis et voir autre chose que les labos de recherche et développement. Je voulais passer du côté technico-commercial. J’ai alors envoyé des candidatures à différentes entreprises et c’est ainsi que j’ai eu l’opportunité de rejoindre Ciena, basé à Washington. C’était en 1997.
Pourquoi ce désir de poursuivre l’aventure américaine ?
C’est un pays qui m’intriguait. J’ai vu le bon côté de l’Amérique, avec des gens très positifs, très ouverts. Par rapport au style de management que j’avais connu, je trouvais qu’il y avait une façon de faire très différente. À mes yeux j’avais beaucoup à y apprendre en tant que Français.
En quoi le management à l’américaine était-il si différent ?
Tout d’abord par le regard porté sur les choses. Chez les Américains, ils avaient tendance à renforcer le positif et à l’encenser. Et pour moi, c’est une façon de faire sortir ce qu’il y a de mieux chez les gens, de les motiver. Le challenge m’allait donc bien. Le deuxième aspect était la prise de risque. J’ai vite compris qu’au début de ma carrière, une société américaine serait plus à même de prendre des risques sur moi. En tout cas plus que la société française pour laquelle je travaillais. Celle-ci avait une division qui vendait des lasers télécoms aux États-Unis et qui faisait à peu près 6 millions de dollars de chiffre d’affaires. Je leur avais donc demandé de passer commercial et de m’occuper de les faire croître. Mais ils m’ont rétorqué : “Surtout pas, tu ne peux pas ! Tu es un ingénieur de recherche, tu travailles dans les labos, tu n’as jamais fait de vente, c’est un trop gros risque pour nous”. Je suis donc passé chez Ciena qui m’a proposé justement de devenir technico-commercial et de travailler sur des contrats bien plus gros que 6 millions de dollars. Six mois après, je leur faisais gagner un deal de 80 millions.
La France aurait-elle tendance à mettre les gens dans des cases ?
Exactement. En France, on pense parfois petit. Il n’est pas question pour moi de passer mon temps à critiquer le management français, mais à l’époque en tout cas, il m’est apparu que pour accélérer ma carrière, les États-Unis m’offriraient une meilleure opportunité.
Pourtant en 2002, vous quittez Ciena pour faire un MBA full-time de deux ans. Était-ce indispensable pour progresser dans l’entreprise ?
Non, ce n’était pas le but. Ciena était une société en forte croissance, je progressais donc bien. J’ai commencé comme technico-commercial aux États-Unis. Au bout d’un an, ils m’ont renvoyé en Europe pour construire une équipe. Pendant 18 mois, nous avons gagné pas mal de contrats, nous avons vraiment établi la présence de l’entreprise, essentiellement en France et en Angleterre. Ciena voulait aller encore au-delà de ces deux pays. J’ai donc demandé à passer purement commercial et à prendre la responsabilité de l’Allemagne. Voilà d’ailleurs encore un exemple du type de risque que j’étais prêt à courir et que la société était également prête à prendre. Je suis devenu country manager, alors que je n’avais quasiment jamais mis les pieds en Allemagne, que je ne parlais pas l’allemand, et que je n’avais clairement pas le profil du businessman allemand accompli. Il y a eu d’ailleurs pas mal de rendez-vous où les clients passaient trois fois devant moi puis allaient finalement demander à la réceptionniste où était le responsable pays de Ciena.
Nous avons fait grossir le business à 30 millions de dollars. À ce moment-là, fin 1999, c’était l’explosion des start-up. Je souhaitais faire un MBA avec l’objectif d’aller en créer une. C’est pour cela que je suis allé à Stanford, dans la Silicon Valley. Je suis parti en septembre 2000 de Ciena, ce qui était une décision difficile, je touchais énormément avec les stock-options.
Ces deux années là-bas ont été superbes, mais en 2002, quand je suis sorti, la bulle Internet avaient explosé, aucun venture capitalist ne voulait investir. Mes collègues de MBA partaient chez les banquiers d’investissement comme consultants. J’ai moi aussi fait ce type d’entretiens, j’ai eu des offres. Mais j’avais gardé des relations avec Ciena. Celui qui était chef des ventes internationales au début de ma carrière était devenu CEO. Il m’a appelé. Il tenait à ce que je revienne comme chef du marketing monde de Ciena. J’avais adoré mon expérience là-bas, donc je me suis dit “pourquoi pas ?”.
Même si l’enjeu était beau, n’était-ce pas un retour en arrière ?
Pas du tout. Je n’avais pas quitté Ciena parce que je voulais partir de l’entreprise, mais parce que je m’étais toujours dit que je ferais ce MBA pour me développer. C’était le bon moment pour le faire. Ce n’est pas le genre d’expérience que l’on peut acheter. Se retrouver avec 360 personnes qui viennent de tous les horizons de la vie, des athlètes, des consultants, des acteurs, des banquiers et bénéficier de toute leur expérience, de leur influence, de leur vision de la vie… pour moi qui avait principalement passé mon temps avec des ingénieurs, c’était fascinant. C’était un MBA full time, durant deux ans j’ai vécu avec ces gens sur le campus, 24 heures sur 24.
Il faut pouvoir mettre sa carrière en suspens…
Complètement. Quand je suis allé à Stanford, les gens me disaient que j’étais fou. Même mes boss à qui je demandais de faire des lettres de recommandation m’expliquaient que les gens avec qui j’allais être à Stanford faisaient ce MBA pour gagner ce que je touchais. Mais je n’avais jamais étudié sur les campus américains, et c’est une expérience unique. Je savais que je ne la ferai pas à 40 ans, et que c’était maintenant ou jamais.
Après avoir eu la tête qui tournait lors de ce MBA avec ces consultants, ces banquiers qui me disaient qu’il fallait aller chez J.P. Morgan, faire de gros deals, ou chez McKinsey, traiter avec tous les CEO de la planète et leur exposer des stratégies à adopter, que je serai ainsi le roi du monde, j’ai fait beau-coup d’introspection. J’ai réalisé qu’en fait ce qui me passionnait et ce que j’aimais faire, ce qui me donnait de l’énergie, c’était de mener les hommes et les femmes. C’était de diriger les équipes pour faire des choses qui potentiellement changeaient le monde. Construire du PowerPoint chez McKinsey, le donner à un CEO sans savoir ce qu’il en ferait, opérer des transactions financières sans produire… tout cela était peut-être prestigieux mais ce n’était pas ce qui me correspondait. Je suis sorti de là davantage en paix avec moi-même. Je savais qui j’étais et où est-ce que je m’épanouirais le plus.
Quand je suis revenu à Ciena, c’était vraiment un challenge. Je n’avais jamais fait de marketing et j’allais encadrer une équipe de 40 personnes qui connaissaient parfaitement le métier. Cela traduit d’ailleurs un peu le fil rouge de ma carrière, la prise de risque. Comme je le dis aux gens ici parfois, il n’y a pas un job que j’ai pris à Ciena qui ne m’ait pas effrayé et empêché de dormir.
Quelle est votre philosophie du management ?
J’ai grandi dans une dictature au Togo. J’ai vu les dégâts et l’absurdité du management par la force. Ma philosophie, presque par réaction allergique, est un peu l’antidote de cela. Je considère que les vrais leaders sont sélectionnés par le bas. Le fait d’être désigné comme le manager d’une organisation ne vous en fait pas le leader. Vous en devenez le leader le jour où les gens qui sont dans cette organisation décident de vous suivre. Le leadership se gagne, s’obtient en obtenant la confiance et le suivi des gens qui sont en dessous de vous.
L’autre message, c’est que dans l’industrie de la technologie notamment, où la logique analytique est importante, beaucoup de managers viennent des fonctions techniques et s’imposent par cette crédibilité, par ce qu’on appelle le left brain, leur capacité à raisonner, à contrôler les choses. En revanche, ce qui n’est pas mis en valeur et pas du tout appris aux gens, c’est comment gérer et manager avec le cœur. C’est pourtant par ce biais que vous créez une connexion émotionnelle et que vous leur donnez envie de vous suivre, de se donner véritablement pour cette aventure. Cette connexion, vous la créez quand vous exprimez vous-même vos émotions, vos vulnérabilités, lorsque vous vous exposez, avec votre authenticité, vos faiblesses comme vos forces. Et dans les organisations des grandes sociétés, on vous apprend presque à ne pas le faire. On vous dit qu’il faut être en contrôle, ne pas montrer ses faiblesses, il faut montrer que l’on gère, qu’on a les réponses. Je passe beaucoup de temps à reprogrammer les gens là-dessus, à leur dire : “Votre source de pouvoir la plus importante, c’est votre cœur”.
À chaque fois que vous avez pris un poste cela semble avoir fonctionné… Avez-vous tout de même connu des échecs ?
J’ai eu des échecs. Dans les jobs que j’ai pris, j’ai eu de gros moments de doute, j’ai eu l’impression d’être en situation d’échec. Je me mets beaucoup de pression. Mais à l’arrivée, j’ai réussi à surmonter ces périodes et j’en suis ressorti plus fort car finalement j’ai réussi dans ces jobs. Par exemple, les trois premiers deals en Allemagne, je les ai perdus. Je me suis alors retrouvé avec le chef des ventes mondiales qui m’appelait toutes les semaines et me disait : “Quand est-ce que l’on va avoir du chiffre ?”. J’avais perdu les deals, j’étais en période de doute, je me disais que j’étais incapable de gagner un contrat, avec en plus ces situations où les clients me regardaient à peine. Ma force a peut-être été une forme de ténacité, de foi, une volonté de ne pas abandonner. Finalement, j’ai gagné un premier contrat qui était tout petit : 60 000 dollars. Les gens de Ciena m’ont d’ailleurs offert une plaque du plus “petit deal jamais gagné”. C’est devenu une blague mais cela m’a donné une confiance énorme. Je pouvais le faire. Le deal suivant faisait 30 millions de dollars !
Ma carrière est la combinaison entre ce type de risques que j’ai pu prendre et ceux qu’ont pris des personnes qui voyaient en moi ce que moi-même je ne voyais pas. Les gens ont le sentiment qu’ils vont devenir vice-président, senior vice-président par eux-mêmes. On y contribue bien évidemment, mais en réalité la seule façon est d’être porté au top d’une organisation. Par ceux qui sont au-dessus de vous et qui vous tirent en vous donnant des responsabilités… et par les gens qui travaillent à côté de vous et pour vous. En croyant en vous et en étant eux-mêmes performants, ils vous aident à réussir.
On parle souvent de la fuite des cerveaux et des talents de l’Afrique ou la France vers les États-Unis. Vous en êtes un parfait exemple. Vous qui avez à un moment donné voulu créer votre start-up, n’avez-vous pas envie de construire ce type de projet en Afrique ?
Si ! Et c’est la grande question de ma vie ! Ma mission, on pourrait presque parler de cela, est à mes yeux d’utiliser au maximum les opportunités auxquelles j’ai eu accès dans le monde occidental, à la fois en France et aux États-Unis, pour en créer de nouvelles pour mes compatriotes au Togo. Il y a peut-être un moment de ma vie où je le ferai en m’y installant de façon permanente.
Depuis mon premier salaire, j’ai toujours pensé à en investir une partie en Afrique. Cela a commencé par la Ferme de l’Espoir. Cela a duré 10 ans et finalement cela n’a pas marché. J’investissais beaucoup d’argent mais à l’arrivée j’avais créé seulement 30 emplois. La plupart de ce que nous mettions servait à nourrir les poules et non les hommes. Cela ne me satisfaisait pas. Avec mes partenaires, nous avons trouvé un autre créneau qui est la transformation de la noix de cajou. L’Afrique en produit à peu près 40 % au niveau mondial, mais malheureusement pour elle, jusqu’à récemment, 99 % de cette production était envoyée de façon brute en Inde. C’est là-bas que la transformation, et donc toute la valeur ajoutée, était faite. Avec mes collègues, nous avons créé la première usine de transformation de noix de cajou au Togo. Nous avons commencé en 2004, avec de petits objectifs, et cette société emploie aujourd’hui 550 personnes.
Le but est-il de faire du business ou la vocation première est-elle caritative ?
C’est une entreprise à but lucratif, parce que je considère que le développement de l’Afrique passe pour beaucoup par le secteur privé. Il faut que ces entreprises soient viables économiquement. Mais il y a une dimension sociale énorme. En Afrique, il y a beaucoup de sociétés minières qui viennent et exploitent les ressources naturelles de nos pays, en accord avec les gouvernements. Mais les populations qui vivent à côté de ces sociétés sont dans une pauvreté abjecte. Au Togo, la ressource minière principale est le phosphate. Si vous regardez la population de la ville située juste à côté, cela fait à peine 5 ans qu’il y a l’électricité. Au Niger, c’est pareil, avec des sociétés qui exploitent des milliards de dollars de pétrole, et tout près des gens dont l’environnement est détruit, qui subissent des pluies acides, n’ont pas de nourriture. C’est une injustice d’une violence incroyable. Il y a quelque chose qui m’a beaucoup marqué dans mon enfance. Ma grand-mère paternelle nous a toujours dit : “Les enfants, on ne se rassasie pas gloutonnement devant ceux qui ont faim”. Elle n’a jamais été à l’école mais il y avait une sagesse dans ce qu’elle disait. Et celle-ci est un peu oubliée parfois par le monde corporate et notamment toutes ces sociétés pétrolières.
Avec ce que nous faisons à Cajou Espoir, je ne veux pas juste créer une entreprise, je veux créer un modèle ! Et un modèle de capitalisme à l’africaine différent de ce qui a été fait. Il consiste à dire que dans un pays où le gouvernement est faible (pour une question de corruption ou manque de moyens) et ne peut pas subvenir à certains des besoins fondamentaux de ses populations, une entreprise qui s’installe dans une ville et qui exploite les ressources naturelles du coin a le devoir de créer des emplois mais aussi la responsabilité d’aider la communauté à se développer.
À Cajou Espoir, nous prenons une partie de nos profits, nous demandons en fin d’année à nos employés de faire un vote et de déterminer quel projet ils vont donner comme fruit de leur labeur. L’année dernière, nous avons construit une crèche. Cette année nous allons apporter l’électricité dans un village à côté. C’est un autre modèle. Et j’ai vraiment le sentiment que sur ce point, l’Afrique a quelque chose qu’elle peut apprendre au monde.
Vous avez construit votre carrière aux États-Unis, le pays du libéralisme et du capitalisme parfois poussé à outrance, ne trouvez-vous pas paradoxal de remettre en cause le modèle qui vous a permis de réussir ?
Bien sûr. Et je ne crache pas sur le capitalisme. Comme vous le dites, j’en ai bénéficié et je considère qu’il a créé énormément de valeurs et de richesse. Mais je considère que le modèle purement capitaliste, où seul les profits comptent, a aussi ses limites. On a pu les voir durant la crise financière de 2008-2009. Il faut que l’on innove là-dessus.
* Ciena est spécialiste des solutions optiques de paquets. En 2012, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 1,8 milliard de dollars.