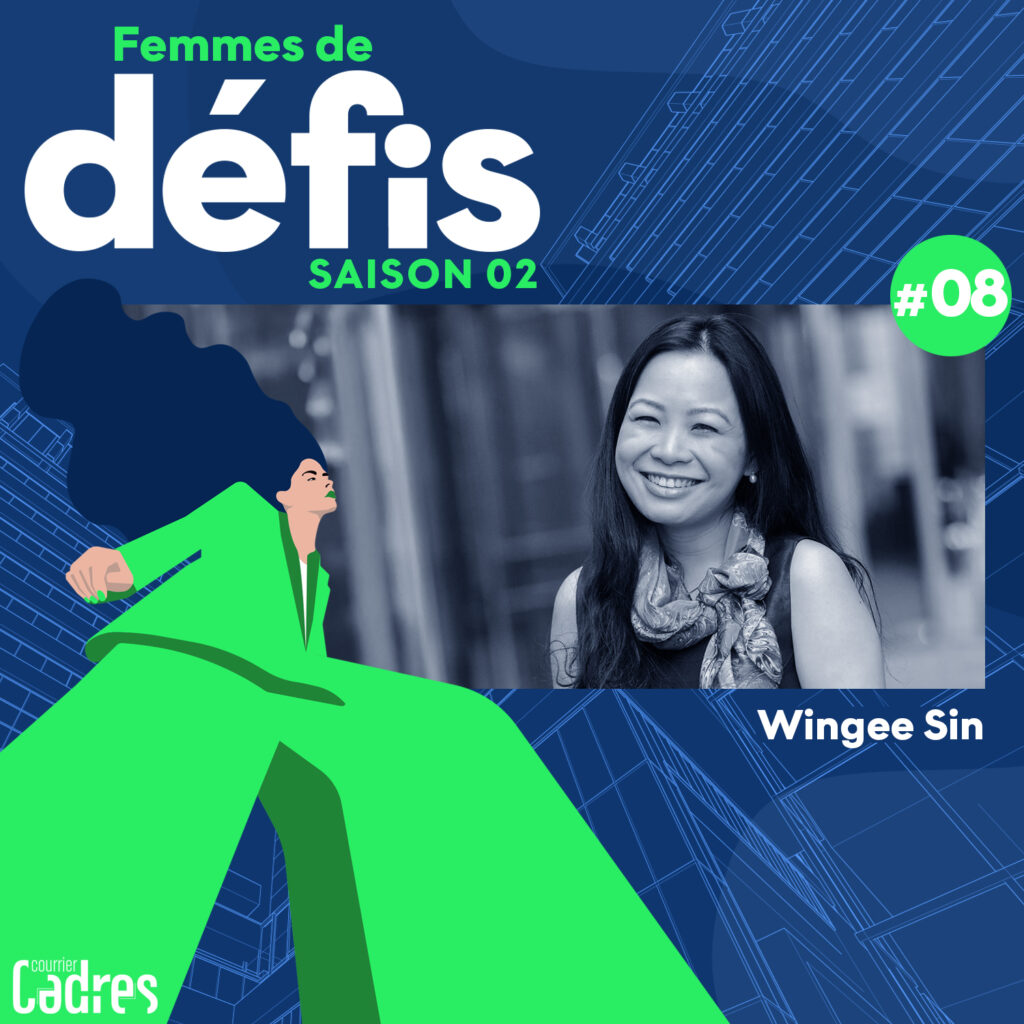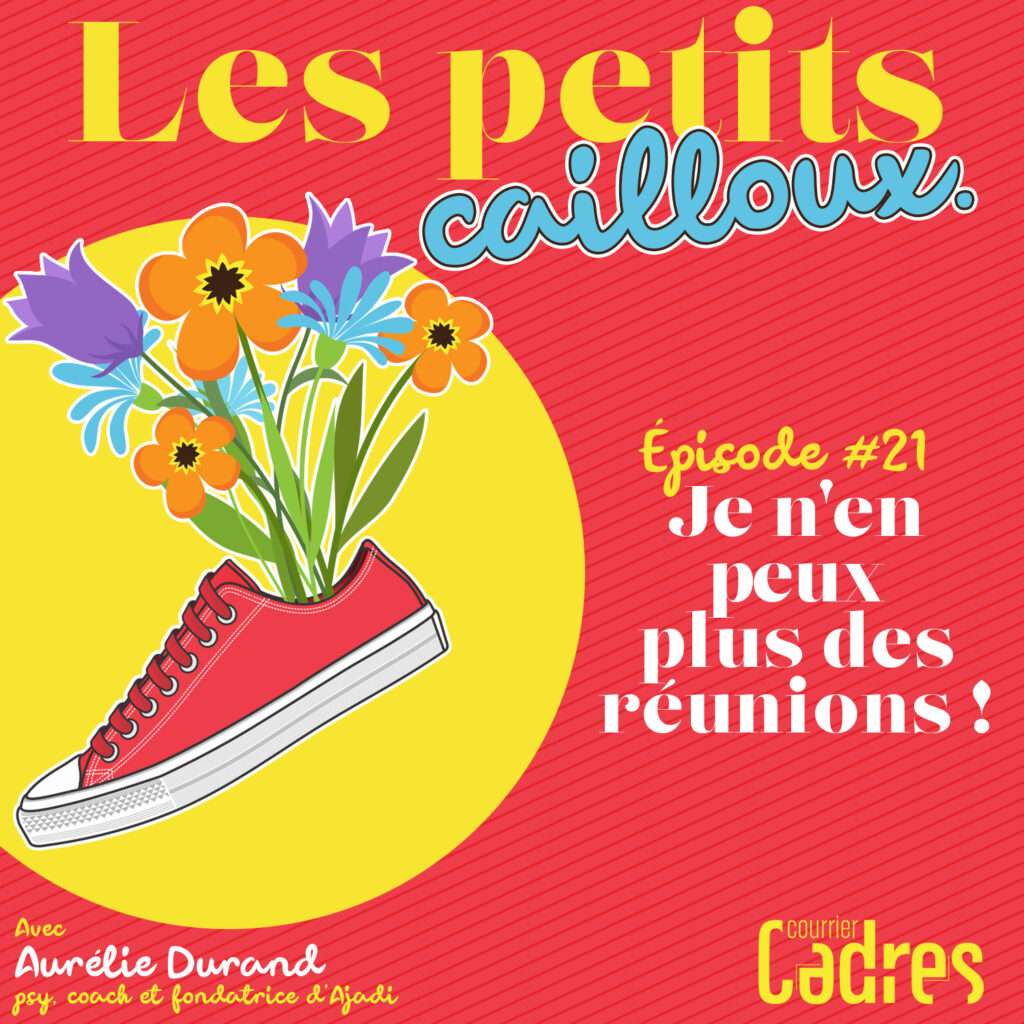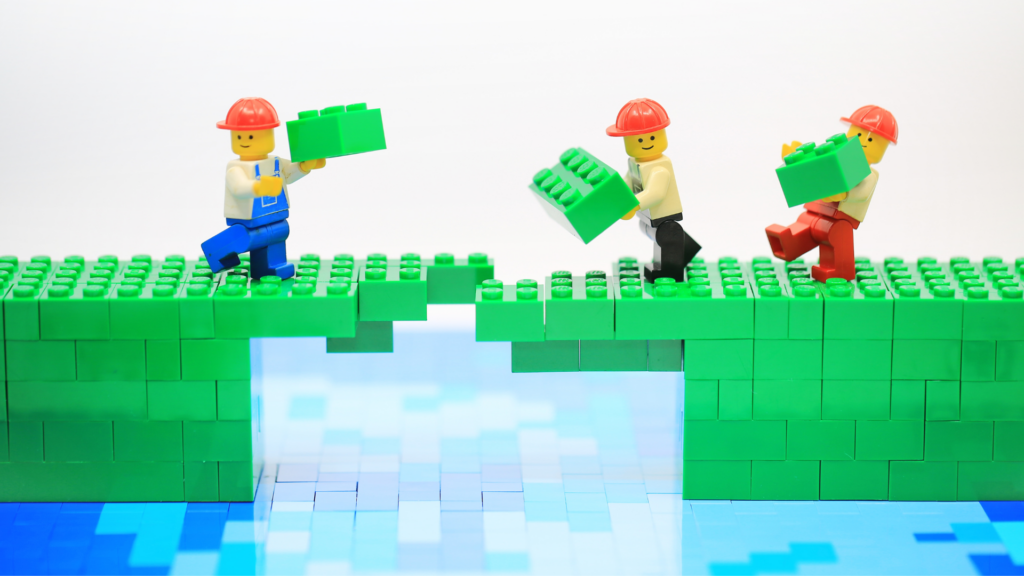“J’ai choisi mes successeurs”. C’est en ces termes que Coqueline Courrèges, la femme d’André, a présenté Frédéric Torloting et Jacques Bungert à ses salariés, lors du rachat de l’entreprise en 2011. Ce n’est donc pas un géant du secteur mais deux princes de la communication qui sont venus réveiller la belle endormie. Dans son bureau parisien à l’atmosphère lumineuse, rue François Ier, où le blanc et la transparence règnent toujours, Frédéric Torloting a dressé pour nous un bilan de ces deux premières années*. Propos recueillis par Aline GÉRARD.
Vous inaugurez ce mois d’octobre l’atelier de Pau, site historique de la marque construit au début des années 70 et que vous avez rénové et remis aux normes. Qu’est-ce que cet événement représente pour vous ?
C’est important à plusieurs titres. D’abord c’est au fond assez symbolique de notre projet. Je me rappelle très bien du jour où nous sommes arrivés à Pau, dans cette usine incroyable. Globalement, le bâtiment n’avait pas été refait depuis l’origine. Nous avons donc le sentiment de prendre quelque chose d’extraordinaire, et de le refaire comme il doit être, en le projetant dans le XXIe siècle.
C’est un peu ce que nous faisons pour tout le reste aussi. Cela dit beaucoup sur le style. Ce que les gens ne réalisent pas, c’est qu’il y a finalement très peu de marques de vêtements qui ont leur usine. Pour une raison simple, c’est que très peu de marques de vêtements aujourd’hui ont un style qui est clair. Les designers changent régulièrement, et par conséquent, il vous faut un certain type d’usines pour fabriquer un certain type de produits. Cela raconte notre volonté de continuer sur un style que nous estimons fort, et qui pour nous ne représente ni une contrainte, ni le passé. C’est une plate-forme sur laquelle on peut exprimer une création d’avenir.
Vous n’avez pas fait appel à un de ces couturiers que toutes les grandes maisons s’arrachent. Pourquoi avoir choisi de vous appuyer sur l’interne ?
Lorsque nous sommes arrivés ici, il y a deux ans, nous avons découvert des gens de talent. Cela aurait pu être l’inverse. Nous aurions pu tomber sur des gens plan-plan, peu motivés… pas du tout ! Nous nous sommes donc dit qu’il était absolument aberrant d’aller chercher ailleurs des nouveaux qui allaient probablement s’approprier quelque chose et le transformer. Nous avons certes envie de transformation mais dans un cadre maîtrisé. Et nous avons des gens pour le faire. Ce sont des personnes qui ont 45 ans, qui ont été formées par André et Coqueline Courrèges. Cela tient à peu de chose que de perdre l’histoire et l’identité d’une entreprise.
Est-ce que cela a facilité le fait d’être accepté par les équipes ?
Nous ne l’avons pas fait pour cela. Être accepté par les équipes est une histoire de légitimité. Le moment clé, c’est le jour où vous êtes présentés par la personne qui cède l’entreprise. Notre chance, c’est que Coqueline a réuni l’ensemble de la société pour lui dire : “Voilà, j’ai choisi mes successeurs”. Nous sommes quand même dans des maisons de couture, assez hiérarchisées historiquement, organisées pour satisfaire les besoins créatifs d’une ou deux personnes. Si Coqueline fait un choix, les gens ont tendance à le suivre.
Vient ensuite une période de six mois où vous êtes jugés sur ce que vous faites. En l’occurrence, nous n’avons pas gardé les gens pour nous faire accepter, mais parce que cela se passait bien. Nous aussi avons fait nos évaluations pendant ces six mois. Il y a des personnes avec qui nous nous sommes trouvés et d’autres que nous n’avons pas gardées pour différentes raisons.
Comment expliquez-vous que cette marque au fort potentiel soit tombée en désuétude ?
Il ne s’agit pas réellement de désuétude. Pour faire court, l’histoire de la Maison a commencé en 1961 et cela a cartonné autour de 1965. Mais André Courrèges se faisait copier de partout. Cela l’a énervé.
Il ferme et fait autrement. Il construit une usine, forme 300-400 ouvrières et rouvre deux ans plus tard, avec du prêt-à-porter haut de gamme. Sa conviction d’ingénieur est que cela sera presque mieux fait que si c’est réalisé artisanalement. Il inonde alors le monde avec des produits de très bonne qualité, faits à Pau. Cela marche extrêmement bien jusqu’à la fin des années 70. Au début des années 80, André Courrèges apprend qu’il a Parkinson. Il est très jeune, mais se dit que cela ne va pas pouvoir durer très longtemps. Quelque temps auparavant, il a signé des licences au Japon qui fonctionnent bien (c’est d’ailleurs l’un des premiers à l’avoir fait ce qui était assez visionnaire). Il s’interroge sur la personne à qui transmettre et vend à son licencié japonais. Cela n’a pas marché du tout. Il y a un moment où le style rattrape le business et quand le produit n’est plus au rendez-vous, cela ne fonctionne pas. Cela a duré 8 ou 9 ans, André et Coqueline ont fait un procès et ont finalement racheté leur entreprise. En 1994, ils redeviennent pleinement propriétaires. Les parfums, qui avaient été montés en joint-venture avec L’Oréal et que ces derniers avaient revendus à un groupe suisse, sont également rachetés par Coqueline. À la fin des années 90, alors qu’elle a la soixantaine, elle se retrouve donc avec une entreprise qui n’a plus de style clair et tout un système à reconstruire et à purifier. André qui ne peut plus vraiment travailler se consacre à de l’artistique pur.
Coqueline avait écrit à tous les grands magasins du monde en disant “ne venez plus nous voir, on ne vous vendra plus de produits, cela ne nous intéresse pas”. C’était une désuétude délibérée, donc ce n’en était pas vraiment une. C’était plutôt un business qui s’arrêtait.
Elle souhaitait donc sauver l’identité de la marque pour lui permettre de revenir un jour…
Oui, et c’était même bien plus que cela. Elle avait rencontré plein de gens à qui elle ne voulait pas transmettre. Elle disait : “Je vais voir si je trouve ou si je ferme pour l’honneur d’André”. Ce n’est pas une histoire d’argent, mais une histoire de vie. Ce sont des gens qui ont fait leur vie ensemble autour d’un projet artistique presque plus que business, donc chaque chose est incarnée.
Qu’est-ce qui a fait qu’elle a trouvé chez vous les bonnes personnes ?
Il faudrait lui demander mais je pense que le fait que l’on soit un duo a compté. Tous les jobs sont difficiles, mais franchement dans celui-ci, il y a une foule de choses à faire et des tonnes de décisions à prendre… autant être deux. A fortiori dans un métier ou une entreprise que l’on ne connaît pas. Quand vous êtes en duo et que vous pensez la même chose, vous décidez facilement. Seul on est toujours plein de doutes.
Ensuite, je comprends très bien maintenant pourquoi elle ne voulait pas de gens issus de la mode, parce que justement ce n’est pas du tout une marque de mode.
En quoi n’est-ce pas une marque de mode ?
Il y a des produits qui ont traversé 40 ans et qui continuent à être vendus aujourd’hui. Certes il faut y toucher un peu, c’est comme une voiture. La Golf d’aujourd’hui n’est pas identique à celle des années 70, mais cela reste une Golf. Les réglages se font petit à petit de manière presque imperceptible.
Quel était l’objectif pour deux publicitaires comme vous à travers cette reprise ? Était-ce de réveiller la belle endormie ?
Tout d’abord, je pense que nous sommes plus entrepreneurs que publicitaires. La publicité est un métier dans lequel nous sommes arrivés tard, même si nous avons fait de la communication toute notre vie. Nous avons fait de la publicité durant 5 ans car l’actionnaire de Young & Rubicam (WPP, ndlr), à qui nous avions vendu notre boîte, nous a proposé de prendre la présidence du groupe en France. Nous ne connaissions pas la pub, en plus la boîte n’allait pas très bien, nous nous sommes dit que ce serait compliqué et que c’était un challenge. Pour nous qui voulions racheter une entreprise par la suite, c’était un vrai terrain d’entraînement, cela nous permettait de voir si nous en étions capables. Cela a été dur, mais finalement nous y sommes arrivés. Et nous avons derrière pu faire le saut que l’on souhaitait.
C’est un fantasme absolu que de reprendre une marque qui a eu et qui a encore un potentiel mondial mais qui est économiquement minuscule à un instant T. Il y avait cette espèce de décalage inouï entre le potentiel et la réalité.
Comment vous êtes-vous rencontrés avec Jacques Bungert ?
Nous sommes de Metz tous les deux. Nous nous sommes connus en prépa et nous avons fait nos études à l’EM Lyon. Nous avons habité en collocation comme tous les étudiants.
Se connaître à ce point peut-être un atout, mais n’est-ce pas surtout risqué ?
Quand Jacques a appelé son père pour dire qu’il allait créer une boîte avec moi, il l’a engueulé : “Premièrement, tu ne t’associes jamais avec ton meilleur ami, c’est la plus grosse bêtise que tu puisses faire. Deuxièmement, jamais à 50-50 !”. En réalité, c’est tout l’inverse, mais cela dépend des motivations que vous avez. Si vous vous associez pour gagner de l’argent, il est certain que ce n’est pas la bonne chose à faire.
Pour Courrèges, êtes-vous également associé à 50-50 ?
Toujours ! C’est une décision que l’on a prise au tout début. L’idée n’était pas de gagner de l’argent, c’était de faire notre vie professionnelle ensemble. À partir du moment où l’on part de là, l’entreprise est un moyen au service de ce projet, et inversement, notre association se met au service de nos entreprises. Assez étonnement, nous ne nous sommes pas fâchés une seule fois en 25 ans.
Les banques parisiennes ont hésité à vous suivre sur le projet, et vous avez dû chercher les financements en Lorraine. Pour quelle raison ?
Je crois surtout qu’elles ne sont pas organisées pour cela. Vous avez toujours le centre d’affaires du VIIIe arrondissement, avec des gens un peu blasés qui traitent de grosses entreprises et qui voient arriver un projet de reprise d’une boîte, où certes la marque leur parle, mais les repreneurs viennent d’un autre métier. C’est quand même quelque chose de mécanique, il faut cocher un certain nombre de cases, pour passer à l’étape suivante. Ce n’est pas un système qui nous convient.
Pourtant la marque parlait d’elle-même…
Oui, mais cela n’a pas été une reprise très classique, nous n’avons pas fait d’audit. Un jour avec Coqueline, nous nous sommes tapés dans la main et nous nous sommes dit “d’accord, on le fait comme ça”. Pour un banquier, c’est quelque chose d’étrange. Et puis notre système à deux est très incarné, très relationnel aussi, il faut donc parler aux gens qui décident pour qu’ils rentrent dans votre histoire. En province, vous y avez facilement accès, à Paris, c’est plus nébuleux, plus compliqué. Mais nous trouverons des financements à Paris aussi puisque nous arrivons sur une deuxième phase. Nous avons fait deux ans de remise en place de l’outil à tous points de vue, nous avons embauché… À la fin de l’année, on pourra considérer que nous sommes prêts pour vraiment aller sur le marché mondial se confronter aux autres.
Vous fabriquez l’essentiel de vos produits en France (une petite partie est réalisée en Italie), à Pau, mais aussi chez des prestataires. Le savoir-faire hexagonal n’a donc pas disparu…
Non, il y a des petites boîtes mais qui vivent difficilement. Je pense sincèrement que ce sont des gens qui ne gagnent pas d’argent. C’est compliqué pour eux et c’est aberrant. Le façonnier qui travaille le plus pour nous me disait qu’il était passé à côté d’une fille très douée, parce qu’elle demandait 1 750 euros et qu’il ne pouvait lui donner que 1 650. Elle est donc allée dans un atelier à côté qui fabrique des parachutes.
En valeur absolue, ce n’est rien de faire en France, mais c’est l’accumulation des coefficients qui fait que cela devient beaucoup. Le façonnier représente peut-être 30 % de mon prix de vente. À la fin, je vais multiplier un peu pour payer ma structure mais la distribution elle va faire fois trois, alors que vendre une robe à 500 ou 800 euros demande le même travail. Nous n’allons pas refaire le monde, mais cela vaut le coup de se battre un peu pour fabriquer en France. Il faut que ces ateliers perdurent.
Combien de salariés l’entreprise compte-t-elle ?
70 en tout. Il y en a 25 environ à Pau (mécaniciennes, logistique, contrôle qualité) et le reste est ici à Paris. Il y en avait 53 à peu près quand nous avons repris. À Pau, nous avons signé des contrats de génération et de professionnalisation. Nous avons une génération qui arrive en fin de carrière et nous avons embauché des femmes qui ont une vingtaine d’années. Il faut donc les former. Dans le meilleur des mondes, je ne sais pas si on y arrivera, nous aimerions créer un vrai centre de formation dans le bâtiment de Pau. Recréer du savoir-faire serait une bonne chose. Surtout qu’en France, il y a des aides. Mais cela prend du temps et nous avons 28 priorités à gérer. Il y a le potentiel en France pour faire de l’industrie haut de gamme.
Quelle est votre vision du management ?
C’est assez particulier, je pense. Je ne sais pas si c’est parce que nous sommes fainéants, que nous faisons trop de choses, parce que nous faisons confiance, ou bien une combinaison des trois, mais nous avons tendance à vraiment déléguer. Nous avons besoin de gens extrêmement autonomes et entrepreneurs de leur propre projet. Je pense que c’est assez agréable pour ceux qui sont capables de l’assumer.
Les équipes qui étaient présentes fonctionnaient-elles comme cela ?
Pas du tout, c’était d’ailleurs assez déstabilisant. Les salariés étaient des gens extrêmement dédiés, mais qui ne répondaient pas à une question que vous n’aviez pas posée. Quand vous ne connaissez pas un business, c’est super inquiétant. Du coup nous nous sommes retrouvés assez vite dans une hyper vigilance à poser des questions même évidentes, mais juste pour nous assurer qu’il n’y avait pas de problème.
C’est important de pouvoir contrôler ce qui se passe…
Oui, mais au bout de 25 ans de métier, vous avez aussi un peu d’instinct et vous savez les moments où vous pouvez faire des impasses. Et de temps en temps, il y a un truc qui rate. Mais cela part d’une idée, c’est qu’il vaut mieux faire plein de choses, que 80 % soient bien et que 20 % soient complètement loupées.
Peu d’entreprises s’autorisent cela aujourd’hui, les grandes pas du tout. Même si en réalité elles ratent beaucoup de trucs, elles mettent en place des systèmes très complexes pour essayer de ne jamais faire d’erreur. Nous n’avons pas les moyens de faire ça, donc nous faisons l’inverse. Nous mettons en place des systèmes hyper courts et hyper simples.
Quel bilan dressez-vous de ces deux ans ? Vous avez d’ores et déjà doublé le chiffre d’affaires…
Oui, mais honnêtement je n’ai pas d’objectif de chiffre d’affaires à court terme ou de profitabilité. C’est bien pour cela que nous n’avons pas voulu acheter avec des fonds d’investissement, nous voulions nous donner le temps de faire les choses bien. Premièrement, ce qui est très important pour nous dans ce bilan, c’est que nous sommes toujours très amis avec Coqueline Courrèges. Notre relation s’est construite au lieu de se détruire.
Le deuxième point du bilan, c’est qu’en termes de business nous avons quand même des signaux qui nous disent que le projet est valide. La boutique de la rue François Ier fonctionne très bien. Elle est à + 55 % par rapport à l’année dernière, qui elle-même était à + 35 ou 40 % par rapport à la précédente.
Parallèlement, nous avons reconstruit un certain nombre de relations de business avec de grands magasins et des multimarques dans le monde. C’est encore petit en termes de volumes, mais cela prouve que le produit se vend dans un autre environnement, à côté de bien plus forts que nous.
Coqueline Courrèges ne se sent-elle pas trahie ?
Elle se sent trahie tout le temps, en permanence mais elle est contente de l’être. Elle se sent trahie avec respect. Elle a mis un petit mot sur la porte quand elle est partie : “Celui qui poursuit le passé soit le tue, soit est tué par lui”. C’est une citation de Gandhi. Si nous arrivons à continuer dans cet esprit, nous arriverons peut-être à faire un truc assez unique qui est une transmission réussie, dans un métier créatif.
Nous avons tous en tête les images de la voiture électrique imaginée par Coqueline Courrèges. Projetez-vous de la lancer un jour ?
L’idée est née avant même le choc pétrolier, durant les événements de mai 68 ! À l’époque, il y a la queue devant la pompe à essence près de la boutique, parce que les gens veulent partir en week-end mais il y a pénurie. Elle se dit que le pétrole ne va pas durer et surtout elle qui aime la clarté, la couleur, trouve cela sale. (…) Je l’ai testée et quand vous appuyez sur le champignon, ça part tout seul, c’est assez génial. Mais elle n’a jamais passé le cap de l’industrialisation. Elle n’avait pas le bon partenaire et à l’époque les constructeurs n’y croyaient pas particulièrement. Nous aimerions bien trouver quelque chose à réaliser avec ce savoir-faire, parce que cela raconterait plus sur la marque que toutes les robes qu’on peut imaginer. Mais développer un véhicule, c’est un projet plus long.
* Article publié dans le numéro d'octobre de Courrier Cadres.