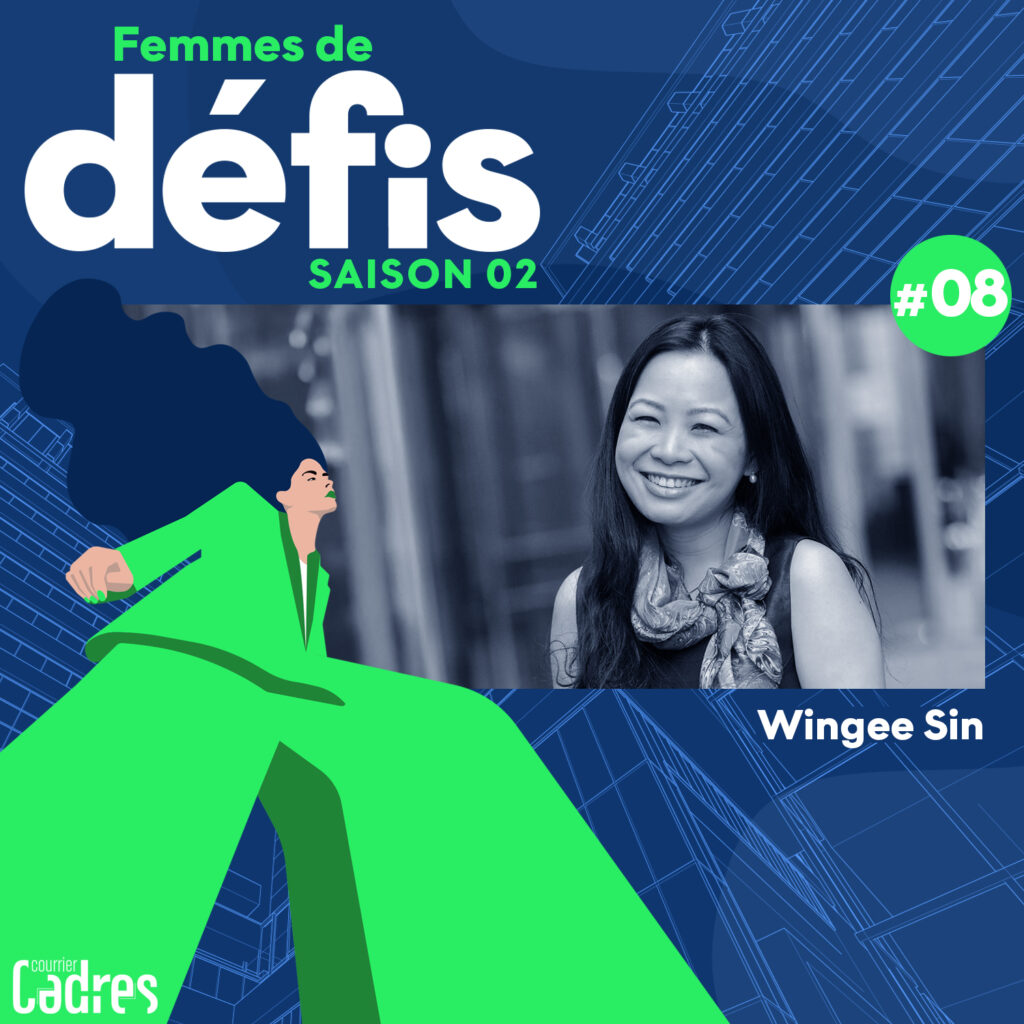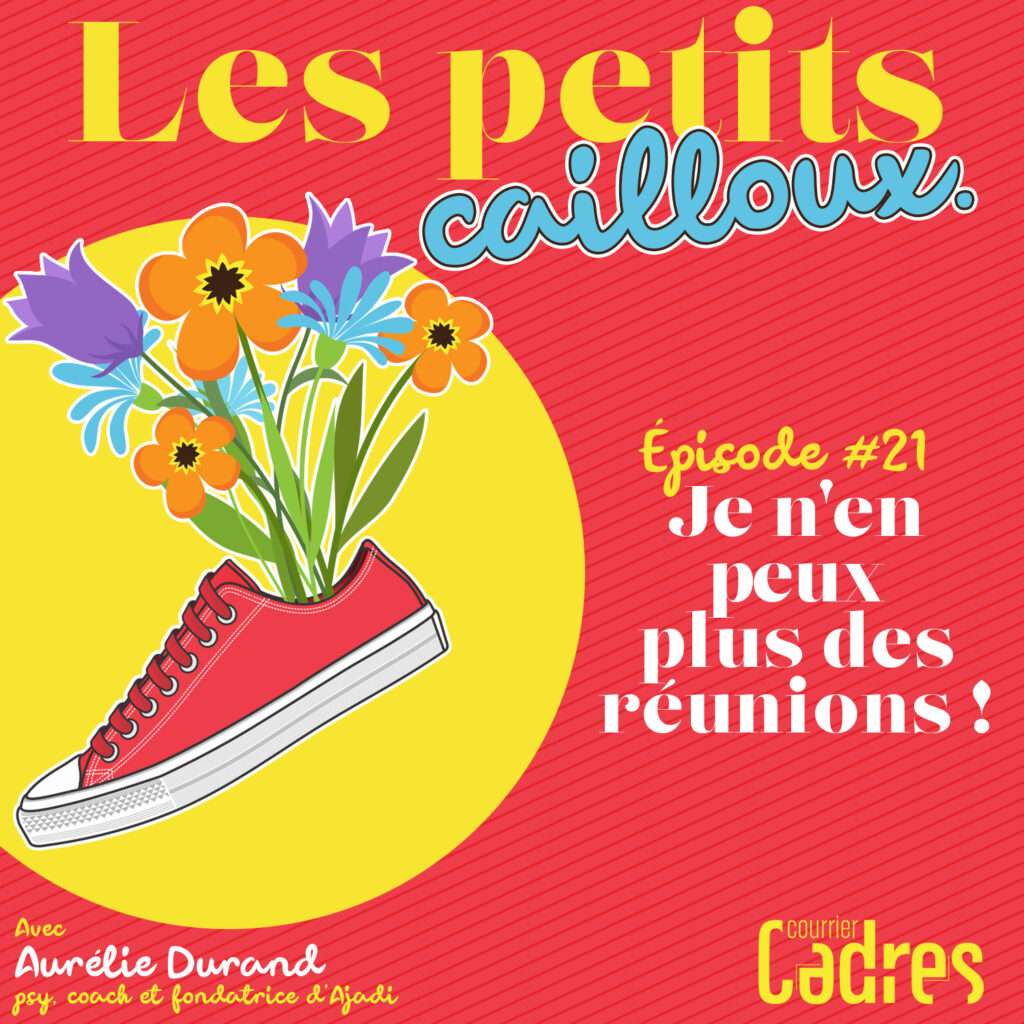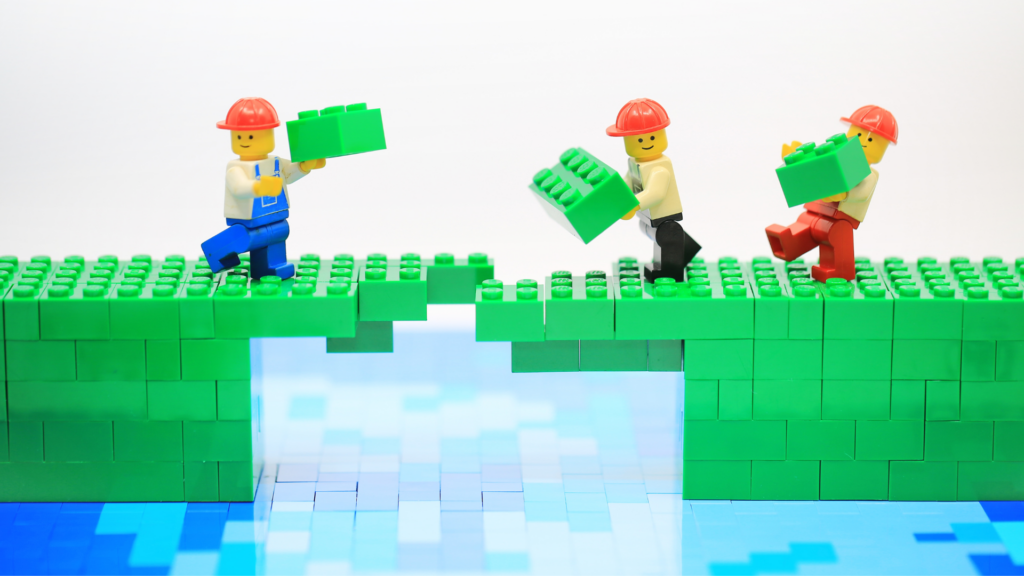Courrier Cadres s’est entretenu avec la philosophe et psychanalyste Hélène L’Heuillet. L’auteur de Éloge du retard nous livre sa réflexion sur les répercussions plus générales de la crise sanitaire en matière de travail.
Comment percevez-vous ces brusques changements d’organisation en matière de travail ?
Il faut partir du constat que les situations sont très diverses et peuvent grosso modo se classer en plusieurs catégories. Le télétravail représente un très grand bouleversement en cette période de confinement. Une journée en télétravail de temps en temps était considérée, “avant”, comme un acquis du droit du travail, car c’était une journée sans temps de transport, seul chez soi. Mais pendant le confinement, c’est très différent, et, là encore, cela recouvre des situations diverses. La plupart du temps, ce qui rend le télétravail très compliqué est que cette fois, les conjoints et surtout les enfants sont présents. Il devient difficile de se concentrer, de s’isoler et de répondre aux demandes contradictoires simultanées : avancer son travail en aidant son enfant à faire ses devoirs, passer l’aspirateur (car la femme de ménage est confinée) tout en surveillant l’heure de la visioconférence, préparer le repas en se demandant à quelle heure on va se coucher si on veut terminer son travail du jour. Le burn-out en chambre n’est pas une vue de l’esprit puisqu’on assiste à une course folle en appartement. Même pour les personnes seules, le télétravail n’est actuellement pas un soulagement. Les injonctions se multiplient, le contrôle est plus grand. On perd énormément de temps en discussions qui distraient et déconcentrent. L’aliénation au temps n’a pas disparu. C’est pire car on se rend compte à quel point la présence physique du collègue (même de celui qui nous agaçait et nous “gonflait”) était précieuse, et combien la sortie de chez soi participait du plaisir d’y revenir.
A LIRE AUSSI : Coronavirus : “ce que nous vivons n’est pas représentatif du télétravail”
Quid du chômage partiel ou total, du travail intellectuel et de ceux qui sont en première ligne ?
Le chômage partiel ou total de certains employés et surtout des auto-entrepreneurs, fait vivre un rapport au temps apparemment radicalement différent du précédent mais finalement pas si éloigné, car il n’en est que l’envers exact. Un grand nombre de ceux dont l’activité s’est soudainement arrêtée s’ennuient. Ils ne savent que faire de cette grande étendue de temps qui leur est octroyée. Souvent ils rêvaient d’avoir un peu plus de temps. Maintenant, c’est trop ! C’est à ceux-là que pensent tous les concepteurs de programmes vidéo ou de conseils en tous genres. Mais ce temps qu’on doit occuper est encore un temps qui nous échappe. Celui qui s’ennuie ne sait pas plus s’installer dans le temps que celui qui est sur-occupé. En revanche, les professions intellectuelles sont dans leur élément. L’intellectuel et l’artiste travaillent de manière toujours confinée, et ont l’habitude de s’abstraire des circonstances, parfois même du bruit qu’on fait autour d’eux. Bien sûr, ce qui change est que les universités sont fermées, et que la présence des étudiants est déréalisée (réduite à leur voix sur un fichier audio, à leurs e-mails, à leurs écrits). Naturellement aussi, ils peuvent subir ces effets nocifs du télétravail que sont l’accroissement du contrôle, la multiplication des pressions, la perte de temps en concertations inutiles. Quant à la quatrième catégorie, c’est celle des “soldats” au propre et au figuré : personnel médical, mais aussi caissiers de magasins, livreurs et éboueurs. Espérons que les verrous du droit du travail ne sauteront pas tous trop vite et qu’ils ne sortiront pas brisés de cette épreuve.
A LIRE AUSSI : David Abiker : “Le télétravail était un fantasme des cols blancs”
Vous avez écrit un ouvrage intitulé Éloge du retard. Comment ce dernier peut-il être lu au regard de la crise sanitaire actuelle ?
Je ne pouvais imaginer quand j’ai écrit Éloge du retard que nous étions à l’aube d’un immense retard collectif. Car même si, pendant le confinement, nous sommes individuellement parfois écrasés par le travail et hantés par des échéances que nous avons du mal à tenir, collectivement nous prenons du retard. Bien des programmes sont annulés. Ne parlons pas de l’économie. Cela nous conduit peut-être à réaliser ce que comporte d’absurde la course folle de nos vies. Après quoi courons-nous si tout peut s’arrêter pour un virus ? Après quoi courons-nous si nous avançons en reculant sur les acquis les plus fondamentaux de nos sociétés, une structure médicale hospitalière coûteuse mais toujours prête à faire face à une crise sanitaire ? La course folle nous a fait oublier les priorités de la vie humaine en société. Les impératifs de réductions des coûts conduisent à cette course folle qui nous a fait perdre collectivement le sens de la temporalité, lequel inclut inéluctablement la notion d’imprévisibilité. Nous croyons être très rationnels mais en fait nous avons oublié les fondements de la vie humaine individuelle et collective. À force de vouloir être en avance, nous avons oublié le réel. Espérons que ce retard nous fera atterrir
Quelles leçons devrons-nous tirer en sortie de crise ?
La leçon majeure serait de cesser de vouloir aller toujours plus vite et de prendre le temps de redéfinir les priorités. Plus rien ne sera comme avant de toute façon, et nous aurons pris un retard considérable. Autant en profiter pour se demander comment travailler et repenser les buts. Il faudra aussi être attentif à prendre soin de ce qui nous aura manqué et penser à se réjouir de la présence physique des autres. Il sera aussi bon de se rappeler de la nécessité de séparer le professionnel et le personnel, le temps pour soi et le temps dédié aux autres. Bref, nous devrons réapprendre la liberté dans le travail au lieu de cette aliénation et soumission volontaire qui portent à traquer tout interstice de temps libre.