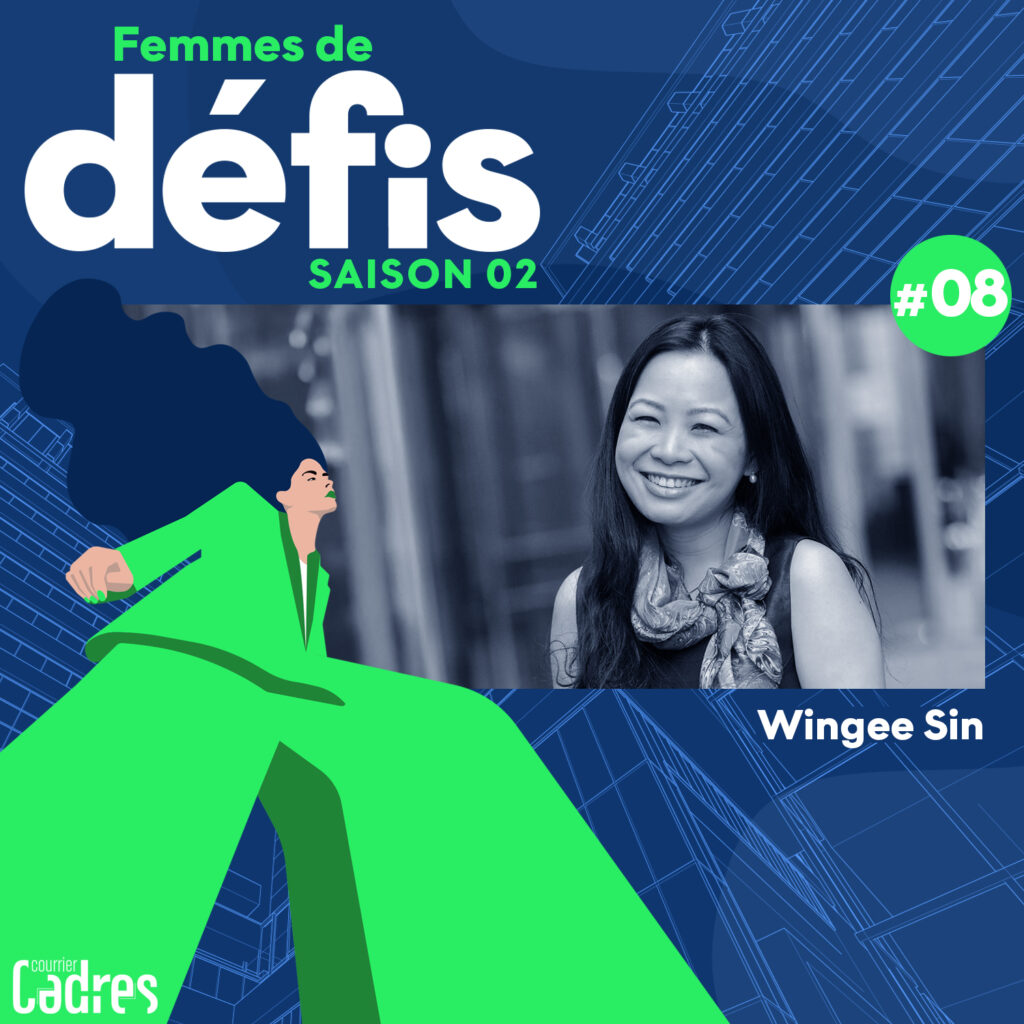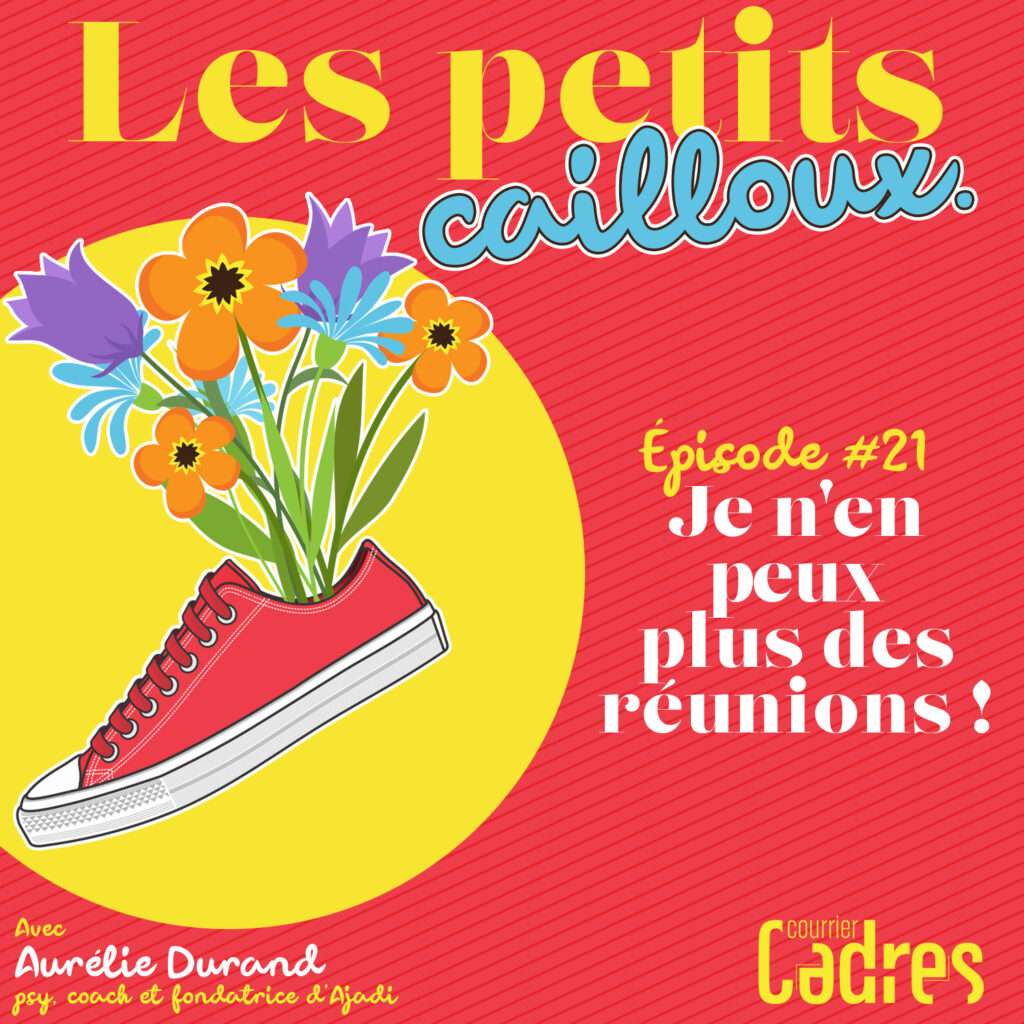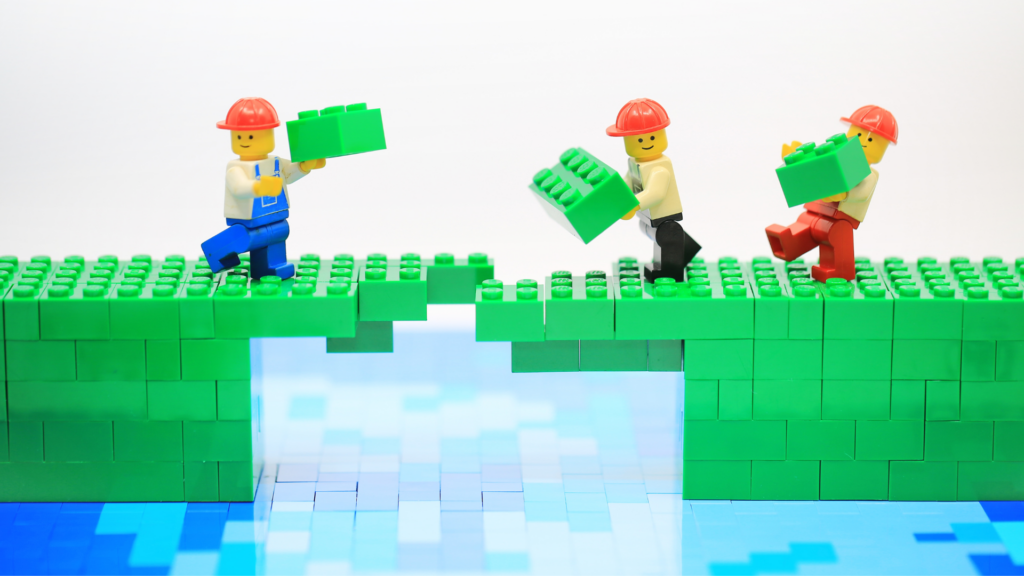Muriel Pénicaud a fait un bilan de mi-parcours de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, chez les entreprises de plus de 250 salariés. Selon elle, ces organisations ont encore « des efforts à faire », celles ayant obtenu les meilleures notes étant rares ».
Les 1 400 entreprises de plus de 1 000 salariés avaient jusqu’au 1er mars, et celles employant entre 250 et 1 000 salariés avaient jusqu’au 1er septembre, pour publier leur note. 99 % l’ont fait (au total, 4 772 organisations), selon Muriel Pénicaud, qui a effectué un point d’étape du déploiement de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le 17 septembre. Mais selon la ministre du Travail, près de 17 % de ces entreprises sont en deçà de la note limite de 75 / 100.
Pour rappel, le gouvernement a mis en place cette méthodologie destinée à calculer, dans chaque entreprise, les écarts de rémunérations, pour supprimer les inégalités de salaires entre femmes et hommes. Aux organisations de publier, tous les ans, cet index, et d’atteindre le score de 75 / 100 – sous peine de s’exposer à une pénalité financière. Cette obligation de transparence s’inscrit notamment dans le cadre de la loi Avenir professionnel, qui vise à éradiquer les inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, d’ici 2022.
Les indicateurs de l’index sont les suivants : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ; l’écart des augmentations ; l’écart des promotions ; le pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année de leur retour de congé maternité ; ainsi que le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations. Ils permettent de calculer une note sur 100, qui est la somme des points de 5 indicateurs pour les grandes entreprises, et de 4 pour les PME. Pour le Medef, “il ne faut pas y voir un couperet, mais un outil pour progresser”.
Des résultats mitigés
Mais les premiers résultats de l’index sont assez décevants. En effet, rares sont les entreprises qui ont obtenu un score de 99 ou 100 : on en compte 167 – dont 38 chez celles de plus de 1000 salariés. La moyenne tourne autour de 83 / 100, et 17 % des sociétés ont donc moins de 75 points, risquant de devoir payer des pénalités (allant jusqu’à 1 % de la masse salariale) en cas d’absence de mesures pour rectifier le tir d’ici 3 ans.
Pas question, toutefois, pour Muriel Pénicaud de dévoiler l’identité de ces entreprises “en alerte rouge” : les noms de celles qui ont plus de 1 000 salariés seront publiés d’ici le 1er mars 2020, quand les sociétés de 50 à 250 salariés devront publier leur note. À l’heure actuelle, la plus mauvaise note enregistrée est 45 / 100. Dans le détail, il s’agit de 18 % des plus de 1 000 salariés, et de 16 % pour les 250 à 1 000 salariés.
Grâce au « focus » du ministère du Travail sur les « bons élèves » de cet index, mais aussi aux chiffres compilés par AEF, France Inter et l’Usine Nouvelle (auprès des organisations), nous avons pu, de notre côté, classer 88 entreprises.
Parmi les « bons élèves », qui ont obtenu une note de 100 / 100, on retrouve le laboratoire pharmaceutique Lilly France et la société de transports en commun Keolis Bordeaux Métropole. Viennent ensuite, avec 99 / 100, la division de R&D en gaz industriels Air Liquide Advanced Technologies, l’agro-industriel Barilla, le groupe Club Med, l’agence de recrutement Manpower, ou encore la société d’assurance Maif.
Avec une note gravitant entre 92 et 98, il est possible de lister Sanofi Aventis, Monoprix, Heineken, La Poste, Schneider Electric, Michelin, Orange, Essilor, Amazon, Renault, Pole Emploi, Nestlé, JC Decaux et Axa. Les organisations qui ont obtenu entre 83 et 89 / 100 sont nombreuses. On peut citer Auchan, Intermarché, IBM, Accenture, Suez, Airbus, la BNP, Dassault Systèmes, Accor Hotels, Atos, Yves Rocher et le Crédit Agricole. Pile dans la moyenne (83 / 100), on retrouve ensuite Vinci ASF, le groupe Air Liquide, ainsi que l’équipementier automobile français Valeo.
Les entreprises obtenant une note entre 77 et 80, donc en dessous de la moyenne, sont connues et importantes. Il s’agit notamment de Total, EDF, Carrefour, Engie, Disneyland Paris, Lidl, Adecco, Ikea, LCL Crédit Lyonnais et Bouygues Telecom. Viennent ensuite celles qui se situent sous la limite fatidique de 75 / 100, au nombre de 800. Nous n’en avons listé que 4. L’entreprise d’audit Mazars et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) atteignent 74 / 100. La société de distribution de gaz GRDF et Radio France arrivent en fin de classement, avec 73 / 100.
Ce contenu n'est pas visible à cause du paramétrage de vos cookies.
« Toutes les entreprises ont des efforts à faire »
Les bons scores de la plupart des entreprises du CAC 40 sont cependant à nuancer. Ainsi, selon Sophie Binet, dirigeante confédérale de la CGT en charge de l’égalité femmes – hommes, déplore sur France Inter le fait que l’index n’impose pas aux entreprises de publier les écarts de rémunération. « On ne sait pas comment l’entreprise a calculé. Peut-on parler de la précarité de ces salariées ? Cet outil sur mesure permet d’occulter les inégalités de rémunérations. C’est pour cela que la plupart des grandes entreprises ont eu une excellente note, alors que la situation des femmes l’est beaucoup moins », affirme-t-elle.
Pour Muriel Pénicaud, globalement, « toutes les entreprises ont des efforts à faire, car rares sont celles qui affichent un score de 99 ou 100, qui doit être l’objectif vers lequel tendre ».
Enfin, note la ministre du Travail, « si l’égalité salariale est plutôt respectée dans notre pays, il existe un plafond de verre qui empêche les femmes d’accéder aux plus hautes fonctions ». En mars dernier, le Medef indiquait avoir justement entamé une étude du nombre de femmes présentes dans les comités exécutifs (les “Comex”), les conseils d’administration, les comités de mandat et plus généralement, les instances dirigeantes de ses entreprises syndiquées. Avec pour objectif de leur proposer, à terme, des conseils visant à “effectuer un travail sur leurs gouvernances”.