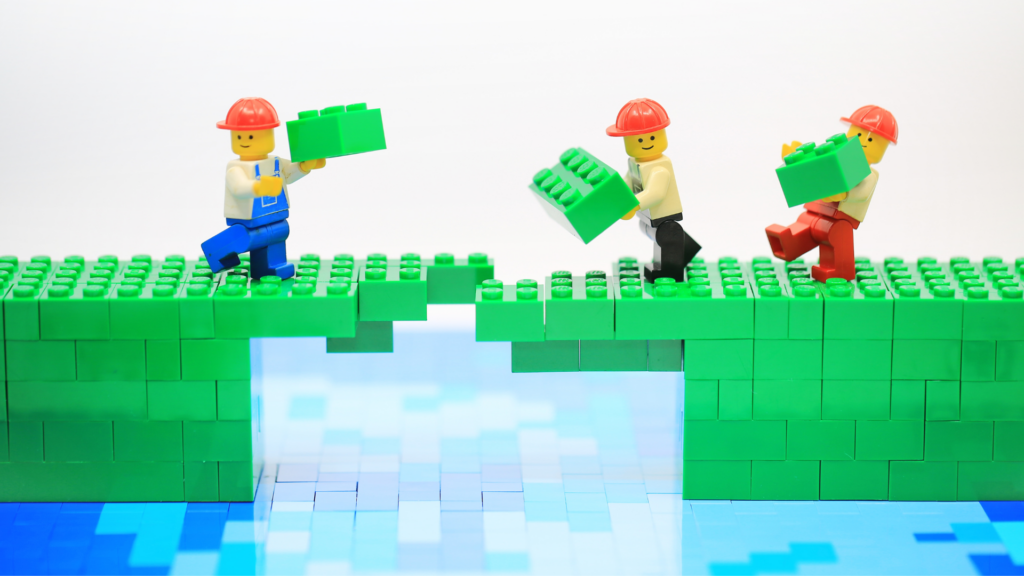En 1994, Jean-Guy Le Floch reprenait avec son ami d’enfance, Michel Gueguen, l’entreprise de textile Armor-Lux. Devenue l’un des symboles du Made in France suite à la photo d’Arnaud Montebourg posant en marinière, l’entreprise se veut aussi solidaire du territoire breton comme l’ont prouvé les bonnets rouges fournis par la marque. Rencontre avec un dirigeant attaché à la préservation du savoir-faire et de l’emploi autant qu’à ses racines. Propos recueillis par Aline GÉRARD*.
Quel bilan dressez-vous de l’année 2013 ?
2013 a été pour nos vêtements grand public une belle année. Dans ce domaine, notre chiffre d’affaires a progressé d’à peu près 10 %. Nous avons ouvert de très beaux points de vente à Plaisir (78), Guérande (44) et Vitré (35). Cela fonctionne très bien. L’année a été encourageante, malgré une crise que pour l’instant nous ne sentons pas trop dans les actes d’achats de nos fidèles consommateurs. Sans doute nos vêtements sont-ils des vêtements refuges.
Quel regard portez-vous sur l’avenir de la Bretagne, la région est-elle selon vous réellement en crise ou est-ce simplement une crise de l’agroalimentaire ?
Non, ce n’est pas tellement une crise. Je crois que nous avons subi ici quatre accidents dans l’agroalimentaire coup sur coup : Doux, Tilly-Sabco, Marine Harvest et Gad. Ce sont quatre accidents que le Finistère (car c’est essentiellement lui qui est touché) va essayer d’oublier très vite. Au-delà de cela, l’agroalimentaire va se refaire une santé en rentrant dans des techniques avec plus de valeur ajoutée. Dans deux ou trois ans, je pense que tout cela sera oublié.
Pourquoi avoir choisi de vous associer au mouvement des Bonnets rouges ? Le regrettez-vous aujourd’hui ?
Je m’y suis associé à deux titres. Tout d’abord, j’ai fourni 110 bonnets à tous mes amis qui ont voulu en acquérir. Deuxièmement, l’ensemble du monde économique était présent à Quimper pour la manifestation. J’y étais avec le patron du Medef, avec ceux de toutes les chambres de commerce et d’industrie et de métiers. Je ne regrette pas du tout d’y avoir participé.
Comme vous le disiez précédemment, vous êtes épargnés par la crise. Faut-il en conclure que vous avez fait de meilleurs choix, opté pour les bons positionnements et que les échecs dont vous parliez sont aussi dus en partie à des erreurs stratégiques ?
Il y a de tout dans les accidents économiques que nous avons évoqués. Il y a sans doute de mauvaises appréciations de l’avenir par les dirigeants. Mais il y a aussi – si l’on prend le cas de Marine Harvest par exemple – la mondialisation, avec un centre de décision qui est complètement déporté en dehors de France et des arbitrages qui se font entre des usines à bas coûts et d’autres avec un Smic chargé dont on connaît le niveau. Je crois qu’il n’y a pas de vérité.
Il y a certainement des actes de gestion qui ont été mal évalués mais vous savez, nous sommes une PME, nous avons 600 personnes ; c’est un petit bateau. Quand la mer est démontée, les petits bateaux sont assez faciles à mettre à l’abri. Les accidents dont nous parlons concernent d’énormes vaisseaux, avec des milliers de personnes. Quand la tempête est là, pour les faire manœuvrer, c’est un peu tard. Personne ne pouvait prévoir qu’en 2013, il y aurait un grand creux dans l’économie. Et les plus gros, en tout cas dans le secteur agroalimentaire, sont les plus fragiles.
Fin octobre, un mouvement d’extrême droite a déposé la marque Bonnets rouges à l’Institut national de la propriété industrielle et vous a précédés de quelques jours seulement. N’avez-vous pas le sentiment que tout cela vous a échappé ?
La marque a été déposée par ce mouvement du sud de la France dans des classes qui ne concernent pas le textile. Donc cela ne nous touche pas. Mais il est vrai que ce dépôt sauvage de marque n’est pas très sympathique.
N’avez-vous pas peur que cela salisse l’image d’Armor-Lux ?
Franchement non. Les bonnets rouges étaient une initiative bretonne qui était faite pour rester très calme et très digne. Les choses sont rentrées dans l’ordre après quelques petits débordements regrettables. Nous sommes une marque bretonne, solidaire de son territoire. En tout cas, le Finistère est désormais repéré par les instances du pouvoir. Cela fait déjà deux fois que le ministre de l’Intérieur nous rend visite…
Vous êtes diplômé de l’École centrale de Paris, d’un master en sciences à Stanford et d’expertise comptable. Vous avez également été directeur du contrôle de gestion chez Bull à Angers avant de rencontrer Vincent Bolloré. Qu’est-ce qui à l’époque vous a poussé à rejoindre son entreprise ?
C’est simple, je travaillais à Angers et j’étais déjà très Breton, attaché aux racines. Un jour, j’ai lu une annonce dans Ouest-France (à l’époque les recrutements fonctionnaient encore comme cela). Vincent Bolloré, qui venait de racheter son entreprise, cherchait un contrôleur de gestion pour le rejoindre dans un petit village breton, Scaër, tout près de Quimper. Mes parents y avaient été instituteurs durant plusieurs années, c’était donc l’un des bourgs où j’avais vécu ma toute première jeunesse. Sur un lot de 50 ou 100 candidatures, j’ai été retenu après des tests et après avoir passé quelques heures avec Vincent et Michel-Yves Bolloré. L’idée était déjà pour moi de revenir au pays.
Lors de précédentes interviews, vous avez utilisé la formule d’expatrié de l’intérieur. Celle-ci vous convient-elle toujours ?
Oui, la Bretagne, c’est toujours difficile d’en partir. J’ai toujours rêvé de revenir. Quand je suis rentré chez Vincent, c’était pour ça. Heureusement pour lui, le groupe a progressé très vite et est devenu incroyablement grand et puissant. Il a alors fallu que je reparte vers Paris en 1985 pour rejoindre le cœur des décisions du groupe. J’ai donc de nouveau quitté la Bretagne pour une petite quinzaine d’années.
J’ai tout appris avec Vincent. C’est un visionnaire, c’est un manager et financier hors pair. Mais je lui ai toujours dit que je rentrerais un jour, il le savait. Et puis j’ai croisé cette opportunité Armor-Lux, avec un propriétaire qui avait 89 ans, qui voulait absolument passer la main et très peu de candidats à la reprise. Il faut dire que le risque social était énorme. Il y avait à l’époque 500 à 600 opératrices de confection dans un métier dont on disait qu’il était condamné.
Pourquoi avoir choisi avec votre associé Michel Gueguen, un ami d’enfance, de reprendre Armor-Lux ? Comment imaginiez-vous cette entreprise à long terme ?
À l’époque franchement, je pensais que le monde du textile était plus facile. Je croyais qu’en achetant un peu de publicité, en faisant un peu de communication autour de la marque, le chiffre d’affaires allait se développer plus rapidement. L’une des difficultés que j’ai rencontrées, c’est une chose à laquelle je ne m’attendais pas. L’entreprise était gérée de manière un peu unipersonnelle par son fondateur depuis sa création en 1938. Les cadres n’avaient pas l’habitude de prendre des initiatives importantes. Je venais d’un grand groupe très structuré où ils prenaient plutôt plus de décisions qu’il n’en fallait. J’ai eu une vraie rupture psychologique à vaincre et malheureusement, au fil des mois, les cadres qui étaient là nous ont quittés car le rythme n’était pas assez soutenu. Finalement, aujourd’hui, nous avons reconstitué une équipe d’encadrement qui est fantastique et l’entreprise est à peu près au même niveau que ce dont je rêvais à l’époque.
Cela signifie-t-il qu’il est difficile de bousculer la culture d’une entreprise que l’on reprend ?
Oui, dans ce cas, cela a été très difficile. L’ancien propriétaire qui avait 89 ans n’a pas pu nous accompagner, il a donc fallu que l’on se repose sur la seule mémoire d’entreprise qui était l’encadrement, mais qui n’était finalement que le relais de transmission entre l’usine et l’énorme savoir-faire du fondateur. Avec Michel, nous avons beaucoup souffert car c’était une culture très monolithique, qui était celle du cédant qui faisait tout de A jusqu’à Z. C’était une maison très paternaliste. En plus, nous ne connaissions pas le métier, il a fallu que l’on donne un sacré coup de collier pour convaincre l’encadrement de changer ou de partir. Malheureusement, la plupart ont choisi de partir et il est vrai que nous avons perdu deux ans. Mais nous avons aussi trouvé en arrivant des opératrices de confection qui nous ont beaucoup aidés.
Comment l’entreprise est-elle parvenue à traverser les différentes tempêtes depuis le rachat en 1994 ?
D’abord avec beaucoup de ténacité, beaucoup d’énergie, mais ça je crois que c’est propre à la Bretagne. Nous n’avons jamais baissé les bras et nous avons toujours montré un esprit de solidarité avec tous les salariés. Dans les tempêtes les plus fortes, tout le monde a fait des sacrifices. Aujourd’hui, ces galères sont derrière nous, et définitivement derrière nous puisque l’entreprise est devenue sur le plan de son business model complètement sereine. Elle n’est plus confrontée au risque fondamental de son métier d’origine, le textile, qui est celui de la délocalisation vers des pays à bas salaires comme le Bangladesh. Nous avons maintenant un modèle économique qui nous permet de raisonner à très long terme.
Les marchés publics représentent une part importante de votre chiffre d’affaires (entre 35 % et 40 %). Vous avez connu de beaux succès avec La Poste, la SNCF, mais en avril 2013 vous avez perdu le contrat de la Police nationale malgré le recours que vous aviez entrepris. Cela a-t-il déstabilisé la société ?
C’est sûr que l’entreprise a été déstabilisée. J’avais l’équivalent de 30 à 35 personnes qui travaillaient sur ce dossier depuis 5 ans. Elles avaient l’impression d’avoir rendu un service irréprochable aux 110 000 clients que représente aujourd’hui la Police nationale en France. Il y a eu ici très clairement une énorme déception. Dans ces cas-là, il faut que les dirigeants soient très forts, gardent toujours le sourire et essayent de se projeter vers l’avenir. Depuis, on répond à beaucoup d’autres appels d’offres. Il s’agit de démontrer que ce n’était qu’un incident de parcours, regrettable certes, et que notre avenir dans ce segment du vêtement professionnel et d’image n’est pas définitivement bouché. Nous restons de très bons acteurs.
Vous restez aussi une PME face à des poids lourds, est-ce compliqué ?
Effectivement, c’est très compliqué à gérer. Le marché de la Police a été remporté par le Groupe GDF Suez dont le chiffre d’affaires approche les 100 milliards d’euros. C’est certain que la lutte n’est pas égale. Se retrouver face à des mastodontes, c’est exactement le risque de ce métier. Mais si l’on prend l’exemple de GDF Suez, qui fait 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires dans des métiers historiques, je pense qu’ils comprendront qu’en Europe le textile n’offre pas à des groupes de cette nature les taux de rentabilité que leur impose leur cotation en bourse. Ce phénomène va certainement s’estomper assez rapidement.
Quelle est votre stratégie pour les années à venir ?
Elle va consister en de nouvelles ouvertures de points de vente, dont deux ou trois en Europe du Nord dans les deux ans qui viennent. Et puis nous allons essayer de développer très fort l’export en Asie et en Amérique du Nord. L’un des inconvénients des PME, c’est que le nombre de cadres est assez réduit. On a beaucoup travaillé ces dix dernières années sur les marchés publics et nous avons peut-être délaissé certains éléments importants, c’est-à-dire l’export et les ventes en ligne.
Comment fait-on d’une marque locale un symbole du Made in France ?
C’est tout d’abord le reflet de notre stratégie depuis 20 ans. Nous avons toujours promis aux gens que nous ferions tout pour défendre leur emploi, surtout au personnel d’exécution. Non seulement nous l’avons fait, mais nous recrutons. Nous sommes de fervents défenseurs de l’emploi breton et bien sûr de l’emploi français. Si nous sommes quelque part devenus ce symbole, c’est parce que nous nous sommes battus pour cela, et que nous avons eu la chance aussi de croiser l’effet de communication du ministre Arnaud Montebourg.
La mise en avant en tant que symbole du Made in France est-elle une force ou un cadeau empoisonné ? Une partie de la production étant délocalisée…
Délocalisée n’est pas le bon terme. Quand nous sommes arrivés, l’entreprise réalisait 19 millions d’euros de chiffre d’affaires, avec 500 opératrices de confection. Aujourd’hui, nous faisons 100 millions d’euros, et nous comptons autour de 400 personnes ici à Quimper. Nous n’avons absolument pas délocalisé. Mais pour gagner beaucoup de marchés, surtout ceux des grandes administrations, il a fallu que nous fassions des cotations avec de la sous-traitance à l’étranger. C’était la seule solution pour les remporter. Ainsi, nous avons largement protégé nos emplois français. Nous avons pris aujourd’hui un rythme soutenu d’embauches d’opératrices de confection, grâce à la protection que nous ont apporté ces gros marchés et à des partenaires que nous respectons énormément (essentiellement situés au Maroc, en Inde, en Tunisie, en Bulgarie et en Roumanie).
Ce n’était donc pas pour nous un cadeau empoisonné. Nous n’en avons pas peur du tout parce que cela fait 15 ans que nous avons commencé à sous-traiter à l’étranger et cela fait 15 ans que cela se fait en toute transparence. Bien sûr, lorsqu’à l’époque le premier camion est arrivé, nos délégués du personnel et les syndicats ont eu un peu peur. Nous leur avons bien expliqué que tout cela était fait pour les protéger et que cela ne se ferait jamais à leurs dépens. Depuis 15 ans également, nous avons toujours été francs et transparents avec les médias. Tout le monde sait que ces marchés publics, notamment, ne peuvent être que fabriqués à l’étranger.
Quel regard portez-vous sur la préservation du savoir-faire en France. De plus en plus d’entreprises forment elles-mêmes les salariés à ces métiers qui se perdent, est-ce votre cas ?
C’est quelque chose que nous avons été obligés de faire depuis deux ans. Nous recrutons des opératrices de confection que nous formons car nous n’avons pas du tout envie que l’âme de l’entreprise s’en aille avec des départs en retraite. C’est un vrai challenge pour les entreprises françaises, parce qu’il y a des pans entiers de l’Éducation nationale qui ont disparu. Dans le textile, il n’y a plus de formation de couturière en France. Nous sommes donc obligés de nous en charger nous-mêmes si nous voulons préserver le savoir-faire français et breton. Maintenant que nous l’avons compris, nous le faisons et nous le faisons bien. C’est un beau succès. Nous sommes beaucoup aidés par Pôle emploi et les organismes de formation de notre profession. Les 15 premières opératrices que nous avons formées n’avaient jamais vu une machine à coudre. Elles sont devenues opérationnelles et au bout d’un an nous avons proposé 15 CDI. 13 ont signé. C’est une expérience que nous allons renouveler très vite.
Quelle est votre vision du management ?
Le manager pour moi est un animateur qui insuffle de la cohésion dans ses équipes. Il doit être visionnaire mais ne pas se mêler de tout.
C’est parfois difficile…
On y arrive quand on prend un peu de bouteille… ce qui est mon cas.
Comment répartissez-vous les rôles avec votre associé ?
Nous sommes tout d’abord extrêmement proches car nous étions sur les bancs de l’école ensemble. Cela fait plus de 40 ans que nous nous connaissons, que nous nous côtoyons toutes les semaines, tous les jours. Nous nous répartissons les rôles en fonction des savoir-faire et des expériences de l’un et de l’autre. Michel est un ingénieur chimiste, donc il est parfaitement à l’aise dans son élément dans le textile car cela se rapproche beaucoup du monde de la chimie. Moi je suis plutôt de formation généraliste, j’ai fait beaucoup de finance et de droit quand j’étais chez Vincent. J’ai appris aussi à faire un peu de communication car il était exceptionnel en termes de communication interne et externe. Michel s’occupe de la gestion purement technique et scientifique de l’entreprise, et moi de la gestion financière et juridique.
Quelle est votre vision de la réussite et de la carrière ?
Une carrière réussie, ce n’est sûrement pas une question d’argent. C’est le fait d’avoir réalisé de belles choses et d’avoir été heureux durant sa vie professionnelle. Avec le recul, je sais que j’ai fait des choses plutôt bien, que je n’ai rien à me reprocher sur le plan humain dans les équipes que j’ai gérées. Et puis j’ai été plutôt heureux dans tout ce que j’ai fait. Cela me suffit largement. Et je pense que pour la plupart des gens qui sont ici, c’est à peu près la même chose.
L’amitié est-elle une valeur fondamentale dans l’entreprise ?
On vit dans un monde économique qui est de plus en plus difficile. Ma vision de l’entreprise consiste à dire que c’est un peu la deuxième famille des gens qui y travaillent. Ils y passent presque autant de temps que dans leur vraie famille. Je crois que ce temps de travail doit se passer dans la meilleure des ambiances possibles, dans un bel esprit de camaraderie. Ainsi, l’entreprise s’en porte mieux. Avec mon associé (Michel Gueguen, ndlr), c’est ce que nous pratiquons ici. C’était d’ailleurs aussi la façon de procéder de Vincent Bolloré. J’ai beaucoup appris dans les années 1983-1984, au début du rachat de son entreprise. Il a vraiment tout fait pour qu’il n’y ait jamais un seul licenciement et pour protéger des ouvriers qui travaillaient dans des papeteries dont il savait qu’il les fermerait. J’ai vu sa façon de faire, cela m’a énormément appris. Cette dimension humaine dans l’entreprise est vraiment essentielle, surtout en ces temps chahutés.
Avez-vous le sentiment qu’il existe une fibre bretonne entrepreneuriale ou est-ce un mirage ?
Non, c’est incontestable, c’est l’état d’esprit des gens ici. Il faudrait sans doute faire des études d’ethnologie pour savoir d’où provient cette volonté farouche d’entreprendre. Je crois que cela vient en partie du fait que la Bretagne a connu une pauvreté assez triste pour une région. Les Bretons ont voulu prendre leur destin en main et ont voulu construire leur Bretagne nouvelle. Ce n’est pas récent, le plus bel exemple de cette volonté farouche cela a été la carrière d’Alexis Gourvennec (leader de la révolte paysanne bretonne de 1961, il fondera notamment Brittany Ferries, ndlr), qui reste pour nous ici un exemple, ou d’un Jean-Pierre Le Roch qui a monté le groupe Intermarché. Ce sont un peu mes deux références. Tout le monde travaille dans cet esprit de conquête et de construction.
* Interview publiée dans le numéro de février de Courrier Cadres.
Plus d’infos :