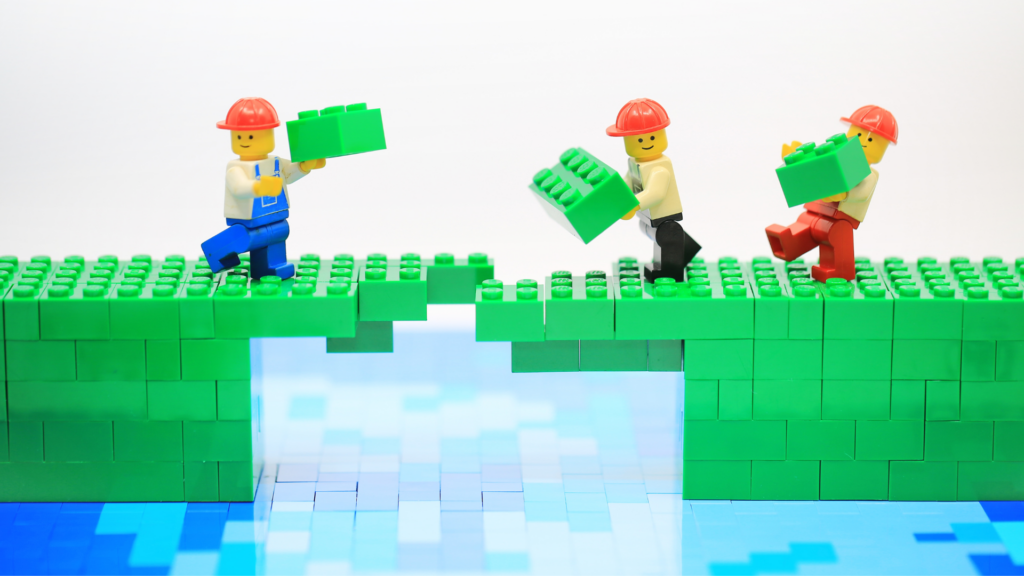La notion de chef, incarnant l’autorité, revient à la mode. Mais toute la question est de savoir de quelle autorité il s’agit. En 2016, François Bert, fondateur du cabinet de conseil aux entreprises Edelweiss RH*, publiait déjà un ouvrage sur le sujet, Le temps des chefs est venu, basé sur une analyse du casting politique actuel. Un décryptage des personnalités qui s’applique tout aussi bien aux dirigeants d’entreprise. Et pour lui, la réponse à la complexité n’est pas l’homme exceptionnel, mais l’équipe !
Commençons par définir les termes. À vos yeux, qu’est-ce qu’un chef ?
Au niveau purement du vocabulaire, “caput”, c’est celui qui est à la tête. Et celui qui est à la tête est bien celui qui peut savoir où il va.
Le terme de chef ajoute pour moi une notion supplémentaire à celui de leader. Un manager produit de la performance, un leader produit de l’engagement, un chef produit de la victoire.
Dans l’ouvrage Le Temps des chefs est venu, que j’ai écrit en 2016, j’insistais sur le fait qu’on a souvent défini un leader simplement à travers sa capacité à entraîner des gens avec lui et à les motiver. Mais cela ne fonctionne qu’à partir du moment où vous êtes dans un cadre figé, c’est pour cela qu’on l’a beaucoup vu dans de grands groupes.
Sauf que les choses bougent tout le temps dès que l’on est dans l’opérationnel. Le propre du chef est précisément, puisqu’il est à la tête, d’être en capacité de donner la direction, à hauteur d’homme et à portée de main, étape après étape.
À l’heure de l’horizontalité et de l’entreprise libérée, le temps des chefs est-il vraiment venu ou revenu ?
Plus que jamais. La première chose est que l’entreprise libérée part du principe que l’on a des gens du même niveau et que tout le monde est bien intentionné. Ce sont souvent des gens un peu surdoués, ce qu’on appelle de hauts potentiels ou des Zèbres, qui sont dans cette logique-là. Sauf que la réalité n’est pas celle-là et que la nature ayant horreur du vide, quand il y a des zones à prendre, ce ne sont pas forcément des petits dauphins qui viennent mais aussi des requins.
Ces Zèbres pensent-ils que tout le monde fonctionne comme eux ?
Ce qui les caractérise, c’est souvent une très grande densité de pensée et la volonté de faire bouger les choses de manière positive. Sauf que le monde entier ne fonctionne pas comme ça. Les personnalités type Zèbres sont minoritaires. Il y a des gens qui ont des énergies d’impulsion, et des gens qui ont des énergies de réaction, qui ont besoin d’un cadre.
Le risque pour les hauts potentiels, en entreprise comme en politique, n’est-il pas de s’inscrire dans une posture condescendante ?
L’écueil structurel des sachants est de croire que la somme de leurs connaissances personnelles est supérieure à celles de leurs collaborateurs ou de leurs citoyens. Sauf que c’est l’inverse.
Un chef ce n’est pas celui qui sait mieux, c’est celui qui libère le potentiel de tout le monde.
Un leader ce n’est pas quelqu’un qui fait tourner les gens autour de lui, c’est quelqu’un qui fait tourner les gens autour de la mission. C’est ce qui fait passer à un vrai leadership de chef.
Ce n’est pas un leadership centripète de personnes qui font graviter les autres autour d’elles-mêmes avec quelque chose d’aléatoire, clivant et périssable. Car dès que ces gens-là disparaissent, tout s’écroule derrière eux. Là où un chef met les gens en orbite sur la mission.
Cela passe-t-il par un retour à l’autorité ?
Oui, mais toute la réflexion est sur l’autorité juste. Nous sommes tous, suivant l’image biblique “prêtres, prophètes et rois”. Mais il existe bien des “prêtres”, des “prophètes” et des “rois”.
Le problème, c’est quand on les intervertit. Un prêtre, c’est quelqu’un qui a d’abord l’intelligence du lien. Un prophète, c’est quelqu’un qui se nourrit de données pour créer du contenu. Un roi, c’est quelqu’un qui se nourrit des contextes pour produire de la décision.
En politique, le drame que l’on a, c’est qu’on n’a plus que des prophètes et des prêtes, on n’a plus de roi.
Pour illustrer, Nicolas Sarkozy ou François Hollande sont deux formes de prêtres. Quand le métier politique consiste à être candidat, ces personnalités accèdent facilement au pouvoir car elles sont excellentes pour se vendre. Mais dès qu’elles sont au pouvoir, leur métier change. On ne leur demande plus de se vendre, mais de décider dans le cloître du discernement d’un chef isolé. Et là, elles sont perdues. Du coup, elles communiquent sur des éléments de détail.
Tandis qu’un Alain Juppé, un Jacques Attali ou un Henri Guaino sont des prophètes. Ce sont des sachants, mais le problème c’est qu’ils construisent des paquebots dans une crique grecque. Des trucs parfaits qui ne peuvent pas sortir.
Dans ce cas, qui sont les rois ?
Il n’y en a quasiment pas, c’est le problème. L’univers politique est totalement dépeuplé de rois, un terme à ne pas prendre au premier degré.
Si la politique est une jungle aujourd’hui, on a une alliance improbable de Tartarin et de Botanistes.
Ce que ne supportent plus les gens dans les entreprises comme en politique, c’est l’autorité des planificateurs, qui vous font des plans parfaits et qui considèrent que parce que le plan est bien conçu, cela va dérouler.
Il y a des générations de directeurs industriels qui considèrent que leur légitimité c’est le savoir et ils font des plans pour se sentir exister. Sauf que comme on dit dans l’armée, le premier mort de la guerre, c’est le plan !
Le boulot du chef n’est pas de faire des plans, même si cela participe, mais de se taire beaucoup. Et d’écouter les contextes pour savoir où les choses se jouent. Je peux vous assurer que les gens aiment très vite l’autorité à partir du moment où ils savent où ils vont.
Le levier le plus puissant de la motivation des gens, ce n’est ni de savoir qu’ils sont une case dans un plan parfait, ni qu’ils sont employés pour leurs compétences, c’est de savoir que par ce qu’ils sont, ils sont contributeurs de la victoire collective.
Il ne s’agit donc pas d’une autorité, au sens de prises de décisions arbitraires ?
Clairement. C’est la différence entre un chef et un petit chef.
Les gens réclament souvent les chefs, incarnés dans la figure de l’homme providentiel, mais à l’arrivée ne les supportent plus. Les temps n’ont-ils pas changé ?
Cet appel et puis ce rejet tient au fait que les gens ont cette espérance mais se font souvent avoir sur le casting. Ils vont choisir des personnes qui vont accéder au pouvoir par une vague émotionnelle, et dans ce cas ce sont les meilleurs vendeurs ou les meilleurs narcissiques qui réussissent. Ou ils vont aller chercher quelqu’un sur des bases de compétences pures.
Pour ce qui est de l’homme providentiel, attention, je n’ai pas dit le temps DU chef est venu. Je dis, le temps DES chefs est venu !
Comment manage un chef ?
Plus on mettra des chefs au bon endroit, plus on arrivera à laisser des espaces réels de règne. Il ne s’agit pas de dire : “Je te laisse faire, puis je viens contrôler”, mais d’employer une phrase magique pour moi : “Explique-moi ton dispositif”.
Un, j’amène ainsi les gens à prendre la mesure de ce qui va ou de ce qui ne va pas chez eux. Deux, je leur signifie que je les crois capables. Et 3, il faut être dans une relation puissante de chef : “Je suis à tes côtés pour faire les choses, j’attends de toi que tu donnes ce que tu dois donner et moi je prends ma part”.
On redonne à la personne du pouvoir sur son petit espace de règne. Il y a un principe de bon sens qui est que celui qui tient le marteau soit aussi celui qui tient le clou.
Comment les entreprises peuvent-elles déceler les profils de chefs ?
La première chose, c’est qu’un chef s’évalue en situation. La grosse erreur des entreprises est que l’on fait souvent du pur CV, on est alors à fond dans le syndrome du botaniste. Ensuite on va l’évaluer dans un entretien relationnel, donc on va considérer que c’est un bon chef parce qu’il passe bien. Sauf que ce n’est pas le sujet, on ne cherche pas un vendeur.
Parfois on va lui soumettre des business case ou des cas de crise, mais on va le mesurer sur un résultat cérébral : un mémoire ou un papier à rendre. Où a-t-on vu que quelqu’un pris dans une embuscade fait un mémoire sur sa sortie d’embuscade. Dans une embuscade, c’est une décision vite prise, souvent pourrie, mais bien exécutée. Cela s’évalue en situationnel et en observation comportementale.
À défaut de pouvoir évaluer en situation, l’une des manières de s’en sortir est de réfléchir équipe. Quelle est la différence entre De Gaulle et Napoléon ? Militairement, la différence réside en quelqu’un qui s’appelle Berthier.
On peut admirer la pensée militaire de De Gaulle, mais personne ne peut vous citer une bataille qu’il a gagnée, car il est resté à la pensée pure. D’ailleurs, quand il s’est un peu testé sur le terrain ce n’était pas franchement glorieux. Durant la Première guerre mondiale, il a été prisonnier en même pas une nuit. Et en 1940, il s’est pris deux déculottées.
Napoléon, au-delà du fait que c’était plus instinctivement un chef, là où De Gaulle est plutôt un créatif, a su dédoubler ses intuitions tactiques d’une personnalité capable de les traduire en réalité opérationnelle quotidienne.
C’est ce que j’appelle l’ostéopathie de l’organisation. Quand je vois des entreprises où il y a beaucoup de pensée cumulée mais où cela ne débouche pas opérationnellement, comme certaines start-up avec un porteur de projet qui est la figure de la boîte, mon premier levier est de lui trouver un bras droit, un Berthier. Celui-ci aura l’intelligence de l’aléa et de l’humain et mettra les gens en mouvement.
Il faut au moins un binôme vision-exécution. Si vous avez Einstein, il faut lui trouver Patton.
Les dirigeants et les managers manquent-ils de courage ?
Si vous demandez au professeur Tournesol de construire une fusée, il va être capable d’avoir une certaine persévérance et un certain courage dans son exécution. Si vous lui demandez d’être chef d’expédition en jungle, ce sera absolument vertigineux pour lui. Le courage manque de ce que les gens sont souvent employés à rebours de leur personnalité. Quand vous mettez un super sachant pour diriger, et que 90 % de son métier c’est de la décision alors que ce qu’il espère de tout son cœur c’est d’être sur des sujets de construction et de développement mental, vous le mettez tous les jours dans une situation d’inconfort.
D’où l’importance de mettre les gens à leur place et de promouvoir la vertu de la magnanimité, c’est-à-dire être à la pleine mesure de son talent, plutôt que de vouloir à tout prix un poste qu’on n’est pas capable de tenir.
Dans votre roman Cote 418, vous dites : “Il y a des exemplarité apparentes qui n’en sont pas. La seule chose qu’on ne pardonne pas à un chef, c’est de ne pas savoir décider. Le subordonné se fiche pas mal qu’il soit inoccupé, tant qu’il tient la boutique. Mais s’il se met à occuper l’espace pour se prouver qu’il sait tout faire et qu’il ne cesse de travailler, alors il inhibe les bonnes volontés et les démobilise.” Croyez-vous vraiment que les salariés acceptent encore que leur manager se positionne uniquement dans un rôle de décideur ?
La décision est quelque chose qui vous saisit. C’est comme la mer de Renaud. C’est pas l’homme qui prend la décision, c’est la décision qui prend l’homme. La décision n’est pas un acte mécanique et distant, c’est un acte de discernement. Discerner, c’est de l’écoute continue jusqu’à l’évidence.
Un bon chef, c’est une sorte d’élément mobile qui est sans cesse positionné au centre de gravité de l’action, entre un contexte et des moyens qui bougent tout le temps.
Dans ses rapports aux autres, il n’est pas là pour vivre quelque chose de volatile émotionnellement, il est là pour être le garant de la mission.
Il ne peut pas être une sorte de décideur complètement désincarné qui plane au-dessus. S’il y a des dimensions techniques sur lesquelles il faut faire des arbitrages, il doit être au courant de ce que font les gens pour être crédible. En revanche, s’il est tout le temps en train de montrer aux équipes qu’il sait mieux qu’elles, il les inhibe complètement. Un chef ce n’est pas un tireur d’élite, il n’est pas là pour montrer qu’il tire mieux, mais pour coordonner le tir.
Vous dites que l’évidence jaillit de l’écoute. Parfois ce n’est pas le cas, comment prendre les bonnes décisions ?
Il faut distinguer la décision stratégique et la décision courante. La décision stratégique fonctionne vraiment comme je la décrivais.
Sur la décision courante, même s’il faut un minimum d’écoute, on n’a effectivement jamais tous les éléments pour décider. C’est bien pour cela que la décision, c’est du discernement et pas du raisonnement. Comment trouver le bon calibrage ? C’est comme pour un tir de combat, il faut trouver ce juste milieu entre celui qui veut tirer hyper vite car il a peur de s’en prendre une – moralité il tirera complètement à côté – et celui qui se croit aux championnats de tirs mondiaux et qui veut couper une aile de mouche à 400 m, là où vous avez un ennemi à 25 m.
Une décision courante, cela ne s’évalue pas en points mais en trajectoire. On fera des erreurs intermédiaires. La matière opérationnelle n’est pas bonne ou mauvaise elle est rebond. Il s’agit de prendre des décisions intermédiaires rapidement, de se positionner aussitôt sur la suite et petit à petit, la trajectoire s’ajuste.
Il vaut mieux prendre une mauvaise décision et bondir dessus, comme en embuscade, plutôt que d’attendre la décision parfaite et de perdre complètement.
*François Bert, saint-cyrien et ancien officier parachutiste à la Légion étrangère, a créé en 2011 Edelweiss RH, un cabinet qui diagnostique les personnalités et accompagne les dirigeants au “discernement opérationnel”. Il a écrit en 2016 Le temps des chefs est venu, changer le casting de la politique et vient de publier un roman de management sur la Grande Guerre, Cote 418 (Edelweiss Éditions).