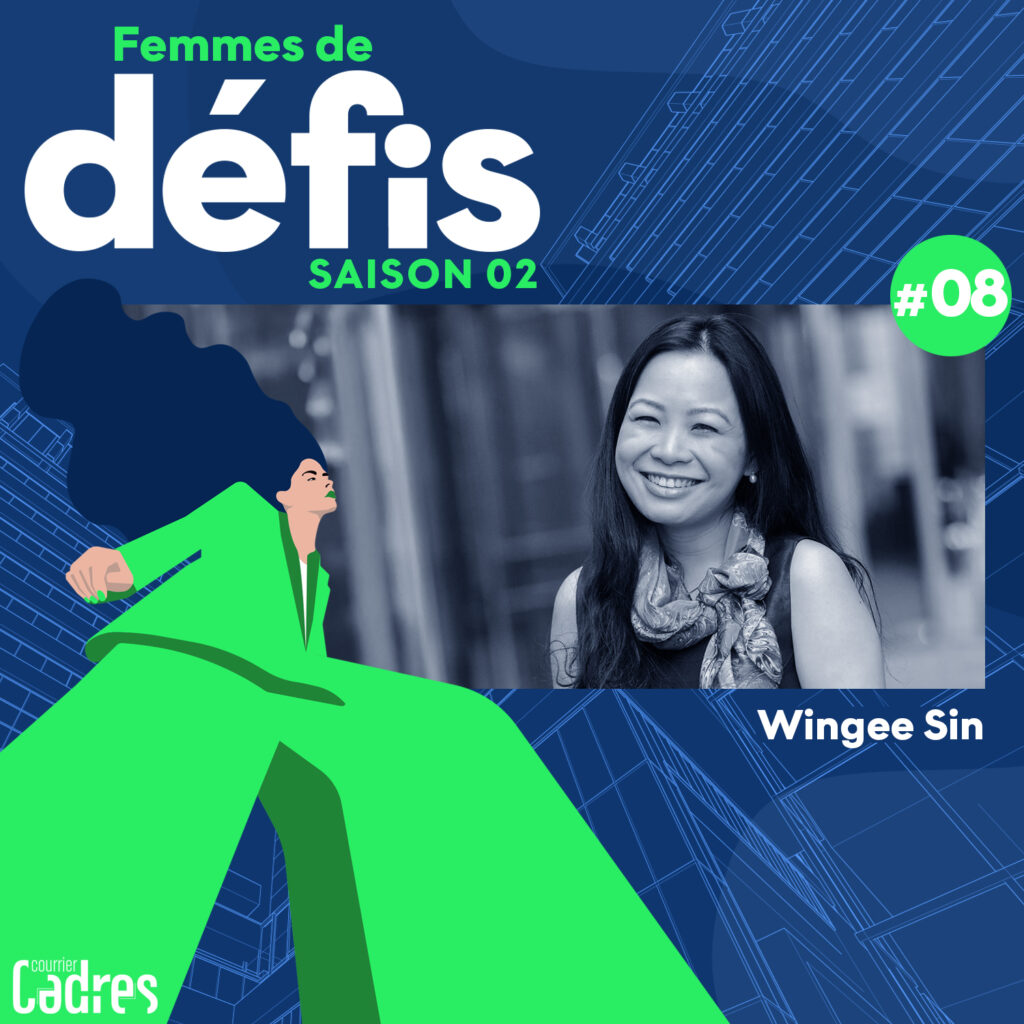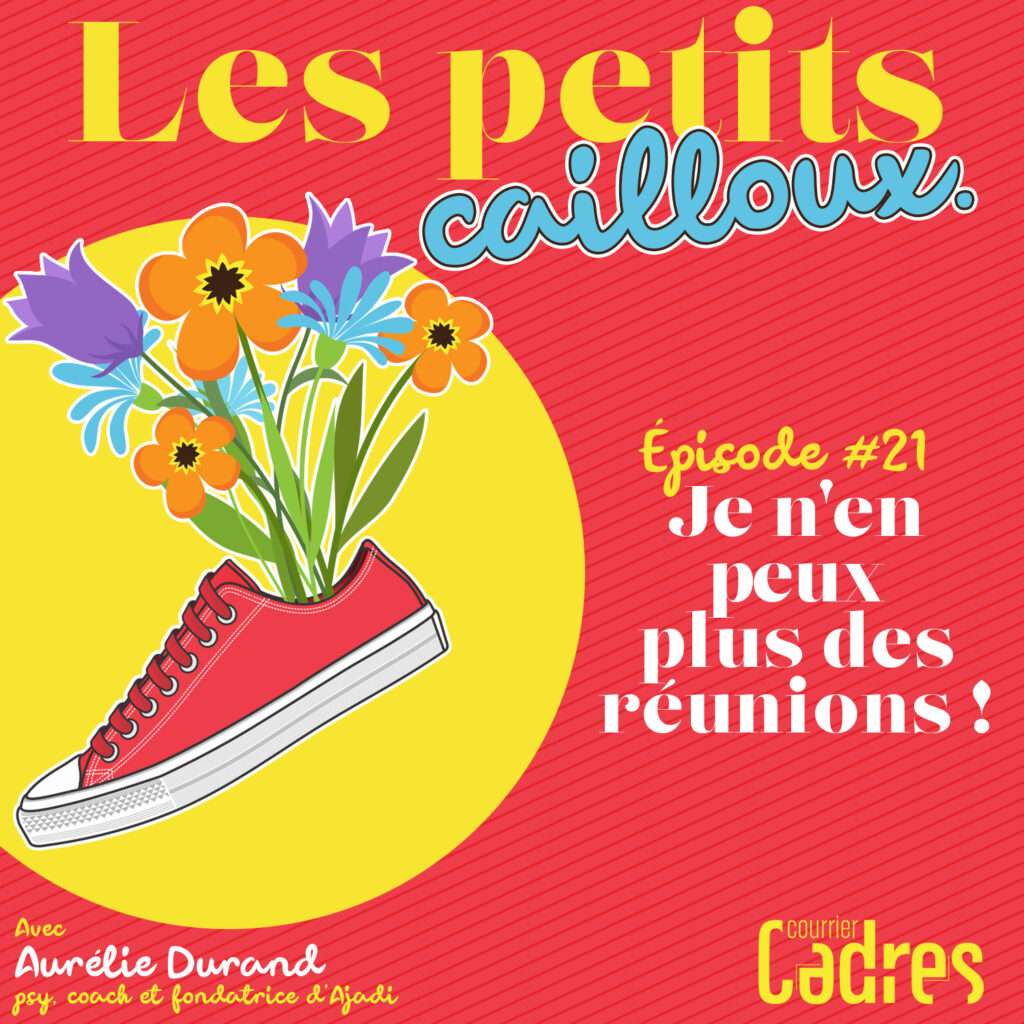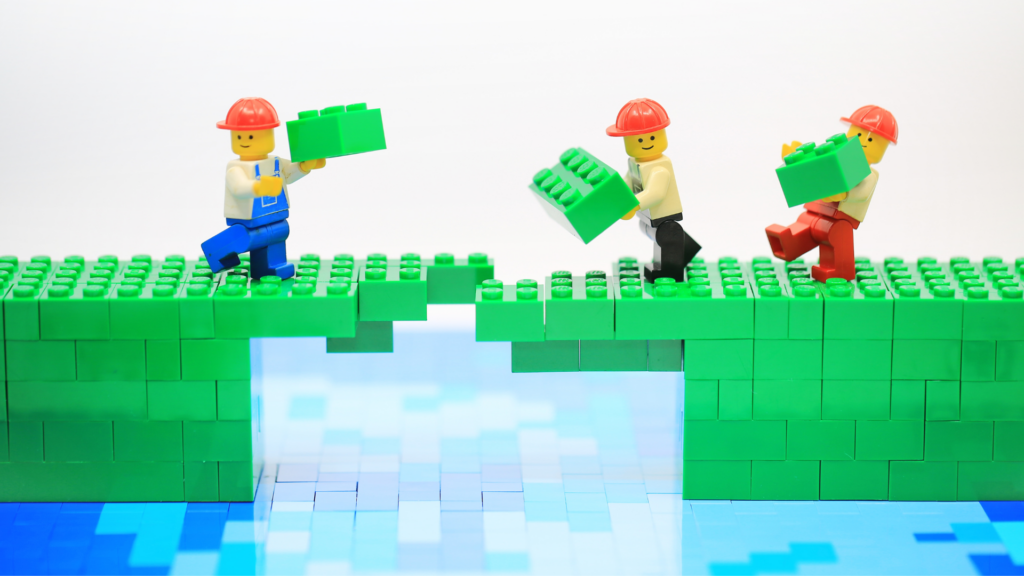Contre le système standardisé de l’industrie qui nuit à la qualité, il faut solliciter le cœur et l’intelligence. Il faut que les gens soient heureux à faire ce qu’ils font. C’est cette entreprise-là que nous devons créer. Par Roland Gori, psychanalyste et essayiste
L’épidémie de Covid-19 et les mesures sanitaires qu’elle a exigées a mis en évidence l’utilité sociale de certains métiers qui se sont retrouvés en première ligne, parfois au risque de leur vie ou de leur santé. Bien évidemment, tous les métiers du soin, du médico-social, de l’éducation et de l’information, mais aussi ceux des transports, sans oublier tous les “petits métiers”, traditionnellement “invisible” des industries de l’alimentation en nourriture ou en énergie. A cette occasion les citoyens ont découvert que la reconnaissance de l’utilité sociale sanctionnée par des salaires et des privilèges n’était pas celle qu’ils croyaient, n’était pas celle qui se méritait.
Une redistribution plus juste, plus équitable des revenus s’impose, la crise l’exige, l’opinion y consent. L’épidémie de coronavirus ne sera pas la dernière des catastrophes auxquelles notre humanité aura à faire. Et ce d’autant plus que nos craintes des catastrophes à venir ne sont que bien souvent le pressentiment des catastrophes ayant déjà eu lieu et dont nous ne voulons rien savoir : les croyances, les catégories de jugement et les manières de penser le monde et l’humain qui ont fondé et inspiré nos sociétés thermo-industrielles se sont écroulées5.
Nous avançons sur un sol qui s’est dérobé, les entreprises comme les sociétés se construisent sur des fondations obsolètes. Nous nous éclairons aux lueurs d’un astre mort, celui des illusions du XIXe siècle, quelque peu obscurcies par les tragédies du siècle suivant.
Ilusions zombies
Ces illusions zombies continuent à hanter la société et l’entreprise : concurrence, compétition, production, communication, publicité, organisation, hiérarchie, vitesse, innovation… Nous sommes encore déterminés par des visions du monde et des subjectivités conçues par une conception mécanique et linéaire du temps, temps orienté par un futur… confondu avec le paradis perdu. Ce mirage nous rend captif d’une civilisation de la mode et d’une consommation effrénée de produits de pacotilles qu’un William Morris avait critiquée en son temps comme “l’âge de l’ersatz”. Nous n’avons pas depuis changé nos manières tayloristes de travailler et de penser le monde en le segmentant, en le technicisant, en le rendant abstrait jusqu’à l’algorithme et invivable pour beaucoup. Sauf que cette taylorisation des emplois qui a détruit le métier des artisans s’est étendue à l’ensemble des secteurs et des emplois, du chirurgien digestif au technicien de surface en passant par l’enseignant ou le journaliste. Il y a eu des époques où les illusions d’un progrès réduit aux mutations techniques et industrielles, ont été remises en cause au profit de l’artisanat conçu comme un genre de l’art. C’est cette utopie de la fin du XIXe siècle, née de la révolte romantique contre le taylorisme et la ploutocratie, qui doit aujourd’hui irriguer la société et l’entreprise après Covid.
L’art et le “travail bien fait”
Le mouvement Arts and crafts, par exemple, avec le poète John Ruskin, et l’artisan William Morris, ont su prôner la réhabilitation du “travail bien fait”, de l’artisanat et de son jumelage avec l’art. La révolution joyeuse que prône William Morris requiert que l’artiste soit un artisan, l’artisan un artiste, que l’art devienne une aide, un soin, un réconfort dans la vie de chacun. Le mot “art”, chez William Morris, prend une extraordinaire extension, il signifie les “œuvres d’art explicites”, mais aussi toutes les couleurs et les formes de tous les biens domestiques, de tout ce qui nous entoure et où nous vivons : “je ne puis exclure de mon champ d’étude, comme véhicule possible de l’art, aucune des œuvres de l’homme qui se peut regarder. […] Pour le socialiste, une maison, un couteau, une tasse, une machine à vapeur ou je ne sais quoi, tout ce qui est, je le répète, fabriqué par l’homme et possède une forme, doit soit être une œuvre d’art, soit destructeur pour l’art.”
William Morris combat la société ploutocratique dans laquelle il vit. Il lui reproche de produire de l’angoisse et de l’ennui, de rendre les hommes malheureux : “La principale accusation que j’ai à formuler à l’encontre de l’état actuel de la société est d’être fondé sur le travail sans art ni le bonheur de la majorité des hommes.” Le socialiste – que se veut William Morris – “voit dans cette absence évidente d’art une maladie propre à la civilisation moderne et nuisible à l’humanité ; qui plus est, il pense que c’est une maladie qui peut être soignée.” Face à la brutalité utilitaire, la coopération des citoyens pourrait conduire à faire de l’art une nécessité de la vie humaine participant à l’existence de tous.
Dans l’histoire de la modernité, pour originale qu’elle soit, la position de William Morris ne fut pas unique. Nombreux furent les artistes et les artisans qui, en Europe et aux États-Unis, revendiquèrent, dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle, une association de l’art et du travail, une proximité de la nature et des matériaux utilisés, une coopération de l’entreprise et de la culture. J’évoquerai ainsi, outre William Morris, John Ruskin, l’économiste, l’historien des Pierres de Venise, soucieux d’articuler les conceptions de l’esthétique avec la vie morale et sociale d’une nation. Dans ses conférences à Oxford, il évoque constamment les problèmes de la vie qu’il associe aux techniques de l’art. L’art devient chez lui un moyen d’expression de l’homme, réalisé avec des outils humains, fait de matériaux naturels, et qui doit rester en harmonie avec les besoins ordinaires et le bon sens. La pureté du goût permet l’universalité de l’art, et le rend accessible au plus grand nombre : “le grand art n’est rien d’autre qu’un type de vie fort et noble.” Il donne aux objets utiles les qualités indispensables et supplémentaires du plaisir, de la beauté, accomplis dans la simplicité.
L’empathie et le beau
La société et l’entreprise qui viennent seront fondées sur l’empathie, l’entraide, le plaisir partagé, la meilleure qualité, le beau et le bon, le durable et l’essentiel, ou ne seront pas. La valeur ne saurait se réduire à la propriété émergente du quantitatif, qu’il s’agisse du prix, du rendement ou du profit. Ces illusions zombies nous conduisent vers les précipices des nihilismes et des organisations totalitaires. C’est dans l’entreprise que se construit la démocratie, son organisation préempte l’organisation sociale.
John Ruskin reprochait aussi à la division du travail de diviser les hommes, alors que l’art exige un homme complet, non mutilé par la segmentation des tâches, pour accomplir son œuvre. C’est pourquoi, disait-il, les artistes et les artisans sont les premiers à protester contre le système standardisé et rationalisé de l’industrie qui nuit à la fabrication de produits de qualité. Il faut solliciter à la fois le cœur et l’intelligence, il faut que les gens soient heureux à faire ce qu’ils font. En même temps qu’ils élaboraient de nouvelles utopies, ils réalisaient aussi des projets d’entreprises nouvelles, à la fois humaines et florissantes. En pleine industrialisation outrancière, ils montraient qu’il était possible d’être : “poète, artiste, fabricant et socialiste”… et de gagner de l’argent ! Une idée forte de ce mouvement, comme celui des peintres préraphaélites (1) ou en France les partisans de l’Art Nouveau à la fin du XIXe siècle, c’est que l’art doit intervenir partout, et en premier lieu dans notre environnement quotidien.
Il s’agit véritablement de nouvelles utopies sociales et culturelles qui s’emparent de la création d’œuvres fabriquées de préférence avec des matériaux traditionnels, dépouillés, naturels, et surtout dont la production permet l’épanouissement de l’artisan, sa réalisation personnelle. A travers l’accomplissement social et subjectif de l’artisan se crée une nouvelle forme d’humanité où le savoir-faire prévaut sur la concurrence. Cette manière de produire se répercute sur l’œuvre elle-même : les objets usuels, l’intérieur des maisons, les formes végétales, animales, les styles féminins, se trouvent privilégiés. Comme le remarque Bernard Maris dans son livre, Houellebecq Économiste, cet éloge que font les préraphaélites et les tenants des Arts & Crafts, réalise exactement le vœu de Marx, qui rêvait d’une société où la division entre la conception et l’exécution n’aurait plus cours. La transmission des techniques et des savoirs passe par la “reconstruction” des ateliers conçus comme un mini-État assurant la citoyenneté, l’apprentissage des élèves et la production des œuvres. Ces écoles autonomes devaient également se constituer sur la base de l’amitié : “Aujourd’hui, lorsque les hommes sont liés dans la production, leur lien repose sur le hasard, ou une inimitié commune envers un employeur, et ils deviennent amis parce qu’ils sont compagnons d’usine. Dans l’atelier reconstruit, cela devrait être inversé et ils deviendront compagnons parce qu’ils sont amis.”
L’entraide et le bon
C’est cette entreprise-là que nous devons créer et les nouvelles technologies qui apparaissent bien trop souvent aujourd’hui comme liberticides pourraient nous y aider. Ce qui suppose que loin de leur laisser le privilège exorbitant de “conduire nos conduites”, nous les soumettions à nos propres finalités afin de faire de nos existences une œuvre d’art, nous libérant des servitudes et facilitant les échanges. Ce fût le cas au cours de l’épidémie de Covid-19. Cela suppose que nous mettions fin à l’obésité bureaucratique des agences d’évaluation, diverses et variées, qui confisquent nos vies et nos décisions.
Les sceptiques diront que tout ceci est un rêve. Mais, Le rêve, comme l’art, soigne le psychisme, nourrit l’imaginaire singulier et collectif. Un monde sans le jeu du rêve, sans le soin de l’art, deviendrait vite un monde irrespirable, rationnel à l’extrême et meurtrier à l’horizon. Le “meurtre” de l’œuvre d’art est symboliquement accompli lorsque l’entreprise opérationnelle et industrialisée produit, par nécessité de rentabilité, des biens et des services uniformes, à l’adresse d’un individu moyen, standard et abstrait. A travers le meurtre de l’œuvre d’art accompli par la production industrielle et standardisée, c’est la diversité humaine qui est atteinte, et à travers elle l’individu concret qui produit ou pour lequel on produit.
L’humanité meurtrie par la standardisation industrielle accompagne nécessairement le désastre écologique. Ils appartiennent à la même logique catastrophique de l’anthropocène qui ne modifie pas seulement la planète, mais bien aussi l’humanité de l’homme. C’est bien pourquoi il convient, à distance de la technocratie actuelle des hommes et des institutions, de faire œuvre. Faute de quoi en réaction à cette violence qui vide le monde de l’esprit, toutes sortes de fanatismes peuvent émerger. A contrario, disait Jean Jaurès, “lorsqu’une société attache à l’idée de beauté le prix qu’elle doit y mettre, c’est-à-dire le prix souverain, elle trouve toujours moyen d’assurer de larges éléments de travail et de vie aux ouvriers de la beauté devenus les frères et les amis des autres.”
(1) Il s’agit d’un mouvement artistique né au Royaume-Uni au milieu du XIXe siècle dont les membres souhaitaient renouer avec la tradition des peintres italiens du quattrocento, prédécesseurs de Raphaël. Ils souhaitaient rendre à l’art sa fonction édifiante et sacrée, transformer par son moyen les mœurs d’une société corrompue par la révolution industrielle. Ce mouvement eut une influence sur William Morris, dont j’ai parlé plus haut.
L’auteur
Roland Gori, psychanalyste et essayiste, est l’auteur “La Fabrique des imposteurs”, ouvrage dans lequel il dénonce la notion de performance, issue du langage sportif, qui transforme l’entreprise en “champ de course”. Il s’oppose aussi à l’intégration de normes gestionnaires dans le secteur public. Parmi ses derniers ouvrages parus : “Et si l’effondrement avait déjà eu lieu”, “La nudité du pouvoir”, “Homo drogus” et “L’individu Ingouvernable”.
Cette tribune fait partie d’un dossier spécial sur l’avenir des entreprises après le Covid-19, à retrouver dans le numéro 127 de Courrier Cadres, de juin-juillet 2020.