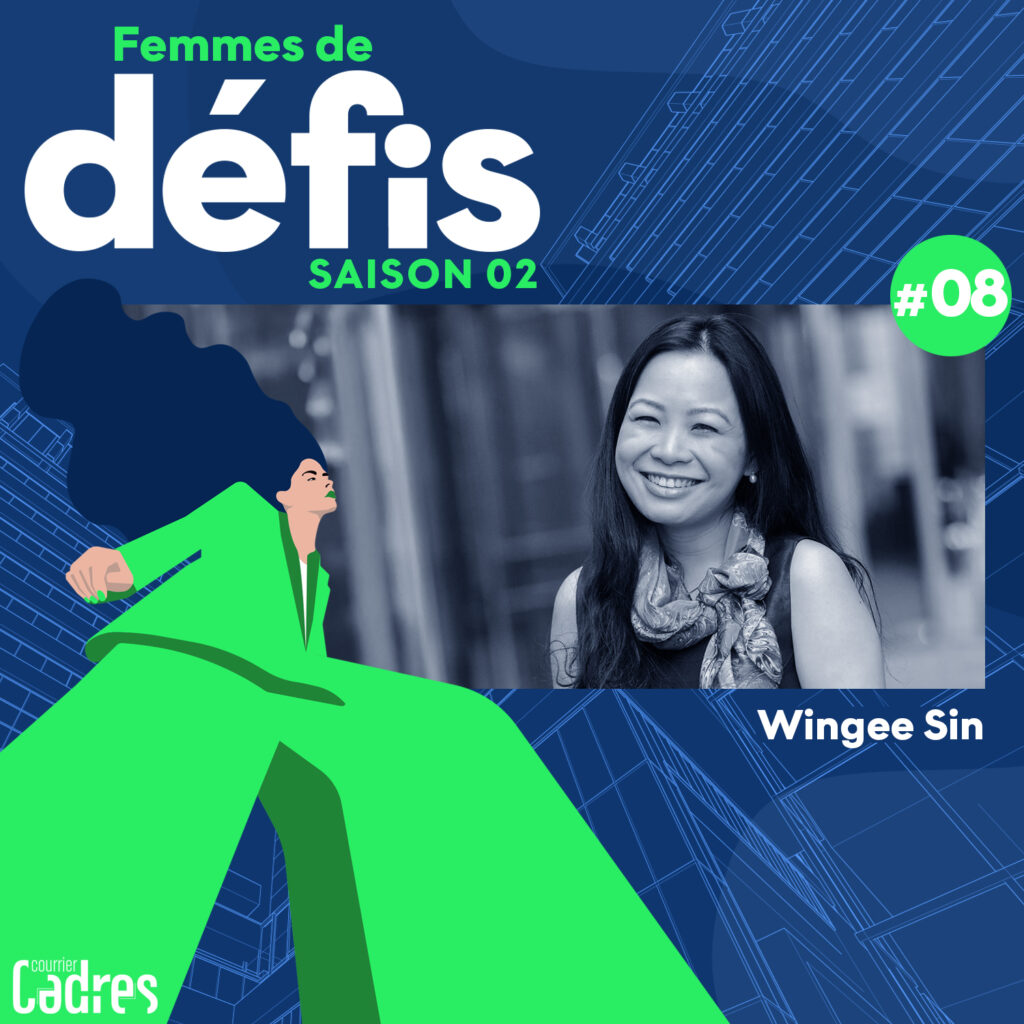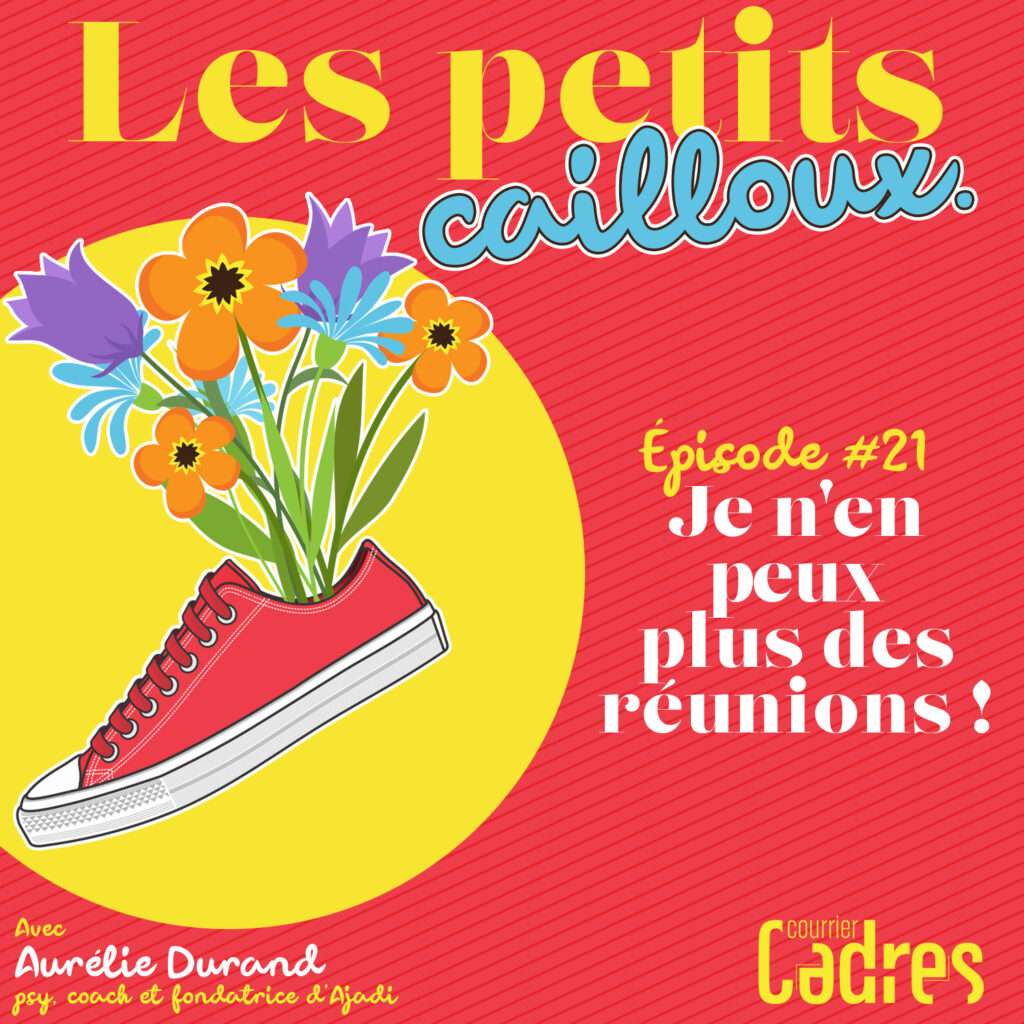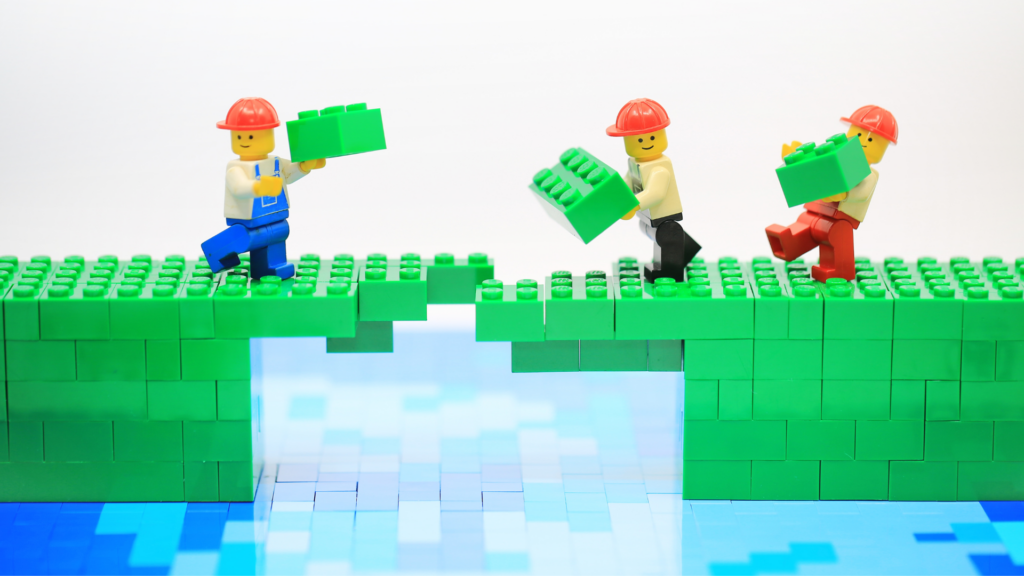Pratique anglo-saxonne, le “name and shame” joue à fond la carte de la stigmatisation. Avec pour ses adeptes, l’idée qu’une atteinte à la réputation peut avoir plus d’impact qu’une simple sanction financière.
En septembre 2017, à l’occasion d’une conférence de presse, la secrétaire d’État Marlène Schiappa pointait du doigt les entreprises françaises, selon elle, très en retard en matière d’égalité hommes-femmes. Cette pratique, baptisée le “name and shame” (littéralement, « nommer et faire honte ») commence à faire son chemin en France y compris donc au sommet de l’État. Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, veut également encourager sa pratique et a d’ailleurs retenu cette méthode dans son projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale.
Délation, un mauvais souvenir français
“Au-delà du risque d’actions indemnitaires que peut encourager la publication de condamnations, les entreprises sont très soucieuses de leur image. Que ce soit auprès de leurs partenaires commerciaux ou de leurs clients, professionnels comme consommateurs. Le lien entre la réputation et la consommation ne fait d’ailleurs plus vraiment débat aujourd’hui. Il suffit de voir l’impact des affaires comme Volkswagen sur les cours de la bourse”, analyse Julia Bombardier, avocat à la Cour et membre du cabinet Jeantet.
Et pourtant la France reste encore frileuse et un peu réticente, de par sa culture, à s’engager sur cette voie. Chez nous, le “name and shame” est rapidement associé à de la délation, face à laquelle on privilégie plutôt des dispositifs incitatifs et moins agressifs. “On note toutefois que l’exclusion normative [méthode consistant à bannir de ses investissements des entreprises ne respectant pas certaines normes internationales] s’implante peu à peu dans le monde de la finance. Cette pratique amène certains investisseurs à filtrer leurs investissements selon des principes éthiques ou certaines normes. Nous sommes encore frileux par rapport aux pays d’Europe du Nord, qui l’ont bien intégrée, mais cela devrait évoluer compte-tenu de la place de plus en plus importante donnée à la finance responsable”, note Tiphaine Vidal, fondatrice de Ethik Partner, conseil en RSE et solidarités. Pour cette dernière, les freins à l’expansion du “name and shame” en France sont aussi probablement liés à la méthode.
Dans la culture française, nous sommes plus à l’aise avec des démarches de type “bottom-up” pour dénoncer certaines pratiques en entreprise. Tout part en effet des revendications de salariés, de syndicats, d’ONG ou bien encore de consommateurs. Une évolution dans les mentalités que ne viendra pas contredire Ariane Mole, avocate et associée du cabinet Bird & Bird : “Attention à ne pas trop considérer que la culture française s’opposerait forcément à l’importation de pratiques anglo-saxonnes. À titre d’exemple, il y a plusieurs années la pratique du lanceur d’alerte importée des États-Unis avait fait scandale alors qu’aujourd’hui elle est reconnue par la loi française. Il y a désormais une forte demande de transparence et de responsabilité sociale de l’entreprise.”
Ne pas attendre d’être montré du doigt
Une entreprise doit néanmoins devoir se préparer à ces nouvelles pratiques. La politique de l’autruche semble la tactique la moins efficace. Anticiper et se préparer en amont reste pour les spécialistes la seule conduite à tenir. “Même si cela peut sembler évident, la première étape pour une entreprise est déjà d’anticiper le risque. Pour cela il est indispensable de bien comprendre la réglementation qui est de plus en plus vaste (RGPD, droit de la concurrence, droit de la consommation, loi Sapin, etc.) et surtout de plus en plus complexe”, précise Julia Bombardier.
L’entreprise doit mettre en place des programmes de conformité et en passer également par des formations internes à l’attention des opérationnels qui doivent absolument être sensibilisés aux risques juridiques. “Dans le cadre de la mise en place de ces programmes, les audits effectués permettent par ailleurs non seulement d’identifier le risque mais aussi de le gérer le cas échéant”, ajoute Julia Bombardier. Anticiper donc, on le voit et ne surtout pas se braquer. “Il faut d’abord argumenter, dès le stade des échanges, avec l’autorité concernée afin de limiter les dégâts et d’éviter la publication. Il faut aussi avoir défini un plan de communication permettant de limiter l’impact sur l’image de l’entreprise y compris sur les réseaux sociaux.
En tout état de cause, il n’est pas légalement possible de clouer éternellement au pilori le nom d’une entreprise. Le Conseil d’État a jugé en 2017 que la publication sans limite de durée est illégale. Une société qui est sanctionnée financièrement et dont le nom est publié subit en effet une forme de double peine”, conclut Ariane Mole.