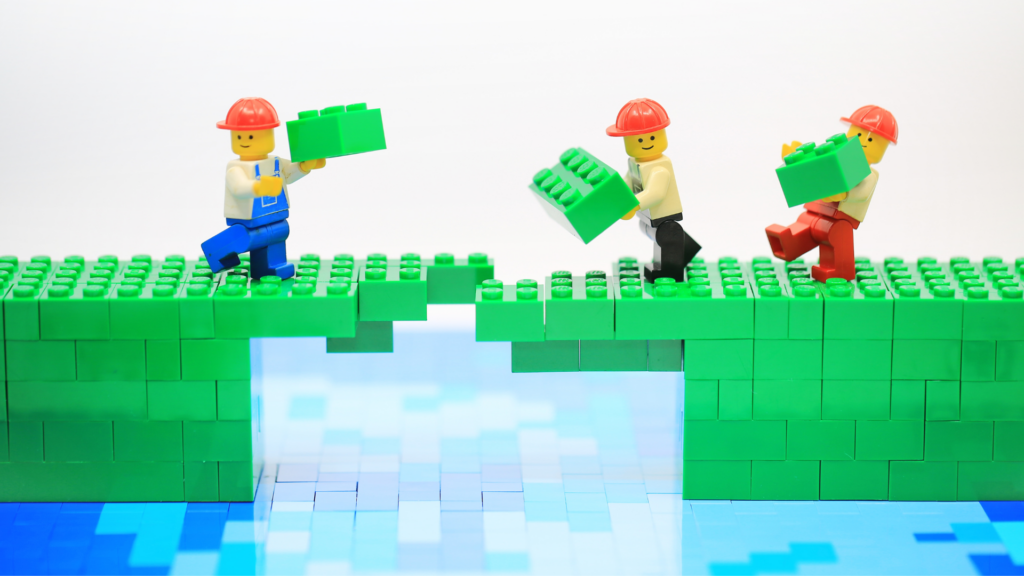Didier Pitelet a consacré sa carrière à l’accompagnement du changement, des relations humaines et à la communication. Il vient de publier le livre Le Pari de la culture, aux éditions Eyrolles, dans lequel il décrit différents modes de fonctionnement de société. Pour lui, la culture d’entreprise devrait être au cœur de chaque organisation car elle est responsable de l’adhésion du salarié à son groupe, ce qui est bénéfique pour les deux.
Comment définiriez-vous la culture d’entreprise ?
Il s’agit de tout ce qui unie les femmes et les hommes au niveau des valeurs, du comportement et de la vision générale d’une entreprise. Cela touche le projet, le management et le vivre ensemble. Chaque culture dépend de l’entreprise. Elle peut être liée à l’histoire du dirigeant comme à celle de l’organisme. C’est un concept vivant, ce n’est pas passéiste. La culture est ce qui autorise une entreprise à être discriminante. Non pas au mauvais sens du terme, mais dans celui d’une inclusion de celles et ceux qui y travaillent. Elle repose sur l’exemplarité des comportements et influe tout le processus de recrutement. Par exemple, le fait de proposer au manager d’accueillir le nouveau collaborateur pour lui lire son contrat de travail au lieu de l’envoyer par la poste. Certaines entreprises à forte culture créent même des contrats du vivre ensemble. Autre exemple, le fait de fêter la fin de la période d’essai, qui est un vrai rituel d’intégration dans la collectivité humaine de l’entreprise. La culture est un des premiers éléments clés du bonheur en entreprise. Dès lors que les salariés savent à quoi ils servent, ils sont plus heureux que la moyenne. Le drame de beaucoup d’entreprises, c’est que culturellement, elles n’appliquent rien qu’un copier-coller de valeurs à la mode reprises ici et là.
Comment se construit une culture d’entreprise ?
Déjà, il faut être capable de se demander en quoi on croit collectivement, à quoi on adhère et ce que l’on a rejeté. Il faut savoir quelle est la cause réelle et profonde du projet d’entreprise. L’identité se structure à partir de ce point là. Cela donne lieu ensuite à la mise en œuvre de rites de vie, avec les collaborateurs, les candidats et avec toutes les parties prenantes diverses et variées. Tous les discours doivent être traduits par des faits. Selon moi, une entreprise doit développer une spiritualité. Il faut que les 50, 100 ou 1 000 salariés portent le même maillot et se relèvent ensemble pour aller dans le même sens. Dans les grands groupes, c’est plus délicat, évidemment car c’est plus anonyme.
Qu’est-ce qui vous a poussé à rédiger ce livre ?
En France, on nous sort la soupe à la grimace. On ne parle que de ce qui ne va pas. Or, il y a des milliers et des milliers d’entreprises dans lesquelles les gens sont heureux et qui adhèrent vraiment à leur organisation. C’est le cas quand il y a une culture forte. Cette quête de sens est exprimée par les jeunes et moins jeunes qui font la différence entre les beaux discours et la réalité du terrain. Je pense que le défi des 10 ans à venir concernera la reconquête culturelle des entreprises. On sera capable de juger les dirigeants à leur capacité à être des chefs d’entreprise ayant une vraie culture.
Quels sont les modèles dominants dont vous parlez dans votre livre ?
Ce sont les entreprises aux dirigeants interchangeables et aux actionnaires mus par le retour sur investissement. Ils réfléchissent à court terme et font fie de la dimension culturelle. En revanche, il y a un magnifique enrobage en matière de communication sur l’intégration de la RSE, par exemple, mais qui génère un décalage entre la parole et la réalité. Ce modèle se retrouve plutôt dans les grands groupes cotés. Néanmoins, certains ont une culture d’entreprise très forte. C’est le cas de Danone, qui est encore sous l’influence du contrat économique et social impulsé par Antoine Ribout. Les sociétés qui suivent le modèle dominant vivent sur les modes. Elles n’ont jamais autant parlé de bonheur dans l’entreprise alors qu’il n’y a jamais eu autant de malaise.
Qu’est-ce qui fait la différence des modèles alternatifs que vous évoquez ?
Ces entreprises-là élèvent la culture comme élément sacré. Il s’agit le plus souvent d’ETI familiales qui ont une gouvernance incarnée. La transmission des valeurs se réalise à tous les niveaux de l’organisation et le vivre ensemble est érigé comme une priorité. Dans mes exemples, la considération des salariés et le fait d’être proche d’eux font partie des éléments clés du fonctionnement d’une entreprise. Par exemple, avec Anne Leitzgen, la petite fille du fondateur de Schmidt Groupe, nous venons de terminer un travail de marque employeur. Tout le comité de direction a présenté les éléments du dispositif à tous les managers et en avant-première à l’ensemble des collaborateurs. Plus on considère les salariés, plus ils adhèrent et plus ils sont heureux ! La culture est le carburant de bonheur, je m’y reconnais ou pas. Et les belles paroles n’y changent rien. Les entreprises qui sont dans le vrai ne sont pas celles qui font le plus de communication. Néanmoins, elles font parler d’elles grâce aux réseaux sociaux et à des instituts comme Glass Door.
De grands groupes comme LVMH ont une forte culture d’entreprise, ce n’est pas pour autant que tous les salariés bénéficient d’une grande considération, comme le montre le film Merci patron…
Il y a une culture par maison chez LVMH, et le groupe a fait l’effort de créer un lien pour l’ensemble. Mais je suis obligé d’aller dans votre sens ! Des entités peuvent être prestigieuses et avoir des incohérences culturelles. C’est là où il faut se méfier. Il peut y avoir des dérapages liés aux humains sur le terrain et qui font un déni culturel par leurs actes et leurs comportements. C’est le cas de beaucoup d’entreprises, notamment américaines. Il y a de belles formules qui ne correspondent à rien.
Que penser d’une société comme Google, qui vante sa culture d’entreprise et qui fait rêver les jeunes diplômés, alors qu’elle est loin d’être irréprochable ?
Avec Google, nous sommes dans un entre deux. Il n’est pas possible de nier que Google a une culture forte. Mais il y a un grand écart entre la perception culturelle à l’américaine et ce qui se fait en Europe, notamment dans les pays latins. Google veut vous faire entrer dans son moule. L’entreprise valorise les compétences, on s’agrège pour s’oublier derrière le modèle, cela fait une vraie différence. On vous sert tous les attributs culturels mais vous êtes corps et âme dédiés à Google. Des reportages ont pu montrer que les salariés de l’entreprise sont muselés*.
Le bonheur est-il forcément l’avenir de l’entreprise ?
Nous sommes confrontés à une nouvelle génération, celle de jeunes nés après 1994, comme le définissent les sociologues. Ce sont de vrais mutants en quête de valeurs vis-à-vis desquelles ils seront sans compromis. Cela va imposer le changement. La chaîne de transmission des parents aux enfants est rompue. Cette génération s’auto-suffit. Alors que la génération précédente était plus dans la mascarade et dans le décalage entre les paroles et les actes, celle-ci veut une adéquation entre les deux. Elle est aussi la génération des start-up et d’un monde qui se base sur des notions de partages, de convivialité, d’échange et de réciprocité.
* Voir par exemple La face cachée de Google dans l’Envoyé spécial du 29 octobre 2015.